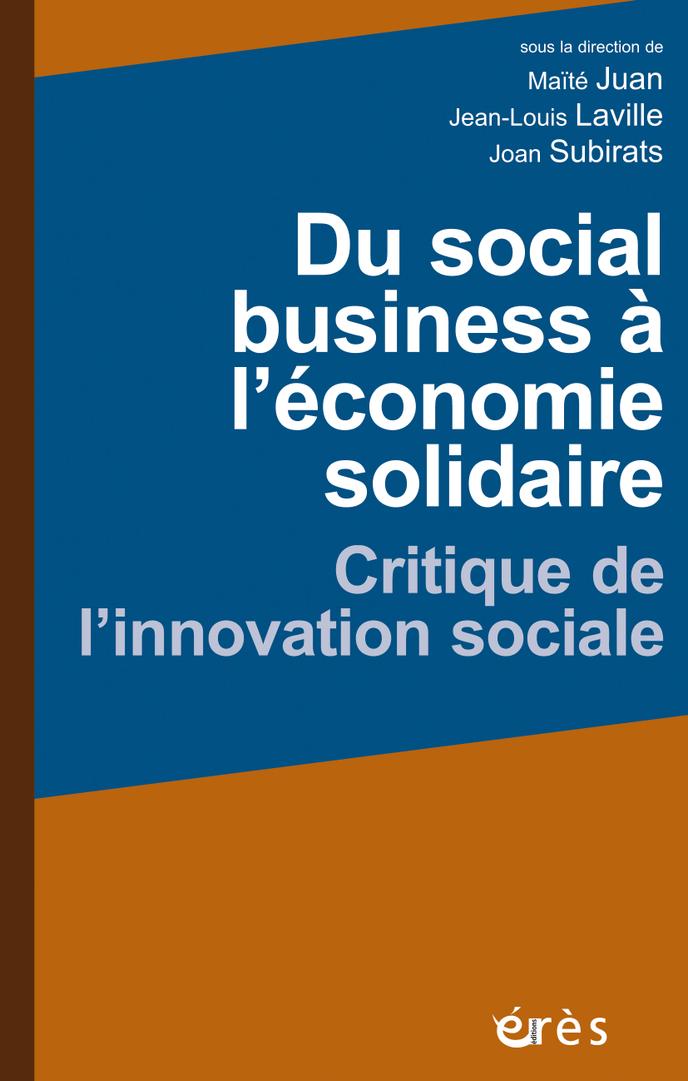La Commission propose une évaluation controversée de la dangerosité du coronavirus

Le SARS-CoV-2 est-il dangereux pour les travailleurs ? Cette question technique, à haut potentiel inflammable, est au cœur d’une de ces délibérations de comités confidentiels auxquels l’Europe est accoutumée. Les Etats membres et la Commission européenne ont fait un choix : le virus n’atteint pas le niveau maximum de dangerosité prévu dans la législation sur la protection des travailleurs contre ce type de risque. La proposition de la Commission, qui suscite l’indignation des syndicats, sera soumise, jeudi 14 mai, à un vote lors d’une réunion des représentants des 27 pays.
Dans la directive européenne de 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail, l’échelle de gravité des germes comporte quatre paliers. Le moins dangereux d’entre eux est non « susceptible de provoquer une maladie chez l’homme » (groupe 1). Le plus dangereux (groupe 4), en sus de provoquer des maladies graves, « constitue un danger sérieux pour les travailleurs » et présente « un risque élevé de propagation dans la collectivité ». Pour cette catégorie, « il n’existe généralement pas de prophylaxie ni de traitement efficace ». Dans ce groupe, sont notamment rangés des virus causant des fièvres hémorragiques comme Ebola ou Marburg. Entre les deux, une gradation de critères définis par cette directive.
Le SARS-CoV-2 « appartient au même groupe de virus que le SRAS et le MERS », eux aussi des coronavirus classés dans le groupe 3 « en dépit du fait qu’aucun vaccin n’était disponible », déclare Rebekah Smith, directrice adjointe des affaires sociales de Business Europe
Fin avril, la Commission décide de lancer une procédure accélérée, afin de ranger le SARS-CoV-2 dans l’un de ces quatre groupes et de l’ajouter à la liste des « agents biologiques » – virus, bactéries, parasites et champignons – faisant l’objet de mesures de protection des travailleurs dans l’Union européenne (UE). Puis, le 7 mai, elle propose qu’il intègre le groupe 3. Pour ce dernier, pourtant, la directive stipule qu’« il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace » – ce qui n’est pas encore le cas pour le coronavirus causant le Covid-19. Mais aussi que le risque de propagation n’est pas « élevé », comme dans le groupe 4. Plus de 40 % de l’humanité a pourtant été confinée pendant plusieurs semaines pour freiner sa dissémination.
« Consensus » parmi les Etats membres
Il vous reste 71.52% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.