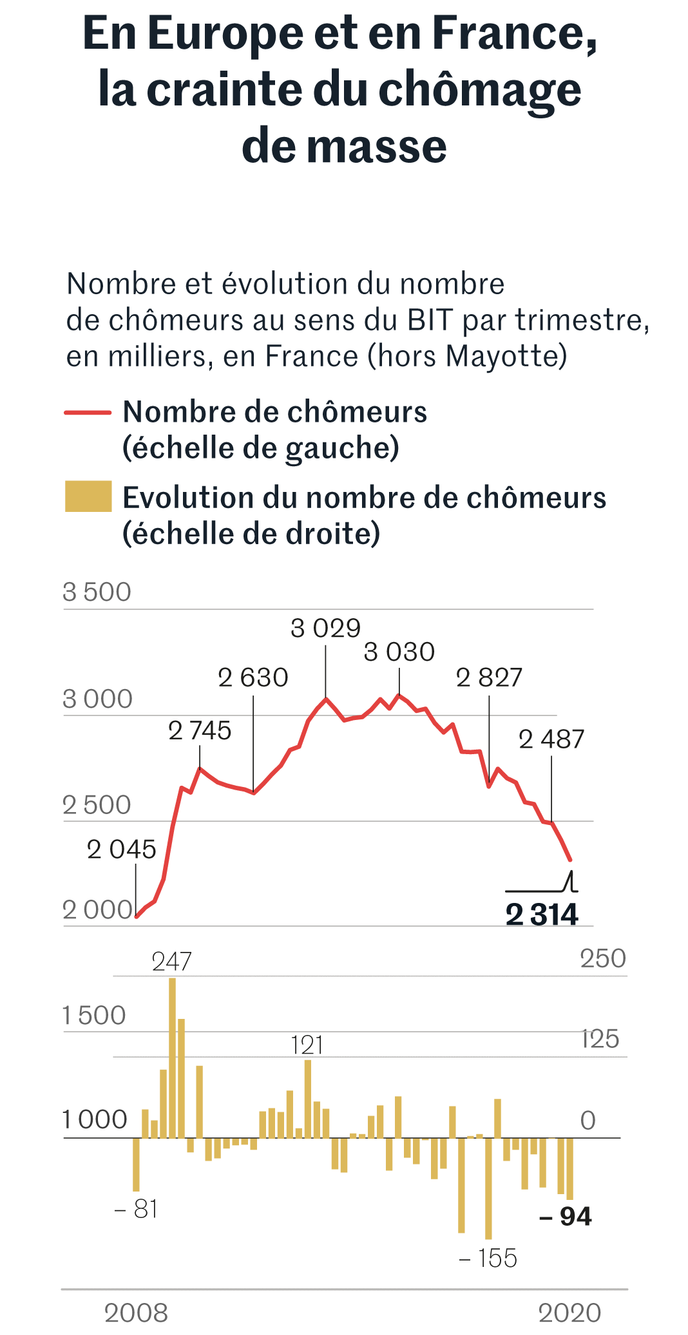Au travail, la santé des salariés surveillée de près

« Bénéficier d’un protocole de travail adapté (…) à partir d’une évaluation individuelle de sa sensibilité face au Covid-19 » : en ces temps de pandémie, la promesse de l’application Copass a de quoi séduire les employeurs devant gérer le retour au bercail de leurs salariés.
Lancée conjointement par le Crédit agricole et l’entreprise Onepoint, cette solution propose de déterminer le niveau de risques de chaque collaborateur à partir d’un questionnaire de santé conçu avec les autorités de santé publique.
En fonction de ses réponses, l’application délivre un code QR dont la couleur détermine un protocole de travail défini par l’entreprise : télétravail, retour sur site en horaire alterné, orientation vers un test de dépistage…
Prise de température
A l’instar de l’application Copass, plusieurs projets visant à identifier les personnes potentiellement vectrices du virus sont à l’œuvre. Il y a, bien sûr, le développement laborieux de l’application StopCovid. Mais des acteurs privés développent également leurs propres outils. Le cabinet d’audit PWC offre à ses clients une solution de traçage permettant d’identifier les salariés avec lesquels un collaborateur contaminé a été en contact.
Pour le moment, cette solution n’est pas proposée en France. En Italie, Ferrari a redémarré sa production en proposant à ses salariés de passer des tests sanitaires. D’autres technologies mesurent en temps réel la température corporelle des individus. Le groupe Procedo commercialise des caméras thermiques et des bornes d’autocontrôle permettant de détecter d’éventuels cas suspects.
Mi-mai, le groupe avait déjà installé un peu plus de cent quatre-vingt de ces dispositifs à l’entrée d’entreprises, de commerces et d’administrations. « On navigue dans les méandres du droit, reconnaît Clément Vuibert, le directeur commercial associé du groupe. L’employeur est tenu de protéger ses salariés, en même temps, il ne doit pas faire de discrimination pour des raisons de santé. »
Ces outils intéressent certaines entreprises, puisque toutes sont sommées de protéger leurs salariés face à la crise sanitaire. Selon une enquête de l’association nationale des DRH (Andrh), publiée le 30 avril, effectuée auprès de 5 000 entreprises, 37 % des 531 responsables des ressources humaines qui y ont répondu se disaient favorables à la prise de température à l’entrée des locaux et 33 % à la mise en place d’une application de traçage type StopCovid dans l’entreprise.
Adhésion des salariés
Il vous reste 70.22% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.