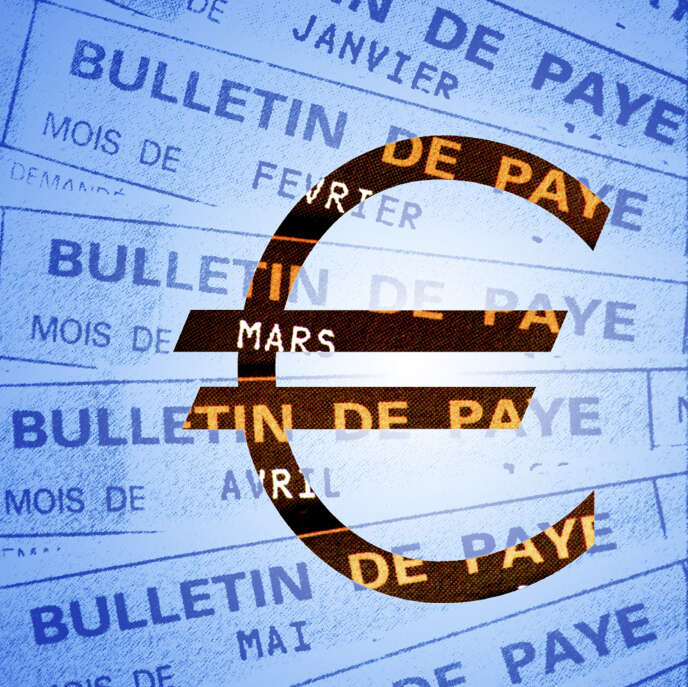« Une crise comme aucune autre », les prévisions alarmistes du FMI

Le retour de la foule dans les bars et les restaurants, les frontières qui réouvrent progressivement, la saison touristique qui approche… Il ne faut pas se fier à ces quelques signes extérieurs d’un faux retour à la normale, selon le Fonds monétaire international (FMI), qui publie ses prévisions alarmistes, mercredi 24 juin. Le recul du produit intérieur brut (PIB) pour le monde atteindrait 4,9 % en 2020, selon son rapport. Du jamais-vu. « C’est une crise comme aucune autre », note le FMI.
Cette prévision est bien pire que celle réalisée en avril par l’institution de Washington, qui prévoyait alors un plongeon de 3 % du PIB, ce qui constituait déjà une chute sans précédent. Pour rappel, la récession mondiale de 2009, qui était alors la pire depuis soixante-dix ans, avait été de – 0,1 %.
« La pandémie du Covid-19 a eu un impact plus négatif que prévu sur l’activité économique au premier semestre, et le retour de la croissance sera plus graduel qu’anticipé », résume l’institution. L’Europe est de loin la région la plus touchée, puisque c’est là que le confinement a été le plus sévère. En zone euro, la chute du PIB devrait être de 10,2 % en 2020. L’Italie et l’Espagne (– 12,8 %) mais aussi la France (– 12,5 %) sont les pays les plus touchés, avec le Royaume-Uni (– 10,2 %). En Allemagne, le PIB devrait reculer de 7,8 %. Tous ces chiffres sont, là encore, sans précédent.
La Chine échapperait à la récession
Côté américain, les Etats-Unis, où le confinement a été un peu moins sévère et uniforme, devraient connaître une baisse du PIB de 8 %. En Amérique latine, où le virus continue à se répandre et où la pandémie n’est pas maîtrisée, les prévisions sont catastrophiques pour le Mexique (– 10,5 %) et le Brésil (– 9,1 %). L’un des seuls pays qui devrait éviter la récession est celui d’où est partie la pandémie. Le FMI table en effet sur une croissance minimale, de 1 %, pour la Chine.
Pourquoi cette aggravation des prévisions du Fonds monétaire international, seulement deux mois après un rapport déjà alarmiste ? L’argumentation tient en trois étapes.
D’abord, l’impact de la fermeture presque intégrale de certaines économies a été pire qu’anticipée. Ensuite, le retour à la normale va être plus long que prévu. Difficile d’imaginer des salles de cinémas pleines, des restaurants combles, des avions bondés. « La distanciation sociale va persister au second semestre », note le FMI. Par ailleurs, dans les pays où la pandémie n’est pas maîtrisée, de nouvelles mesures de confinement seront sans doute inévitables. Bref, la demande n’est pas prête de revenir à son niveau d’avant la pandémie.
Il vous reste 49.35% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.