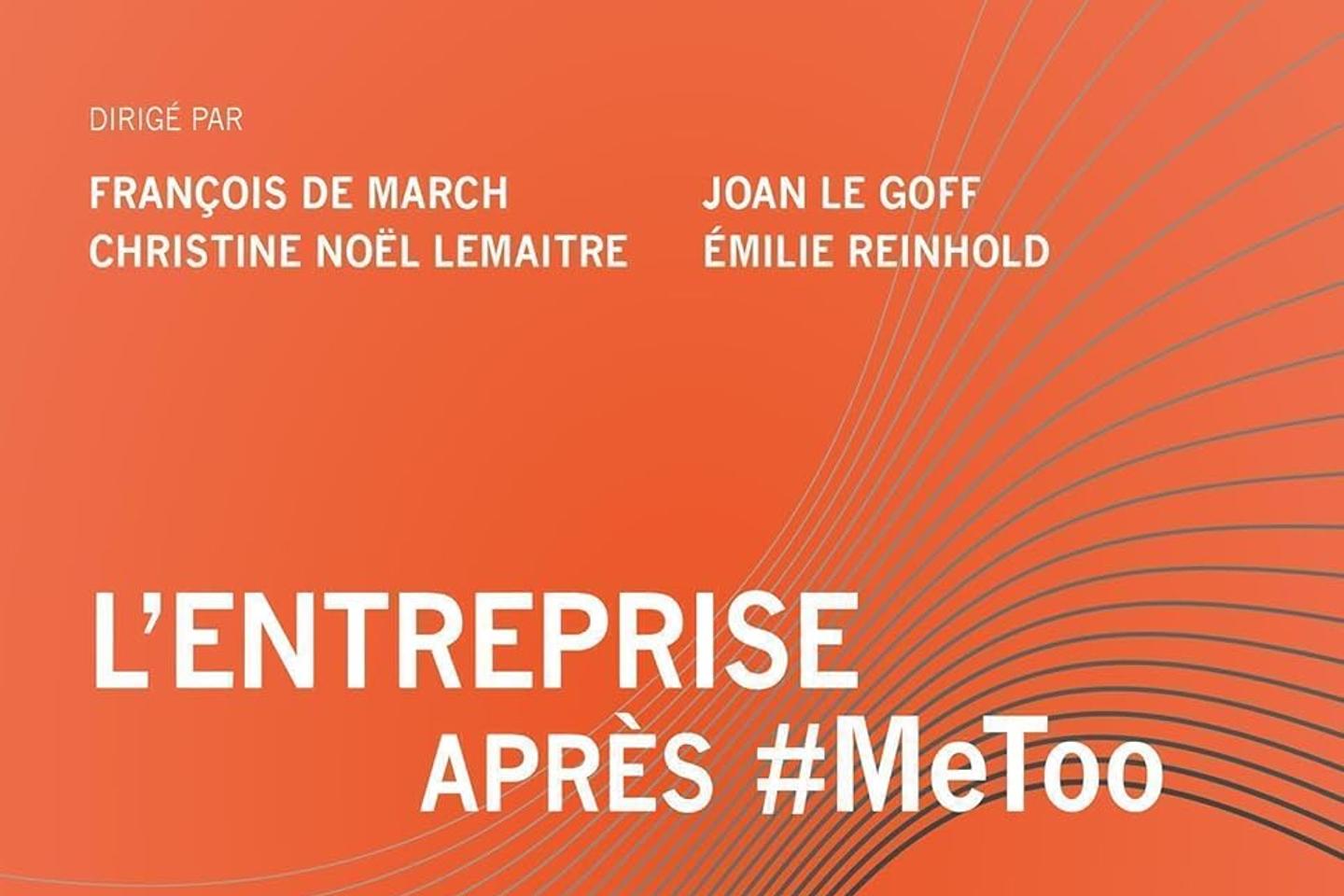A Saint-Malo, des marins privés de protection sociale

Elle est venue seule, mais elle « représente d’autres collègues ». Dans l’antenne malouine de la CGT des marins du Grand Ouest, droite dans ses bottes, Jade (le prénom a été changé) remonte le temps : « Depuis juin 2025, je n’ai plus aucune Sécurité sociale. » Celle qui pratique la marine de longue date a rejoint, en juin, la compagnie DFDS à un poste qu’elle taira pour des raisons d’anonymat. La société danoise – numéro 8 mondial en capacité de passagers – s’est installée à Saint-Malo en avril pour effectuer les liaisons avec Jersey, en remplacement de la compagnie historique Condor Ferries, filiale de Brittany Ferries.
Jade souhaitait s’offrir une nouvelle expérience, profiter du rythme de quinze jours en mer, quinze jours à terre proposé par DFDS à bord du Tarifa Jet, qui navigue sous pavillon britannique. L’ancien patron de l’entreprise en France, Etienne Melliani avait prévenu dans les colonnes de Ouest-France en mars 2025 : « Tous les marins déployés sur le Tarifa Jet seront employés avec des salaires et des conditions d’emploi britanniques. »
Problème : Jade et la cinquantaine de ses collègues qui résident en France ne parviennent pas à se faire affilier à la Sécurité sociale britannique. « L’employeur nous a dit que l’on pouvait, mais nous n’y arrivons pas, car nous n’avons pas d’adresse sur place », déplore-t-elle. Les voilà dans l’impossibilité de cotiser à la retraite, au chômage ou aux accidents du travail depuis plusieurs mois.
Il vous reste 59.04% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.