Dans l’industrie, la collaboration hommes-robots n’est pas sans danger
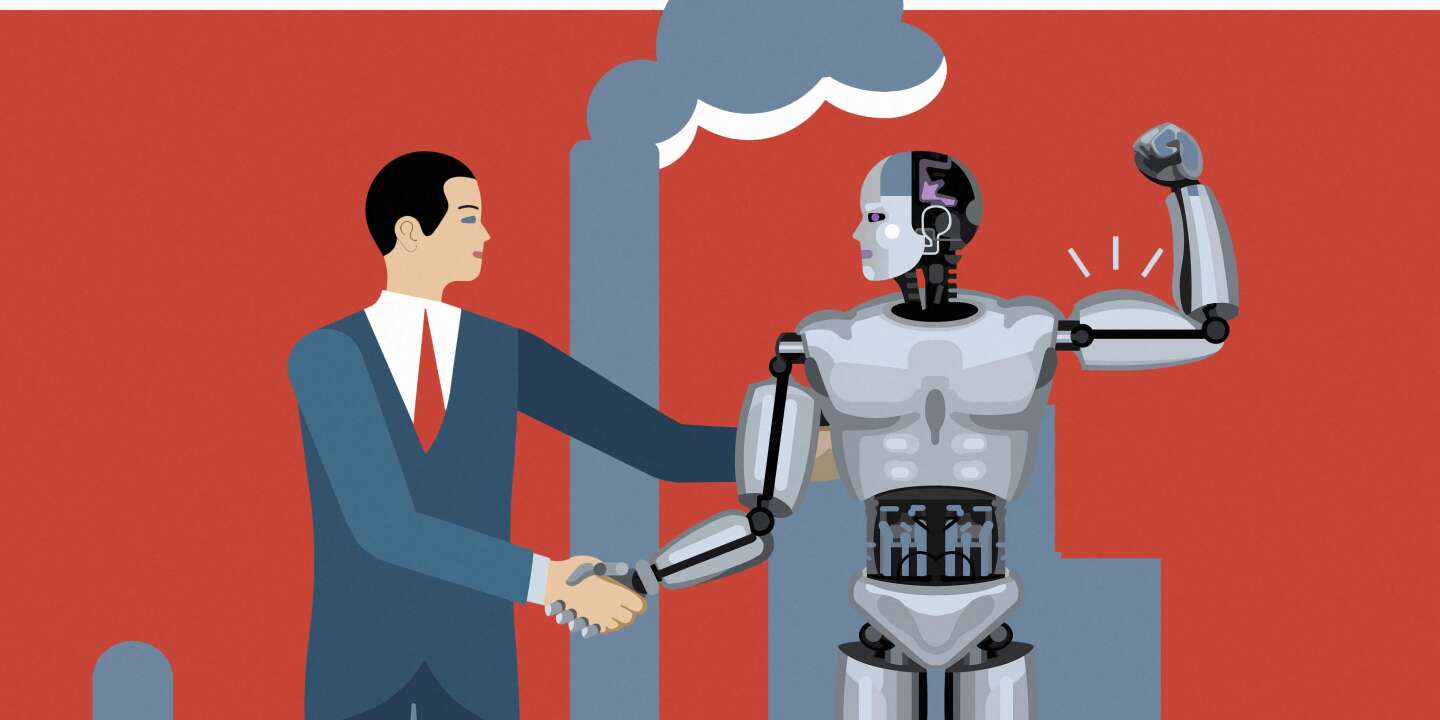
Certains ont la capacité de réaliser avec précision la pose de rivets. D’autres intègrent des ateliers où l’on peint des carrosseries automobiles. On les trouve aussi chez des spécialistes de l’agroalimentaire, par exemple sur des chaînes d’emballage. Les robots collaboratifs font, depuis quelques années, leurs premiers pas dans l’industrie.
Des premiers pas discrets, « leur présence dans les entreprises restant encore marginale, parfois le fait d’une curiosité des organisations ou d’une volonté d’avoir une vitrine technologique », relève Jean-Christophe Blaise, responsable du laboratoire Sécurité des équipements de travail et des automatismes à l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS). Pour autant, « leur essor semble inéluctable », estime l’INRS. En confiant aux machines les tâches à risque pour les salariés, « cela nous permettra d’améliorer leur bien-être mais aussi d’avoir des équipes plus efficaces et de réduire ainsi absentéisme et turnover », remarque un industriel.
L’arrivée annoncée de ces « cobots » (contraction de « coopération » et « robotique »), qui ont souvent la forme d’un bras articulé, constitue une petite révolution dans le secteur de la robotique industrielle. Car, contrairement aux machines jusqu’alors déployées, les cobots peuvent opérer dans le même espace de travail que les salariés. « C’est un véritable changement de paradigme : on ne concevait jusqu’alors le robot que dans une cage, sans contact possible », note M. Blaise.
Vitesse d’exécution réduite
Cette sortie hors des cages protectrices s’accompagne aujourd’hui de nombreuses réflexions sur la sécurité des collaborateurs amenés à évoluer à proximité immédiate des cobots. Elle implique, en effet, de nouveaux risques. Afin de prévenir, par exemple, les chocs et la menace d’écrasement, certains cobots disposent de fonctions de sécurité : ils peuvent se mettre automatiquement à l’arrêt en cas de contact avec un opérateur. « Un radar laser permet de ralentir ou de stopper le robot. Il reprendra son activité lorsque la personne s’éloignera », explique Maxime Hardouin, directeur général d’AeroSpline, société qui développe des cobots. Lequel précise, par ailleurs, que « dans beaucoup de cas les mouvements du robot sont lents ».
C’est une spécificité commune à de nombreux cobots travaillant en interaction avec des opérateurs : la vitesse d’exécution est volontairement réduite pour limiter les risques d’impact physique. D’autres adaptations peuvent être déployées, en fonction des situations de terrain : réduction de la masse du robot, absence de bords saillants, etc.
Il vous reste 54.98% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.