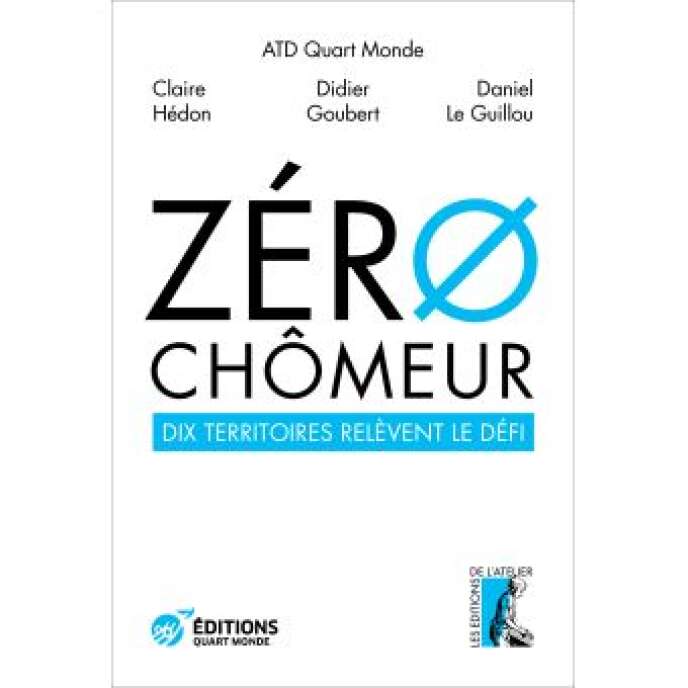Les nouvelles règles de l’assurance-chômage dévoilées

Patronat et syndicats doivent être consultés sur les trois projets de décrets lors d’une réunion prévue le 16 juillet.
Article réservé aux abonnés
Une étape supplémentaire vient d’être franchie dans la reprise en main par l’Etat de l’assurance-chômage. Mercredi 10 juillet, les services du ministère du travail ont adressé aux partenaires sociaux les trois projets de décrets qui transforment en profondeur le système d’indemnisation des demandeurs d’emploi. Lors d’une réunion programmée le 16 juillet, le patronat et les syndicats seront invités à émettre un avis, purement consultatif, sur ces textes qui, mis bout à bout avec leurs annexes, forment une liasse de quelque 250 pages.
De nouvelles règles vont s’appliquer, conformément aux orientations esquissées le 18 juin à Matignon par le chef du gouvernement, Edouard Philippe, et par la ministre du travail, Muriel Pénicaud : durcissement des conditions d’entrée dans le régime, mise en place de la dégressivité des allocations pour les salariés les mieux payés, changement des modalités de calcul de la prestation de manière à éviter que la somme versée au demandeur d’emploi soit supérieure à la rémunération qu’il percevait quand il était en activité, etc.
Les documents transmis mercredi aux organisations d’employeurs et de salariés recèlent quelques modifications qui n’avaient pas été évoquées, lors des annonces du 18 juin. La plus notable concerne la dotation apportée à Pôle emploi par l’Unédic, l’association pilotée par les partenaires sociaux qui gère l’assurance-chômage. Jusqu’à présent, cette contribution correspondait à 10 % des ressources de l’Unédic, soit un peu plus de 3,5 milliards d’euros en 2019 ; elle va être augmentée d’un point pour passer à 11 %, ce qui représente environ 370 millions d’euros – « au titre du renforcement de l’accompagnement » des personnes privées d’activité.
« Il peut y avoir des surprises »
Une ponction que les syndicats vivent très mal car, avec le patronat, ils réclamaient exactement l’inverse. A l’heure actuelle, le budget de Pôle emploi est plus alimenté par l’Unédic que par l’Etat. Les partenaires sociaux avaient demandé un rééquilibrage afin que l’effort soit, à l’avenir, le même des deux côtés. Ils viennent donc d’essuyer un camouflet.
Michel Beaugas (Force ouvrière) dénonce une décision « unilatérale » qui exprime, une fois de plus, du « mépris à l’égard du paritarisme ». Elle revient à « faire payer par les chômeurs leur accompagnement », ajoute-t-il. Sous-entendu : l’Etat pioche dans le portefeuille de l’Unédic des euros qui devraient d’abord servir à indemniser les demandeurs d’emploi – au lieu de financer des missions incombant à l’Etat.