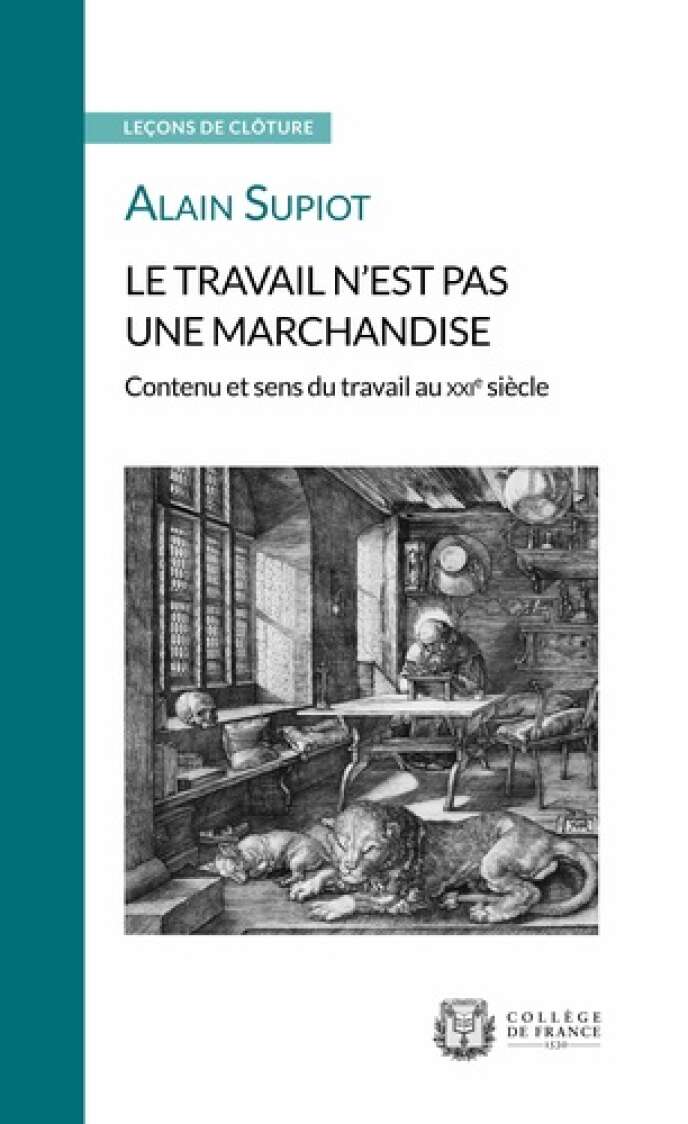Faire ses premiers pas en entreprise, c’est apprendre toute une série de codes sociaux et comportementaux. La morphopsychologue Martine Tardy, auteure de Décoder la gestuelle de votre interlocuteur pour mieux le comprendre (éditions Dangles, 2011), livre quelques conseils pour améliorer sa communication non verbale au bureau.
Pourquoi la communication non verbale est-elle importante ?
La communication non verbale, ce sont les éléments d’information qui permettent de communiquer sans passer par la parole. Avoir les bras ou les jambes croisées, par exemple est un signe de repli qui indique qu’on est méfiant par rapport à ce qui va être dit ou fait. Quelqu’un d’extraverti, à l’inverse, aura tendance à placer les épaules en arrière, les mains posées sur les genoux et le torse en avant. Le regard, qui est le tout premier contact que l’on a avec l’autre, celui qui autorise le contact verbal, peut aussi en dire long, de même que la tenue vestimentaire, l’intonation de la voix, l’expression du visage, les mimiques ou le type de sourire. Le « sourire commercial » disparaît tout de suite. Un vrai sourire met toujours un petit moment à se dissiper. Il s’accompagne de la bouche légèrement entrouverte avec les coins qui remontent et les yeux qui brillent. D’après certaines études, tout ce langage du corps compterait pour 55 % dans la transmission d’un message, contre 38 % pour l’intonation de la voix et seulement 7 % pour les mots choisis.
En entreprise, il convient donc d’y être très attentif…
Les mots seuls ne permettent pas toujours de savoir ce que pensent nos collègues, nos supérieurs. Faute de pouvoir entrer directement dans leur cerveau, nous pouvons essayer de saisir la vérité en observant, derrière le non-dit, les signes extérieurs.
Les mouvements du corps ne mentent pas. Ils disent à notre insu ce que nous n’osons pas exprimer avec des mots. Ils traduisent notre humeur, nos sentiments et nos émotions. En ce sens, aucun geste n’est gratuit. Quand votre supérieur vous serre la main, s’il pose son autre main sur votre épaule, il met d’emblée une emprise sur vous. Il vous montre qu’il vous domine.
Attention toutefois à ne pas tirer de conclusions trop hâtives. Quelqu’un qui a le regard fuyant est vite catalogué comme menteur ou lâche. Mais cette personne peut simplement manquer de confiance en elle et avoir peur du regard de l’autre. Comme les mots, les gestes peuvent avoir plusieurs sens. Le contexte dans lesquels ils s’inscrivent est donc important.
Observer les autres, c’est bien. Mais il faut aussi arriver à maîtriser son propre langage corporel…
Autant il est possible de formater sa parole, autant il est difficile d’avoir la mainmise sur son corps. On peut le contrôler cinq, dix minutes. Au-delà, c’est compliqué. On a beau essayer de chasser le naturel, il finit toujours par revenir. Un jeune qui arrive en entreprise doit donc rester le plus près possible de ce qu’il est. Si son langage corporel n’est pas en accord avec sa parole, on ressentira tout de suite que cela sonne faux.
N’y a-t-il pas néanmoins des erreurs faciles à éviter?
Si bien sûr ! Il faut par exemple se garder de s’habiller au bureau comme on s’habillerait le soir pour sortir et opter pour des vêtements sobres et suffisamment confortables. Parce que notre tenue vestimentaire influe sur nos gestes… Il convient également de soigner sa démarche. Si on arrive d’un pas nonchalant, la veste déboutonnée, avec le regard qui navigue à droite, à gauche, on donnera l’impression de ne pas accorder d’importance à la personne qu’on a en face de soi. Autre point fondamental à garder en tête : en entreprise, il y a des distances à ne pas franchir. L’espace, c’est du pouvoir. Il ne faut donc jamais pénétrer sur le territoire d’autrui sans y avoir été invité. Un jeune qui arrive dans une entreprise doit s’attacher avant tout à rassurer les autres, à leur montrer qu’il ne vient pas pour leur prendre leur place, mais pour collaborer.
Pour ce faire, vous conseillez d’utiliser notamment la synchronisation. De quoi s’agit-il ?
La synchronisation consiste à observer son interlocuteur et à se mettre en miroir avec lui. Bien sûr, il ne s’agit pas de le caricaturer, mais simplement d’adopter le même schéma corporel que lui. S’il croise les bras, vous attendez quelques secondes et vous croisez les bras à votre tour. En douceur. En faisant les mêmes gestes que lui, vous lui renvoyez son image. Vous lui montrez que vous le comprenez. Vous faites donc aussitôt tomber son agressivité et le mettez dans de bonnes dispositions pour entamer le dialogue.

![« La trajectoire [du voyagiste] illustre un dilemme stratégique plus général entre croissance externe, qui vise à une position dominante du secteur, et croissance par l’innovation qui renouvelle le métier » (Palma de Majorque, le 25 septembre).](https://img.lemde.fr/2019/10/25/16/0/5712/3808/688/0/60/0/5b9a9d7_xKfDHTIlxqOBXwx5JYIxi5sY.jpg)