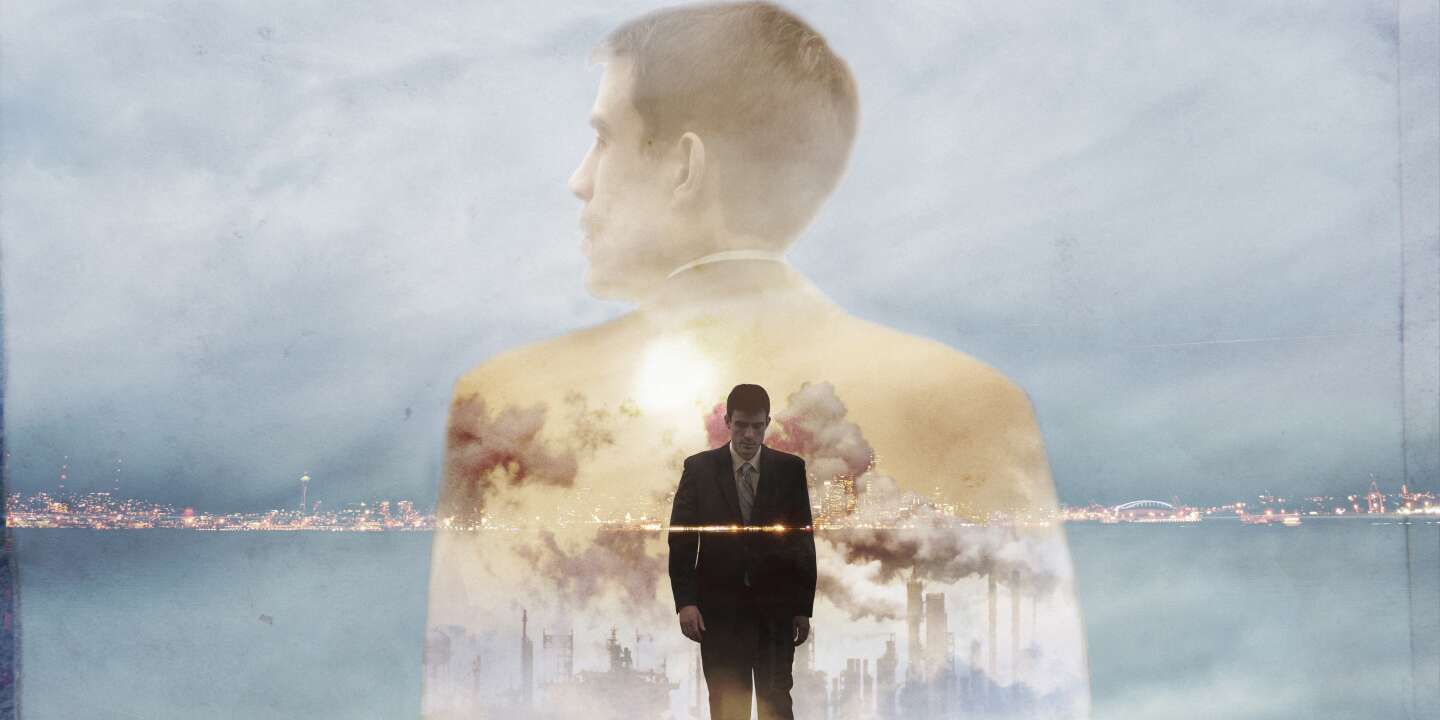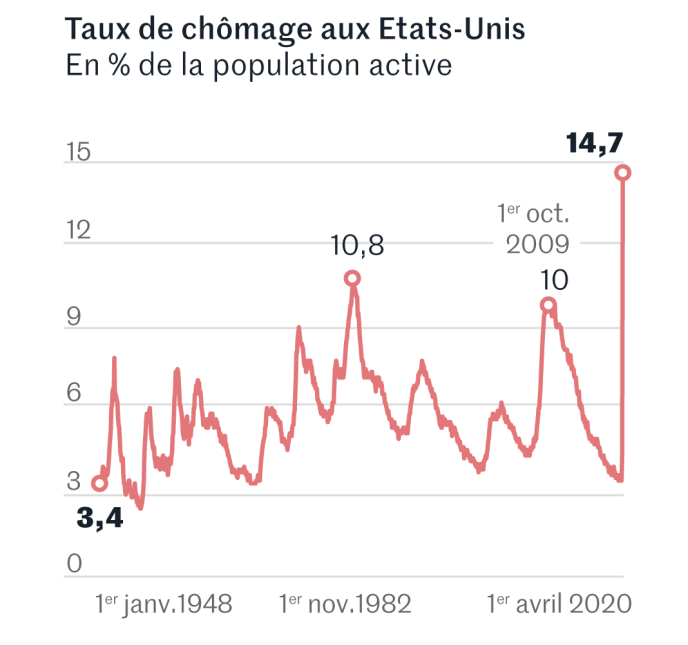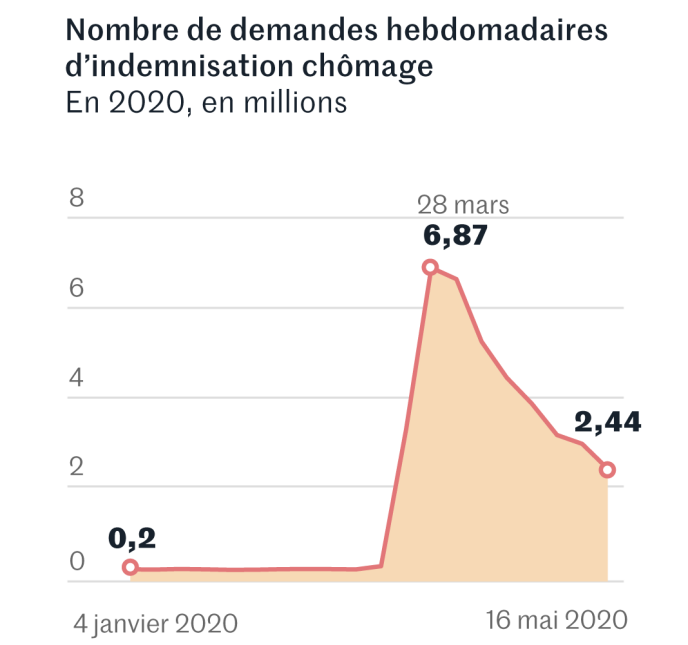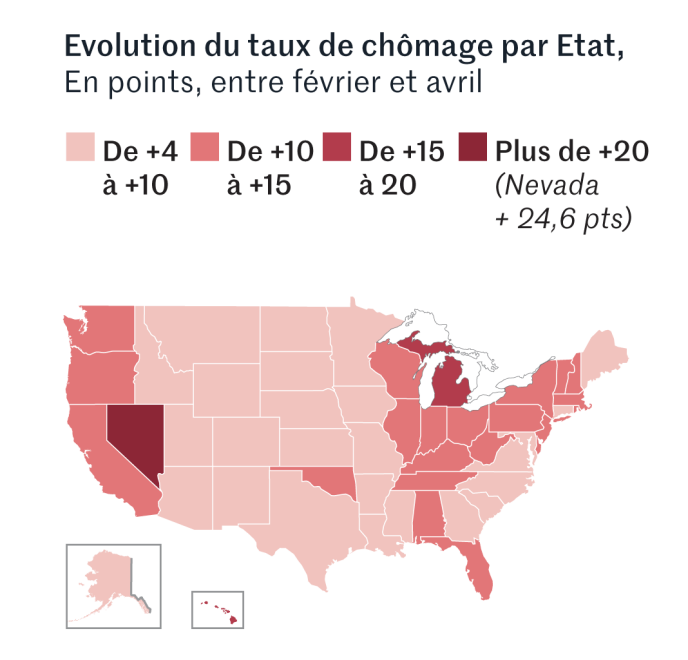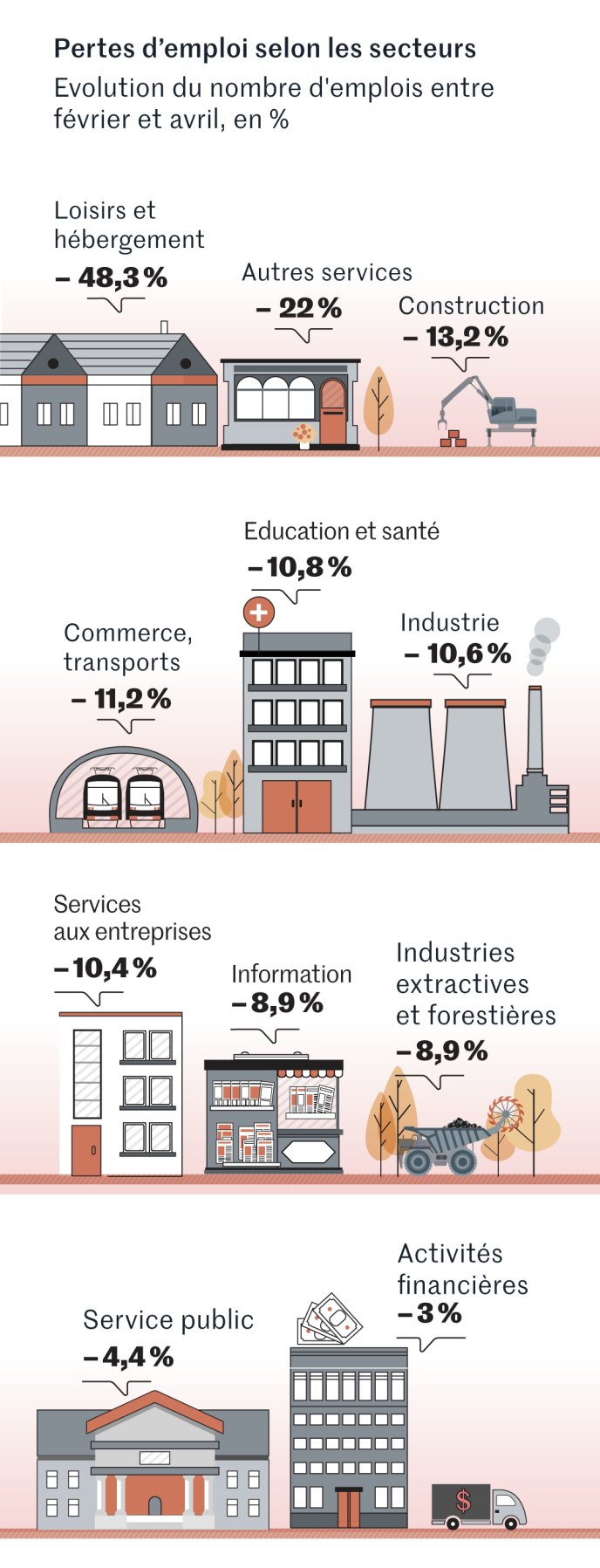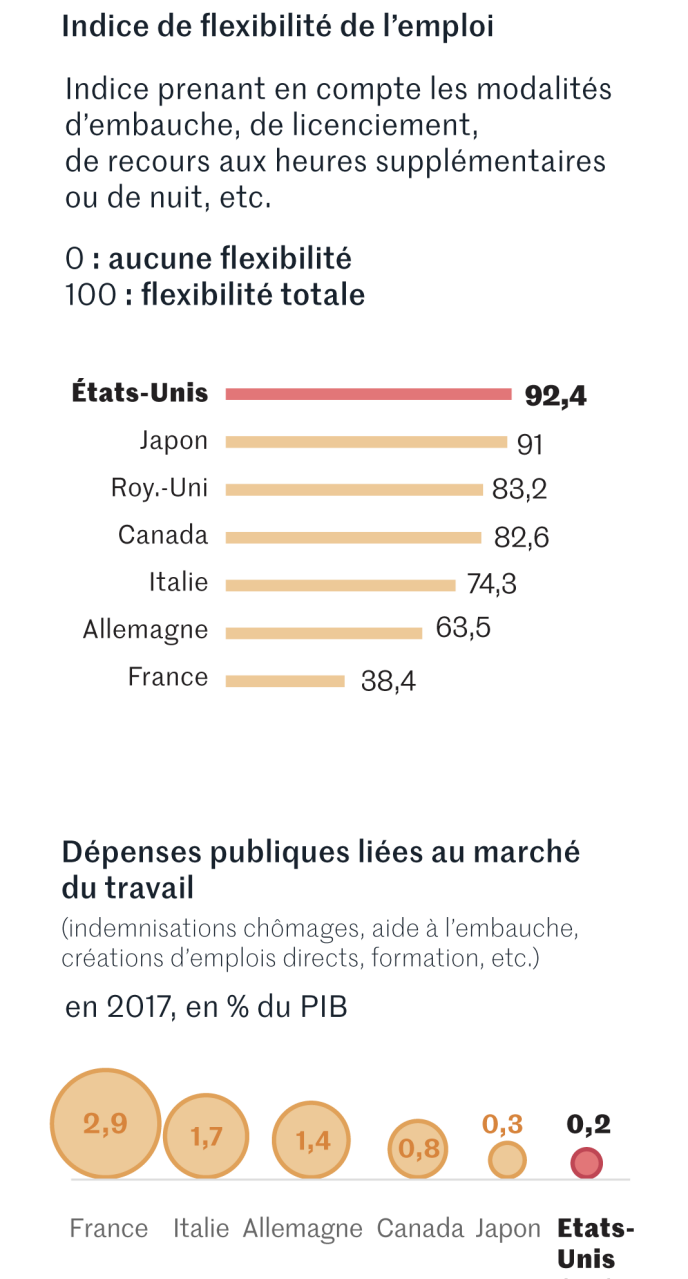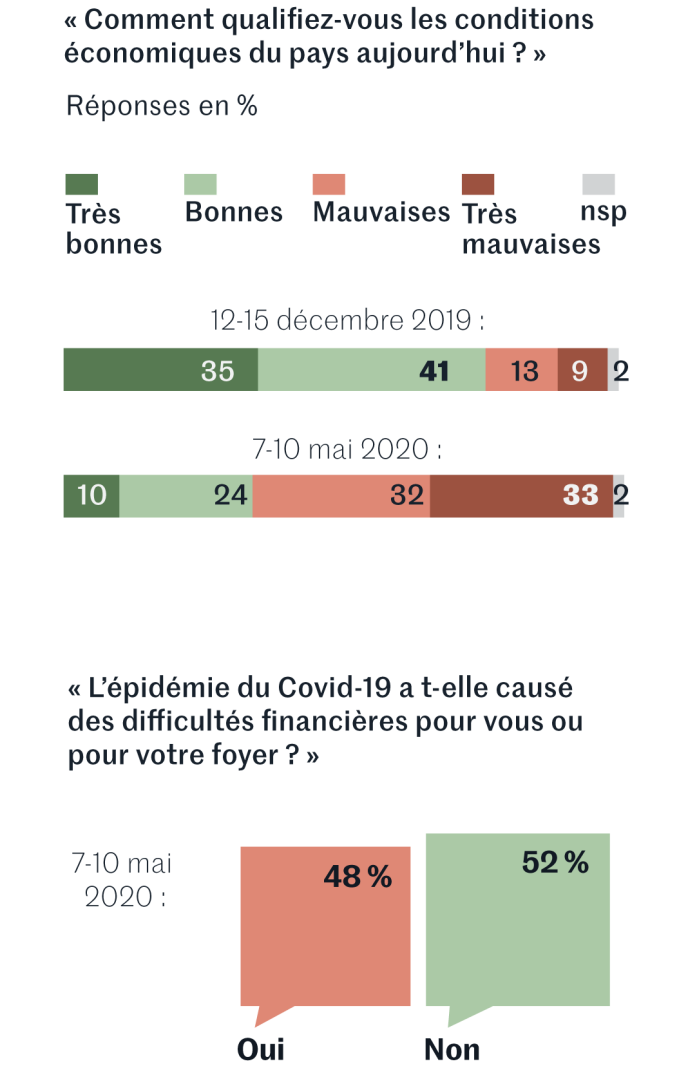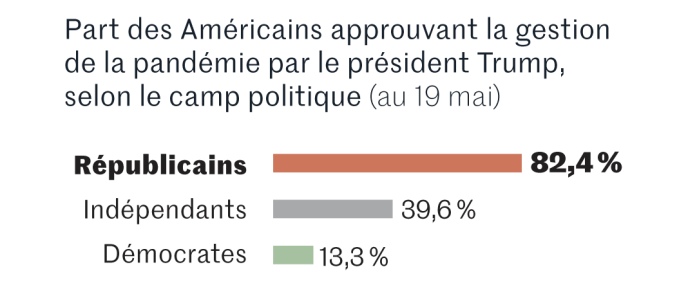Coronavirus : le coup de grâce pour « Grazia » ?

« Confiné.e.s mais ensemble, 100 idées pour tenir le coup dans la bonne humeur », titrait le magazine Grazia à la « une » de son édition datée du 27 mars au 9 avril. Volontariste, la formule encourageait un optimisme qui, au sein de l’équipe de l’hebdomadaire féminin, commençait déjà à s’étioler : le numéro 529 était un numéro double, censé rester deux semaines en kiosques au lieu d’une, le temps de prendre la mesure du confinement. Mais les jours qui ont suivi ont achevé de tarir les idées « pour tenir » et, à Grazia, la bonne humeur s’est ternie à mesure que grandissait l’inquiétude : cette parution aura-t-elle été la dernière ?
Car de numéro 530, il n’y en a toujours pas eu. Placés en télétravail au début du confinement, les salariés (une douzaine) ont été mis en chômage partiel total dès le 23 mars – mais n’en ont été officiellement informés que deux jours plus tard. Les autres collaborateurs, pigistes et prestataires extérieurs, ont été livrés à eux-mêmes, laissés soudainement sans revenus. Près d’un mois plus tard, le 22 avril, la direction du journal a envoyé un mail collectif pour informer d’une « suspension de l’activité sur le print [version papier] jusqu’à la fin de l’été » – et d’un maintien du chômage partiel. « Peut-on avoir une date précise ? » du moment où l’été s’arrête, a demandé la rédaction, réunie derrière une adresse e-mail commune, dans un message cinglant. Puis, sans s’encombrer de circonlocutions : « Devons-nous envisager un changement total de notre univers professionnel à titre collectif et individuel ? »
« Rien n’est encore prévu »
Plusieurs jours se sont encore écoulés avant que ne tombe la réponse de Germain Périnet, le directeur des activités presse & éditeur des marques chez Reworld Media (Grazia, Closer, Auto-Moto, Sciences & Vie, Biba, etc.) : « Comme vous le savez, leur a-t-il écrit le 7 mai, l’équation économique du titre est totalement dépendante des investissements publicitaires (…). A ce jour, nous n’avons aucune visibilité ni aucune garantie en provenance des marchés, à court et moyen terme, concernant la reprise des investissements publicitaires (…). Nous examinons actuellement les hypothèses, crédibles et pérennes, permettant d’envisager un retour de la marque Grazia en points de vente et pour nos abonnés. »
Depuis ce courriel, et malgré la formule « Vous serez naturellement informés de l’évolution de la situation », plus aucune communication n’a été faite aux équipes. Les lecteurs, eux, se seront contentés d’un message, en mars, les engageant à se créer un compte numérique pour « profiter de tous les avantages » de leur abonnement. Nos mails et appels à Germain Périnet, ainsi qu’aux codirigeants de Reworld Media, Gautier Normand et Pascal Chevalier, sont restés sans réponse.
Il vous reste 41.33% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.