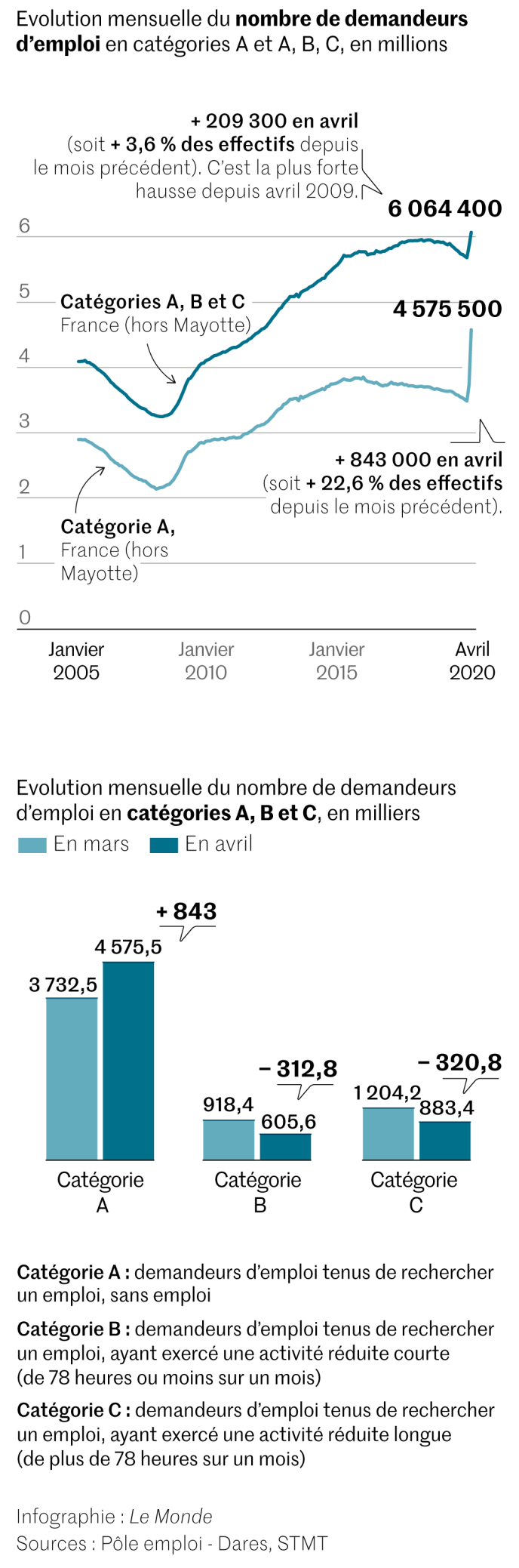« Le télétravail a changé radicalement de statut. Il est devenu un moyen pour les organisations de relever un défi existentiel »

Tribune. Le Covid-19 apparaîtra peut-être, dans les futures décennies, comme le catalyseur d’une révolution du travail. Nul ne sait prévoir les conséquences de la situation actuelle, mais le surgissement aussi inattendu qu’irrésistible du travail à distance constitue un fait majeur.
Nos agilités collectives et individuelles nous ont permis de continuer à exercer nos missions. Nous sommes des millions à avoir traversé le miroir du télétravail et commencé à explorer, telle Alice, un monde aux repères brouillés : le temps simultanément distendu et contracté, l’espace condensé, bien que virtuellemt ent sans limite, les objets aux fonctions et aux statuts nouveaux et imprévus, les interactions humaines systématiquement virtuelles.
Chacun s’est ainsi trouvé dans l’obligation, pour paraphraser Bruno Latour, de « réassembler son social », et de réinventer ses propres acteurs réseaux. Les effets saisissants de la crise sanitaire actuelle ne peuvent s’expliquer qu’en considérant que le virus n’a agi que comme un catalyseur particulièrement puissant d’une réaction entre trois réactifs préexistants.
Les trois réactifs
Le premier d’entre eux est l’intrication de nos sociétés. Cet enchevêtrement est le résultat de trois quarts de siècle de décisions géopolitiques constantes, portées par des infrastructures de mobilités de plus en plus performantes et des stratégies d’acteurs centrées sur la spécialisation internationale.
Le deuxième réactif est le niveau de maturité de nos infrastructures numériques. La combinaison d’un système universel de codage, de dispositifs individuels de plus en plus puissants, miniaturisés et bon marché, et de réseaux globaux de communication permet à des milliards d’individus d’être en liens permanents.
Le troisième réactif est le niveau sociétal de maturité d’usages de ces technologies. La dernière décennie a consacré la « mobiquité » des pratiques de consommation et la généralisation des usages : se distraire, gérer ses comptes, acheter, parier, s’informer…
La sidération a cédé la place à la résilience et à l’appropriation
Le Covid-19 est donc venu perturber cet agencement sociotechnique relativement stable, et l’un des produits de ces réactions en chaîne est la généralisation du télétravail. Les politiques publiques de distanciation ont en effet interdit les accès aux espaces physiques de travail. Après quelques décennies de léthargie, le télétravail est alors apparu comme le moyen de résistance à la crise.
La sidération a cédé la place à la résilience et à l’appropriation. En quelques jours, les directions informatiques ont assuré l’intendance et mis chaque acteur en situation de rester, autant que possible, professionnellement actif.
Il vous reste 52.84% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.