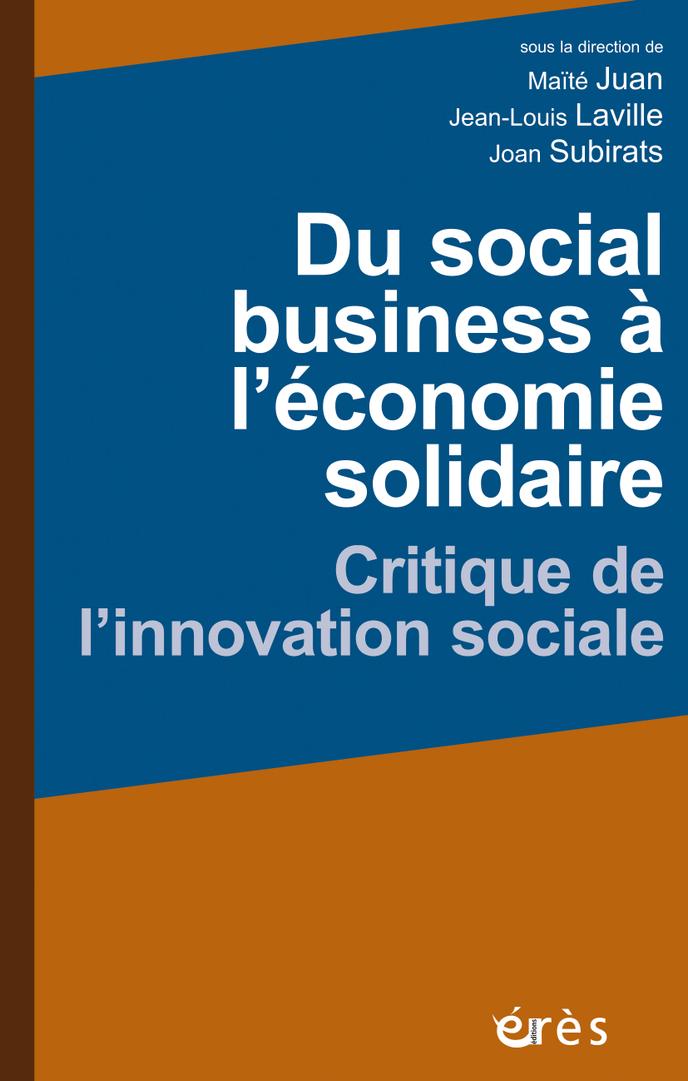Geoffroy Roux de Bézieux : « Le véritable plan de relance doit être massif »

Geoffroy Roux de Bézieux, président du Medef, plaide pour un plan de relance « massif » de la part du gouvernement, passant par un soutien à la compétitivité des entreprises, seul moyen, selon lui, pour que la crise économique ne se transforme pas en crise sociale.
Quand pensez-vous que la France retrouvera une activité économique « normale » ?
Il faudra sûrement de nombreux mois, ne serait-ce que parce que les mesures sanitaires vont peser sur l’offre comme sur la demande. Quand une chaîne automobile est nettoyée à chaque changement d’équipe, l’intervention prend une heure ou deux et la capacité de production diminue. Lorsqu’il y a moins de monde qui entre dans un magasin, le chiffre d’affaires baisse également. Plus globalement, malgré l’épargne forcée qui s’est constituée durant le confinement, il n’est pas du tout sûr que les consommateurs se précipitent pour dépenser tout de suite, car la question de la confiance dans l’avenir se posera.
Jugez-vous ces mesures sanitaires trop contraignantes ?
Je ne juge pas les mesures sanitaires, elles sont nécessaires. Mais ce qui est sûr, c’est qu’elles entraînent des surcoûts significatifs. Si ceux-ci sont temporaires, les entreprises pourront les absorber. Mais s’ils s’avèrent durables, une réflexion devra être conduite, car ils pourraient se traduire par un surcroît d’inflation qui ne sera pas supportable par tous les acteurs.
Que pensez-vous du choix de l’exécutif de commencer à réduire la voilure sur le chômage partiel dès juin ?
On ne peut pas avoir des millions de Français payés par la collectivité durant des mois. Mais commencer à diminuer le niveau de prise en charge le 1er juin serait une erreur majeure parce que, dans une quinzaine de jours, les entreprises tourneront encore à un rythme faible. Il faut maintenir en l’état le dispositif de chômage partiel jusqu’à l’été. Puis, à la rentrée, imaginer des mécanismes pour servir de passerelle afin de garder les effectifs et les compétences. Car si on arrête le chômage partiel, le risque, c’est le chômage tout court.
Faut-il augmenter la durée du travail ?
Je ne crois pas que la question se pose de manière générale. La situation des entreprises va être très différenciée selon les branches. Dans certains secteurs, la demande peut être soutenue, mais les contraintes sanitaires font que la productivité baisse : ce sont dans ces secteurs-là que la question du « travailler plus » peut se poser, mais elle ne peut l’être qu’avec les salariés et entreprise par entreprise.
Il vous reste 71.63% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.