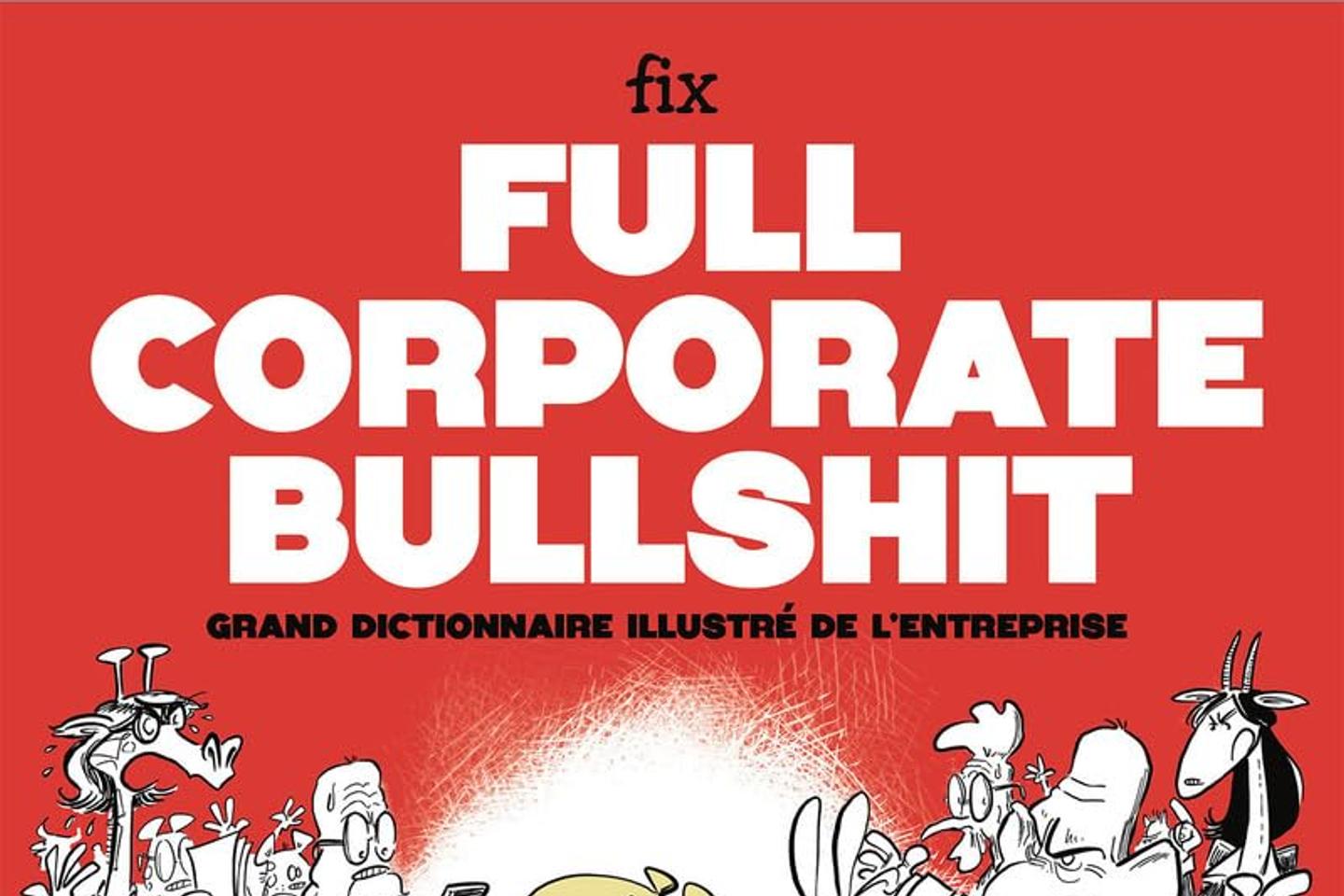Le taux de chômage stable à 7,5 % au deuxième trimestre, selon l’Insee

Le taux de chômage en France s’établit à 7,5 % au deuxième trimestre 2025, a rapporté, vendredi 8 août, l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), qui a aussi révisé, de 7,4 % à 7,5 %, le taux du premier trimestre.
Le taux de chômage reste donc « stable », selon l’Insee, qui précise que le nombre de chômeurs – au sens du Bureau international du travail (BIT) – augmente de 29 000 sur le trimestre, à 2,4 millions de personnes. Le taux de chômage de la population active française demeure ainsi « légèrement supérieur » à son point le plus bas depuis 1982, de 7,1 %, et inférieur de 3 points à son pic de la mi-2015.
Ce taux ne prend en compte que les chômeurs qui recherchent du travail et sont immédiatement disponibles sur le marché du travail. Il est calculé sur la base d’une enquête et ses résultats diffèrent des statistiques sur les demandeurs d’emploi inscrits à France Travail.
Le taux de chômage des jeunes à 19 %
Au deuxième trimestre, le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans diminue de 0,2 point par rapport au premier trimestre, mais reste élevé, à 19 %, et en augmentation de 1,2 point sur un an. Le taux de chômage des seniors de 50 ans et plus reste stable sur le trimestre à 4,8 % et inférieur de 0,2 point par rapport au deuxième trimestre 2024. Celui des 25-49 ans augmente de 0,2 point sur le trimestre et de 0,3 point sur un an à 6,9 %.
Le taux de chômage des femmes est « quasi stable » (− 0,1 point), à 7,3 %, tandis que celui des hommes augmente de 0,2 point, à 7,7 %.
Le halo autour du chômage, constitué des personnes qui souhaitent un emploi mais n’en recherchent pas ou ne sont pas immédiatement disponibles, atteint 1,9 million de personnes, soit 4,4 % de la population des 15-64 ans. Il augmente légèrement sur le trimestre, de 21 000 personnes, mais diminue de 51 000 personnes sur un an.
Enfin, le taux d’emploi continue de progresser, quoique très légèrement, au deuxième trimestre, atteignant 69,6 %, son plus haut historique depuis que l’Insee a commencé à le mesurer en 1975. Il est 0,5 point au-dessus de son niveau du deuxième trimestre 2024.