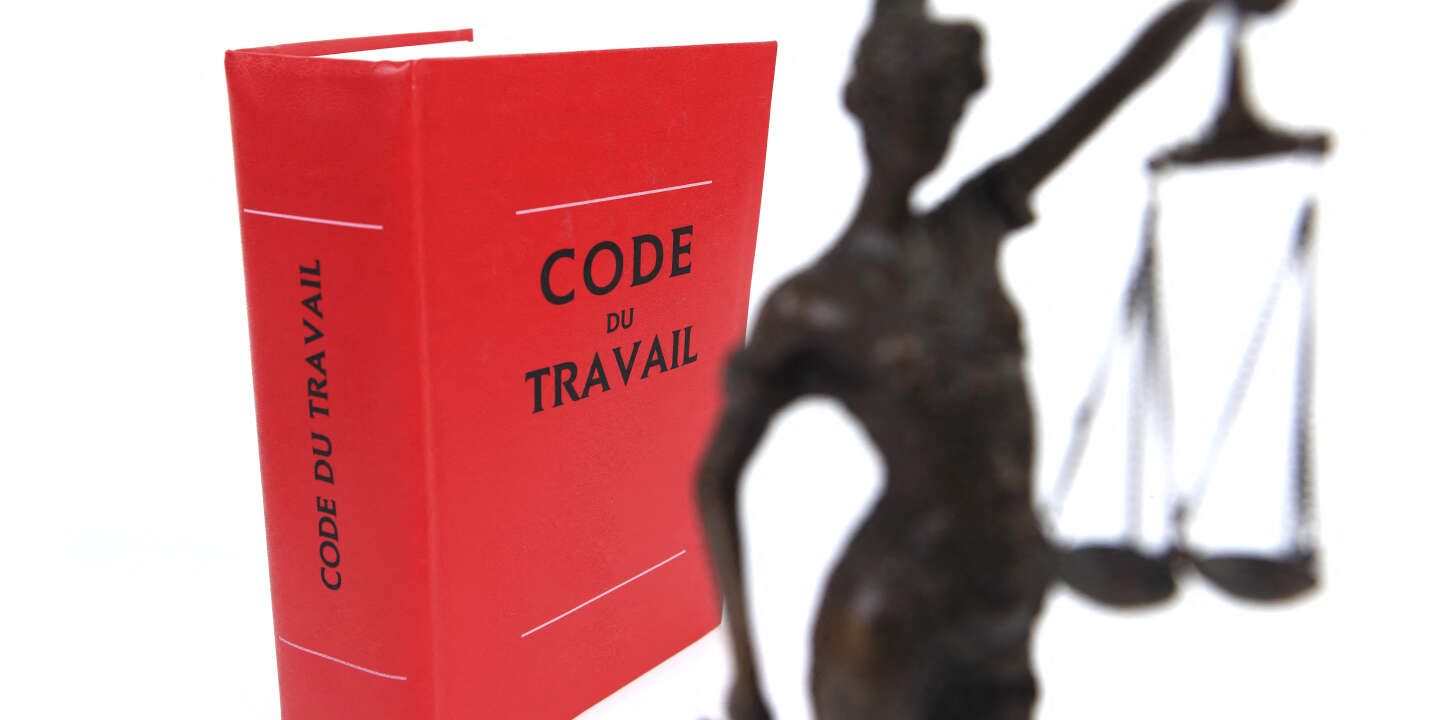Ex-Whirlpool d’Amiens : le gouvernement annonce un audit sur l’utilisation de l’argent public
Des salariés de WN, le repreneur de Whirlpool, ont manifesté la semaine dernière à Amiens leur « colère » et leurs « inquiétudes » quant à leur avenir professionnel.

Le gouvernement va mener un audit afin de vérifier « la manière » dont WN, le repreneur de l’ancienne usine Whirlpool d’Amiens, a « utilisé l’argent public » alloué il y a un an, a annoncé jeudi 18 juillet Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie.
« Il y a des interrogations sur la manière dont l’argent public a été utilisé (…) Nous avons décidé de lancer un audit sur cet argent public et nous ferons une restitution aux salariés en priorité en plénière le 25 juillet prochain », a-t-elle déclaré en sortant d’une « réunion de suivi » à la préfecture de la Somme, à Amiens, avec notamment des représentants des salariés et des élus locaux. Et d’ajouter :
« Je n’ai pas d’idées préconçues sur ce que l’on trouvera », mais « justifier cet argent, ce sera une façon pour l’ensemble des salariés de passer à autre chose. Parce qu’aujourd’hui il y a de la défiance, il y a du soupçon (…) Si cet argent a été employé de manière tout à fait normale, c’est bien de le savoir (…) et si cet argent a été utilisé à des choses qui ne sont pas correctes, c’est bien de le savoir aussi » et qu’il y ait « des suites ».
« Vous avez quand même des salaires à payer. La masse salariale, c’est 550 000 euros par mois grosso modo, donc, en dix mois vous avez déjà 5 millions et demi qui sont expliqués. Après, les investissements, les stocks, la recherche, la prospection commerciale, ce sont ces éléments-là que l’on doit mettre en visibilité », a-t-elle détaillé.
Redressement judiciaire
Des salariés de WN, le repreneur de Whirlpool, placé en redressement judiciaire, ont manifesté la semaine dernière à Amiens leur « colère » et leurs « inquiétudes » quant à leur avenir professionnel.
En mai 2018, l’industriel picard Nicolas Decayeux avait repris 162 des 282 ex-salariés de Whirlpool. Son entreprise, la société WN, devait alors se lancer notamment dans la production de casiers réfrigérés connectés et la fabrication de chargeurs de batteries pour vélos et voitures, mais elle se trouve aujourd’hui dans une impasse de trésorerie, faute de débouchés commerciaux concrets.
Elle a été placée en redressement judiciaire le 3 juin, avec une période d’observation de six mois. Les candidats à la reprise du site ont jusqu’au 23 juillet pour déposer leur offre.