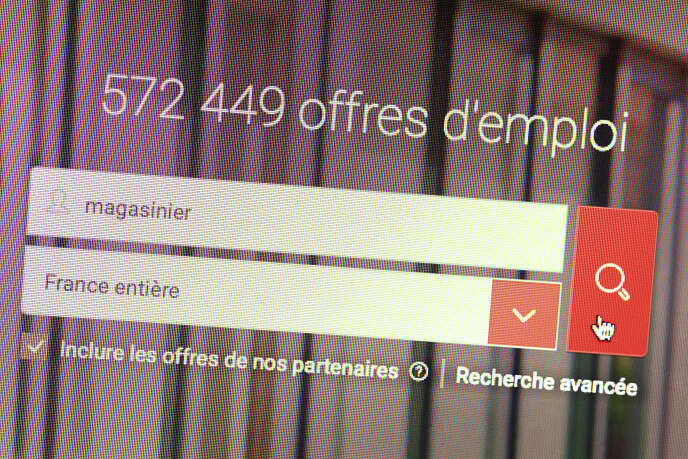De l’échec scolaire au secteur de la propreté, le grand nettoyage d’Hélène
Deuxième Chance (1/6). Après plusieurs formations avortées, la jeune Bretonne est passée par un établissement pour l’insertion dans l’emploi (Epide). Et s’est réalisée dans un domaine sur lequel elle n’aurait pas parié : le nettoyage.
Article réservé aux abonnés

Dans la cour d’un ancien lycée agricole délabré, une quarantaine de jeunes en uniforme bleu marine et rouge se tiennent au garde-à-vous, en rangs serrés. Autour, c’est la forêt armoricaine, il n’y a rien à part une maison de retraite de pères salésiens. Pas de 4G ni de Wi-Fi, et la bretelle vers la route de Guingamp est à plusieurs kilomètres. Bienvenue à l’établissement pour l’insertion dans l’emploi (Epide) de Lanrodec, dans les Côtes-d’Armor. Dans cet internat rural et spartiate, des jeunes sans diplôme ni emploi viennent chercher, pendant quelques mois, un cap pour leur vie.
Hélène Da Costa y a passé une bonne partie de l’année 2014. Fin mai, nous nous sommes y rendus avec la jeune femme, aujourd’hui âgée de 24 ans. A l’heure du déjeuner, la directrice de l’Epide, Laurence Zellner, a rendu hommage à sa trajectoire, devant l’assemblée des pensionnaires alignés sous les paniers de basket. Puis Hélène a pris la parole. « Je vais vous raconter un truc. Quand je suis arrivé à l’Epide, j’ai dit à ma conseillère : “Je ne nettoierai jamais la merde des autres.” Aujourd’hui, je passe mes journées à faire ça. » Gloussements dans les rangs. Hélène a appris à en rire. Dans le monde de l’hygiène et du ménage, cette jeune femme a trouvé sa voie, mais aussi une source de fierté. « C’est pas dégradant, au contraire. »
« Vous avez frôlé la perfection »
En 2016, elle remportait le titre national de Meilleure apprentie dans le domaine de la propreté, au concours organisé par la Société des meilleurs ouvriers de France. Un souvenir fantastique, et de belles tranches de rigolade dans la Clio de Gwezennec, le formateur qui transportait la petite équipe sur le lieu de la finale, à Périgueux. Hélène devait laver de fond en comble trois pièces en un temps limité. Verdict du jury : « Vous avez frôlé la perfection. »
« Les sols, direct, je sais ce qu’il leur faut. Les gens disent que je suis la fille qui murmure à l’oreille des sols. » La jeune femme – queue-de-cheval, baskets, blouson en cuir et bijoux fantaisie – sort son téléphone, et montre des photos d’une chambre d’hôpital, impeccable. C’est propre, ça brille. Ses responsables l’en félicitent. Et ça lui fait du bien. « Je me dis : c’est grâce à moi, que je n’ai pas servi à rien. »
Nettoyer des sols, rafraîchir des chambres, et désormais orchestrer une équipe d’agents chargés du ménage : c’est ce que fait Hélène de 5 h 30 à 12 heures, au CHU de Rennes. Au contact des malades, « qui se confient à nous parce qu’ils savent qu’on va pas les embêter avec des piqûres ou des médicaments », Hélène a découvert une sensation qui lui manquait dans sa vie : « la douceur ». « Maintenant, quand quelqu’un me parle mal, je ne lui en veux pas. »