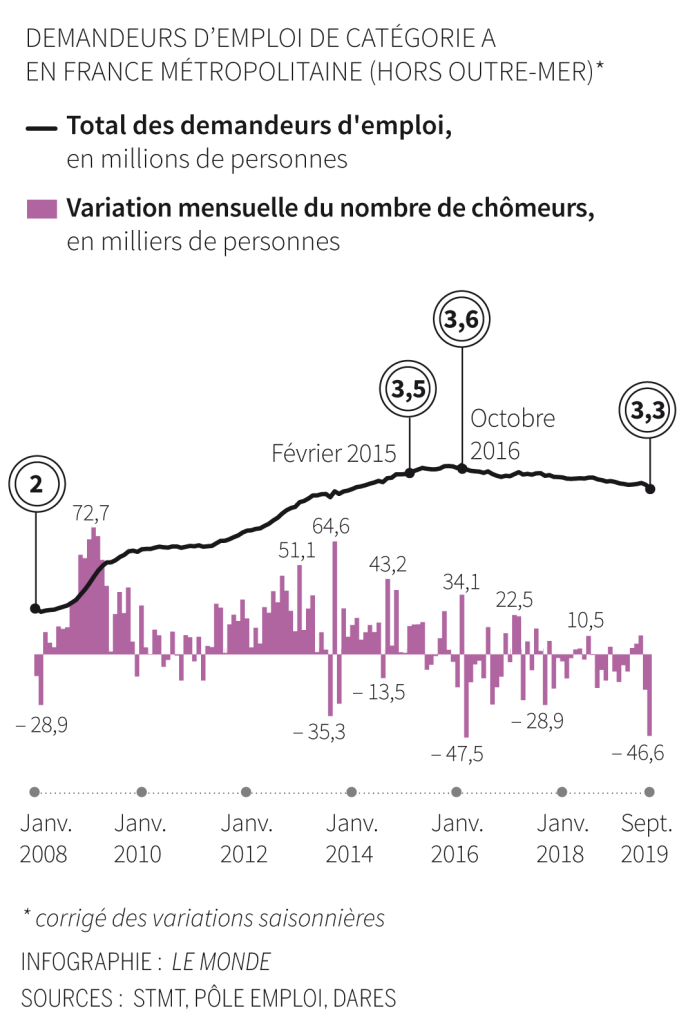Article réservé aux abonnés
Deux ans après avoir été présenté par le premier ministre Edouard Philippe, le plan d’investissement dans les compétences (PIC) est sur le point d’atteindre sa vitesse de croisière. Cet ambitieux programme, financé à hauteur de 15 milliards d’euros, a vocation à s’attaquer au noyau dur du chômage : il prévoit de former, entre 2018 et 2022, un million de demandeurs d’emploi peu qualifiés et un million de jeunes sans qualification. Un chantier colossal coordonné par un haut-commissaire, Jean-Marie Marx : le dispositif associe de multiples acteurs, au premier rang desquels les régions, qui disposent de prérogatives fortes en matière de formation continue, et Pôle emploi.
Après une première phase dite d’« amorçage », le PIC est entré dans le vif du sujet en 2018. Cette année-là, « environ 200 000 entrées en formation ont pu être réalisées dans le cadre du plan », affirme M. Marx. L’objectif est de doubler ce chiffre en 2019 : « Nous sommes sur le point de l’atteindre », assure le haut-commissaire. Pour les exercices suivants (de 2020 à 2022, donc), il table sur un flux annuel d’environ 450 000.
« Changement assez durable »
Parmi les bénéficiaires, il y a notamment des allocataires du RSA, des personnes en rupture avec le monde du travail et des jeunes à la recherche d’un poste, qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi. A ces publics fragiles sont, le plus souvent, proposées des formations longues et des formations certifiantes, afin de leur garantir, autant que possible, une insertion professionnelle de long terme. L’accent est mis sur le numérique, à la fois sur le plan de la méthode (cours à distance) mais aussi dans le contenu des enseignements (utilisation d’outils digitaux).
Le plan s’est déployé avec le concours de la plupart des conseils régionaux. Seuls deux d’entre eux n’ont pas conclu de pacte avec l’Etat : Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Dans ces territoires, c’est Pôle emploi qui assure la mise en œuvre du PIC.
Cet ambitieux programme prévoit de former, entre 2018 et 2022, un million de demandeurs d’emploi peu qualifiés et un million de jeunes sans qualification
« Mon sentiment est positif et largement partagé par d’autres », confie David Margueritte, élu (LR) de Normandie chargé du dossier à Régions de France, l’association qui regroupe les conseils régionaux. « Contrairement au plan 500 000 formations pour les chômeurs, engagé sous le quinquennat précédent, on n’est pas dans une logique quantitative, de remplissage », estime-t-il. D’après lui, les collectivités qui ont signé une convention avec l’Etat disposent d’une grande liberté de manœuvre pour définir les actions, que ce soit sur les modalités pédagogiques ou sur les aides à apporter aux stagiaires. Un exemple, parmi beaucoup d’autres : pour « accrocher » le public-cible, fréquemment en butte à des difficultés pour se déplacer, « nous avons augmenté [en Normandie] la prise en charge des frais de transport », rapporte M. Margueritte.