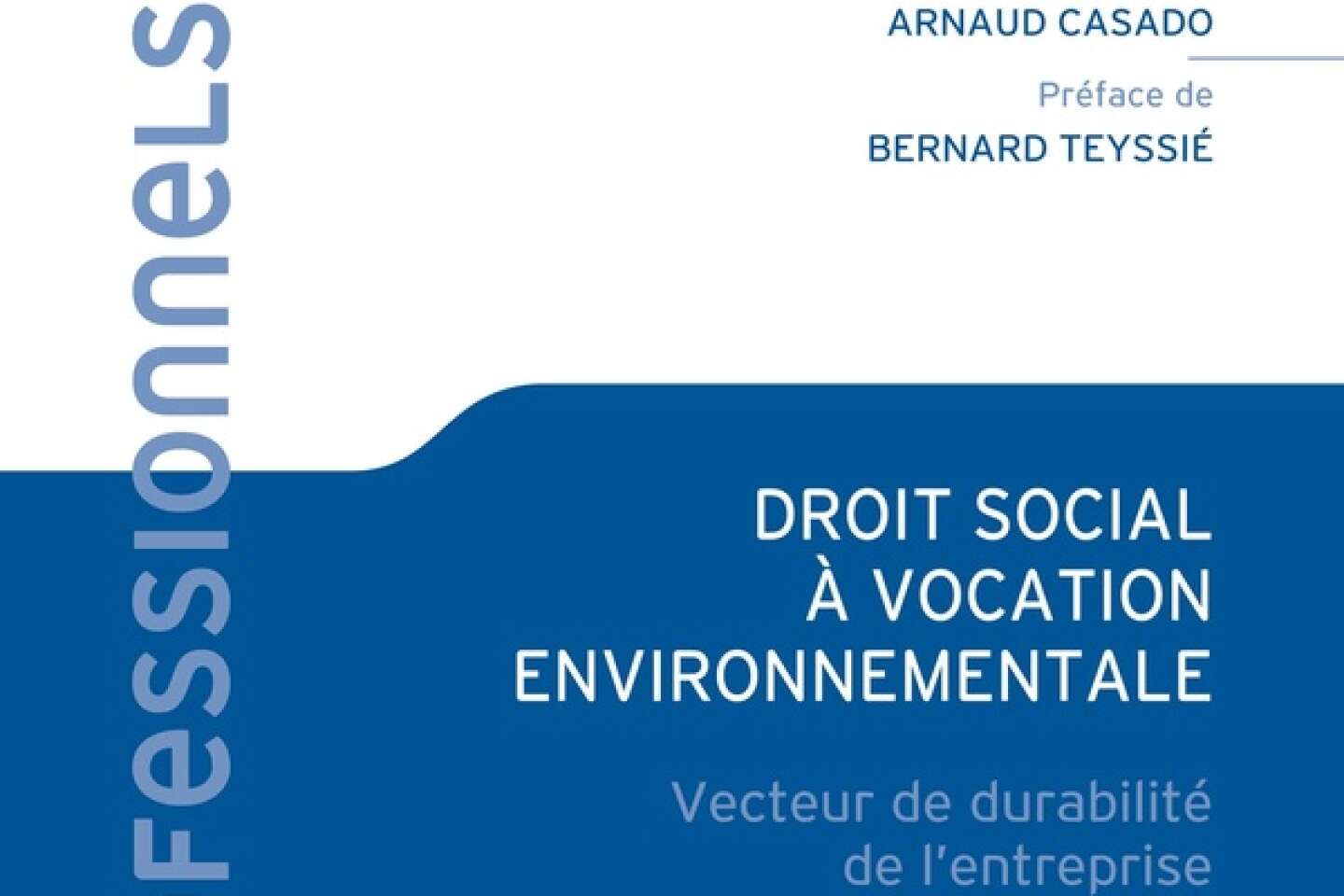« Les Politiques locales de l’économie sociale et solidaire » : la progression à pas feutrés d’un modèle de proximité

« Même dans la ruralité, quand un maire vous dit qu’il aimerait bien installer un commerce, quand on lui parle d’ESS (économie sociale et solidaire), il dit “non, moi je veux un vrai commerce” », note Bénédicte Messeanne-Grobelny, vice-présidente du conseil départemental du Pas-de-Calais, chargée notamment de l’ESS. De son côté, Patricia Andriot, conseillère communautaire en Haute-Marne, explique que « [ses] collègues élus continuent de voir l’ESS comme un concept militant connoté plus que comme un vrai levier d’action territorial ».
Dans l’ouvrage Les Politiques locales de l’économie sociale et solidaire (Erès), un ensemble de chercheurs, menés par les sociologues Laurent Fraisse et Jean-Louis Laville et la directrice de l’association Cose Comune, Marie-Catherine Henry, ont souhaité donner la parole à des élus chargés du dossier de l’ESS afin de comprendre, au plus près du terrain, sa place et les dynamiques qui l’animent. Plusieurs de ces acteurs de terrain se décrivent en Sisyphe de l’ESS, devant sans cesse convaincre.
Ils doivent ainsi faire inlassablement preuve de pédagogie afin de démontrer tout le sérieux de structures de l’ESS, parfois peu identifiées dans le paysage économique local. « On fait de l’ESS sans le savoir », souligne Patricia Andriot, qui constate que « dans notre territoire rural, elle [regroupe] une part importante des services à la population : petite enfance, culture, insertion… Je pense que cela représente 14 % des emplois, sans que ce soit très lisible ».
Champs d’intervention élargis
C’est tout le paradoxe de l’ESS : présente dans le quotidien des populations, elle reste souvent mal identifiée par ces dernières. Pourtant, la donne a considérablement changé en une trentaine d’années, précise l’ouvrage, avec une montée en puissance de l’économie sociale et solidaire dans les politiques menées par les collectivités locales. C’est d’ailleurs là l’un des apports principaux de cet essai : il livre une étude précise des dynamiques à l’œuvre sur le terrain, en s’intéressant aux élus chargés de l’ESS.
Les auteurs observent « une progression continue du nombre [de ces] élus » – progression certes inégalement répartie sur le territoire. Le portage des politiques ESS a eu tendance à se « diversifier », de la gauche de l’échiquier politique vers sa droite, notent-ils. « L’alternance à droite constitue [toutefois] un risque de rupture dans le soutien des collectivités. »
Dans le même temps, les champs d’intervention se sont élargis. Souvent tournée vers l’insertion professionnelle, l’économie sociale et solidaire a progressivement conquis de nouveaux terrains : alimentation, valorisation des déchets, réemploi des équipements numériques, logistique urbaine…
Il vous reste 31.54% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.