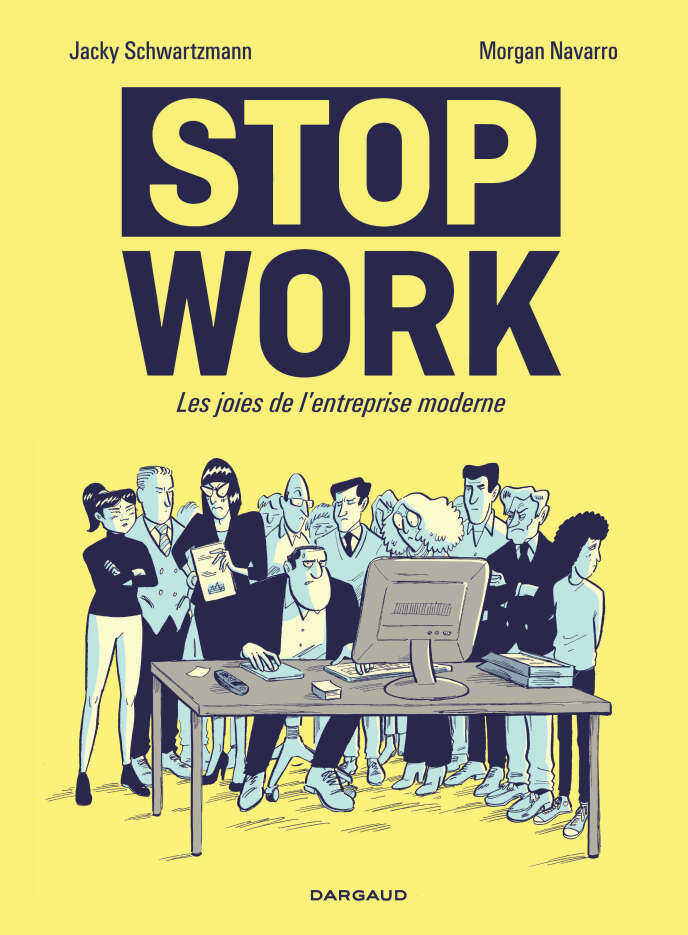« En empêchant l’entrée de nouveaux immigrants, Trump pénaliserait l’économie américaine »

La crise liée à la pandémie risque de creuser encore les écarts de salaires entre les travailleurs très qualifiés et peu qualifiés, prévient Jennifer Hunt, professeure d’économie à l’université Rutgers (Etats-Unis), intervenant aux rencontres « d’Aix en Seine », qui se sont tenues du 3 au 5 juillet à Paris.
Ancienne chef du département américain du Travail (2013–2015) passée par le Trésor américain, cette spécialiste de l’immigration estime également qu’en fermant partiellement ses portes aux travailleurs étrangers, l’économie américaine serait durablement affaiblie.
Quelles séquelles cette crise laissera-t-elle, à long terme, sur les marchés du travail ?
Cela dépend des pays et il est encore trop tôt pour le dire. Mais une chose est sûre : les cicatrices seront probablement plus marquées dans ceux qui, au moment où la pandémie a frappé, n’avaient pas encore retrouvé leur niveau de production d’avant la récession de 2008, comme l’Italie.
Le chômage partiel a protégé des millions d’emplois pendant le confinement en Europe. Sa prolongation ces prochains mois pourrait également contribuer à maintenir des emplois qui, sans la crise, auraient disparu. Est-ce un problème ?
Ces mécanismes ont été efficaces pour permettre aux entreprises de conserver leurs salariés, leur éviter d’avoir à s’en séparer pour tenter de les réembaucher plus tard.
Si en raison d’un rebond de la pandémie, ces dispositifs se prolongent au-delà d’un an, il y a un petit risque : celui de voir l’Etat subventionner des anciennes façons de travailler, de maintenir des emplois peu appareillés au regard des évolutions de l’organisation technique. Mais ce risque reste largement secondaire et limité au regard des coûts qu’un chômage de masse engendrerait.
La hausse du chômage dans les économies avancées va-t-elle se traduire par une nouvelle augmentation des inégalités ?
En termes salariaux, l’écart risque en effet de se creuser encore entre les travailleurs très qualifiés et les peu qualifiés. Ces derniers sont plus durement pénalisés pendant les récessions, car ils occupent des emplois plus fragiles. En outre, le travail à distance a bien souvent été impossible pour eux pendant le confinement.
Ajoutons que la récession actuelle est différente de la précédente à bien des égards. Celle de 2008 avait frappé en premier lieu les hommes, surreprésentés dans les secteurs de l’industrie et de la construction. Cette fois, les femmes, plus nombreuses dans le tourisme, l’hôtellerie-restauration et le commerce de détail, sont les premières affectées – du moins, jusqu’ici.
Il vous reste 59.94% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.