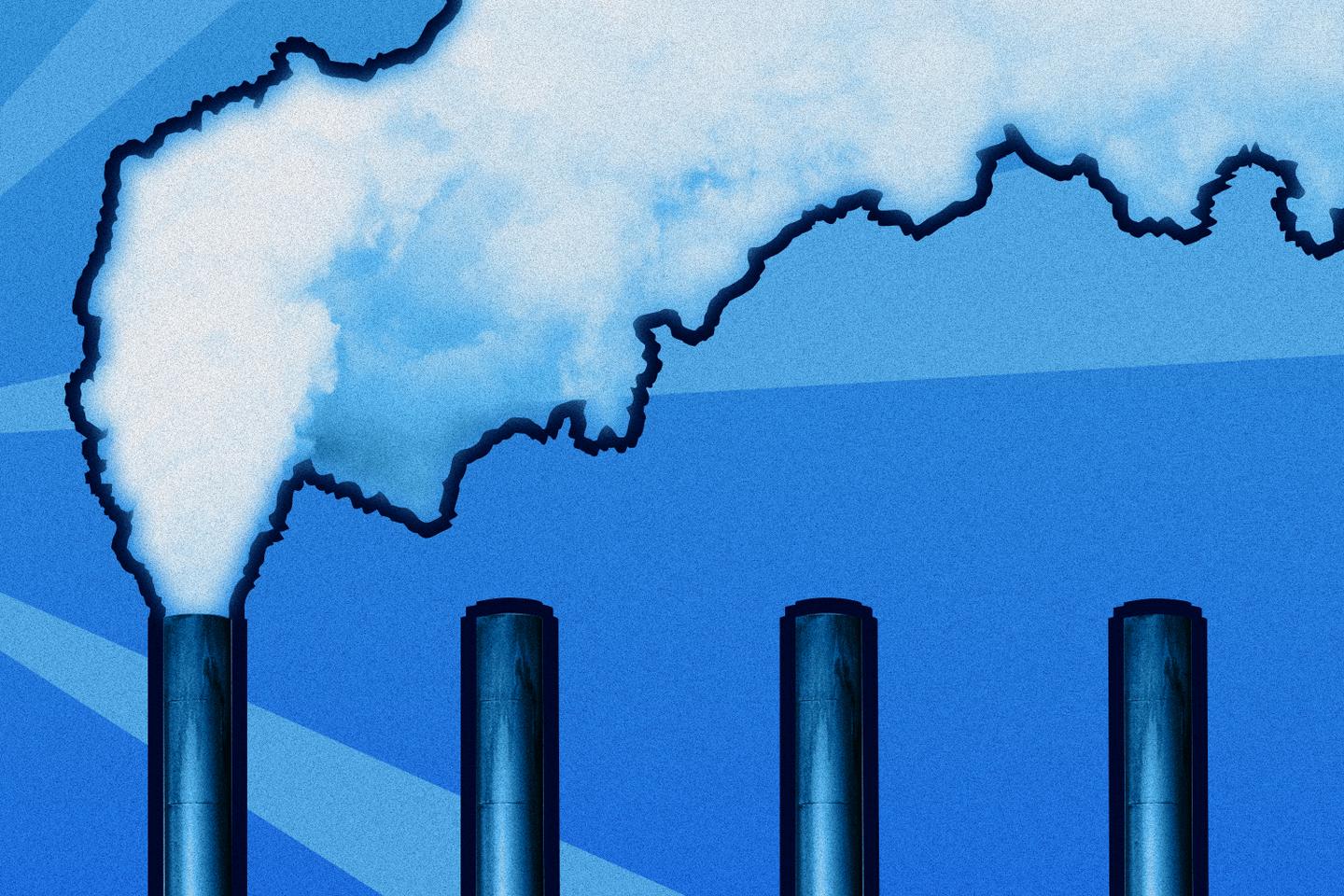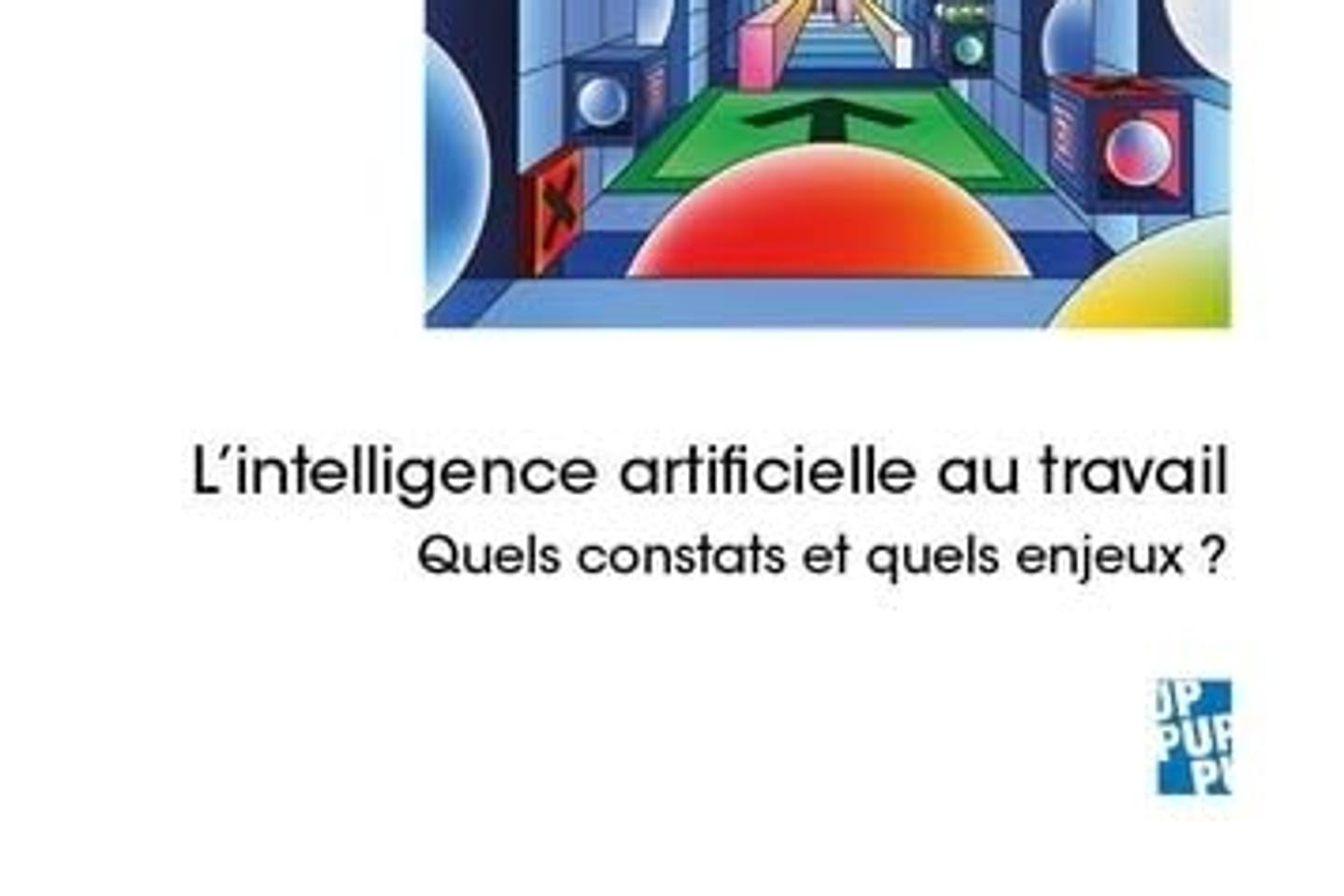Les stratégies de séduction du secteur public pour attirer les cerveaux de la tech

En septembre 2025, les réseaux sociaux de l’armée de terre sont piratés, et les internautes sont appelés à enquêter pour « retrouver la trace du hackeur ». C’est du moins ce qu’a fait croire une campagne de recrutement de l’armée de terre mise en scène par leurs responsables des ressources humaines. Au terme d’un mois de « cybertraque », un soldat propose aux participants, face caméra, de continuer à « contrer les menaces » en rejoignant les rangs, promettant « action, entraide et dépassement de soi ».
Certains ministères redoublent ainsi de créativité pour attirer les profils du numérique. La famille professionnelle de l’informatique et des télécommunications appartient, depuis 2016, aux 10 % de métiers les plus tendus, selon l’Insee. Porté par la numérisation accélérée des biens et services, le secteur est celui « qui résiste le mieux » à la baisse généralisée des offres d’emploi, mais c’est aussi celui qui enregistre « le plus bas nombre de candidatures par offre en 2025 », souligne Lisa Feist, économiste pour la plateforme Indeed. Avec l’évolution rapide des technologies et des compétences, les candidats qualifiés se font rares, et les employeurs peinent à pourvoir des postes-clés. La demande reste importante, comme en témoigne l’annonce, le 9 janvier, par Thales, du recrutement de 9 000 personnes dans le monde, dont 3 300 en France en 2026, notamment à des postes d’ingénieurs.
Il vous reste 76.88% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.