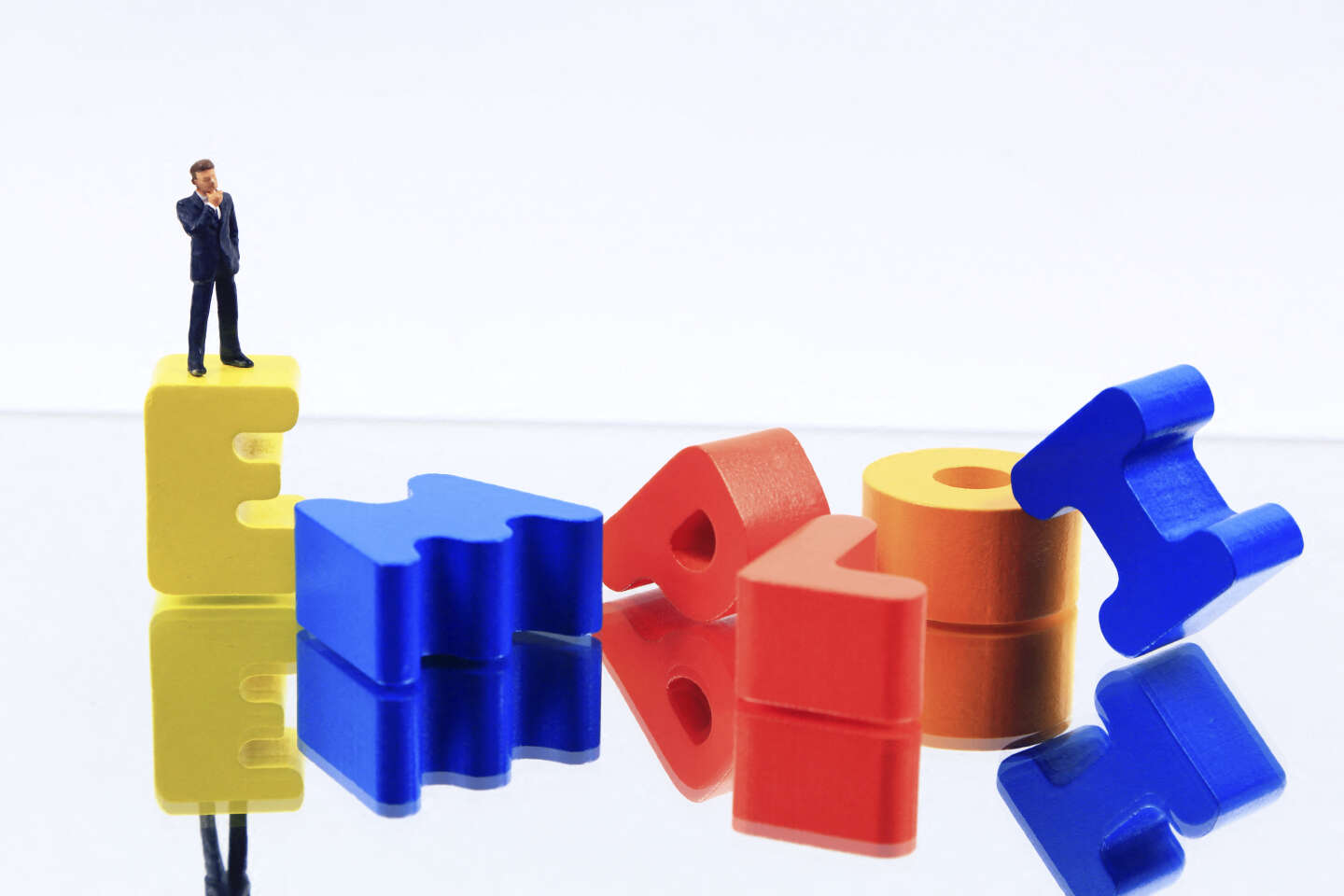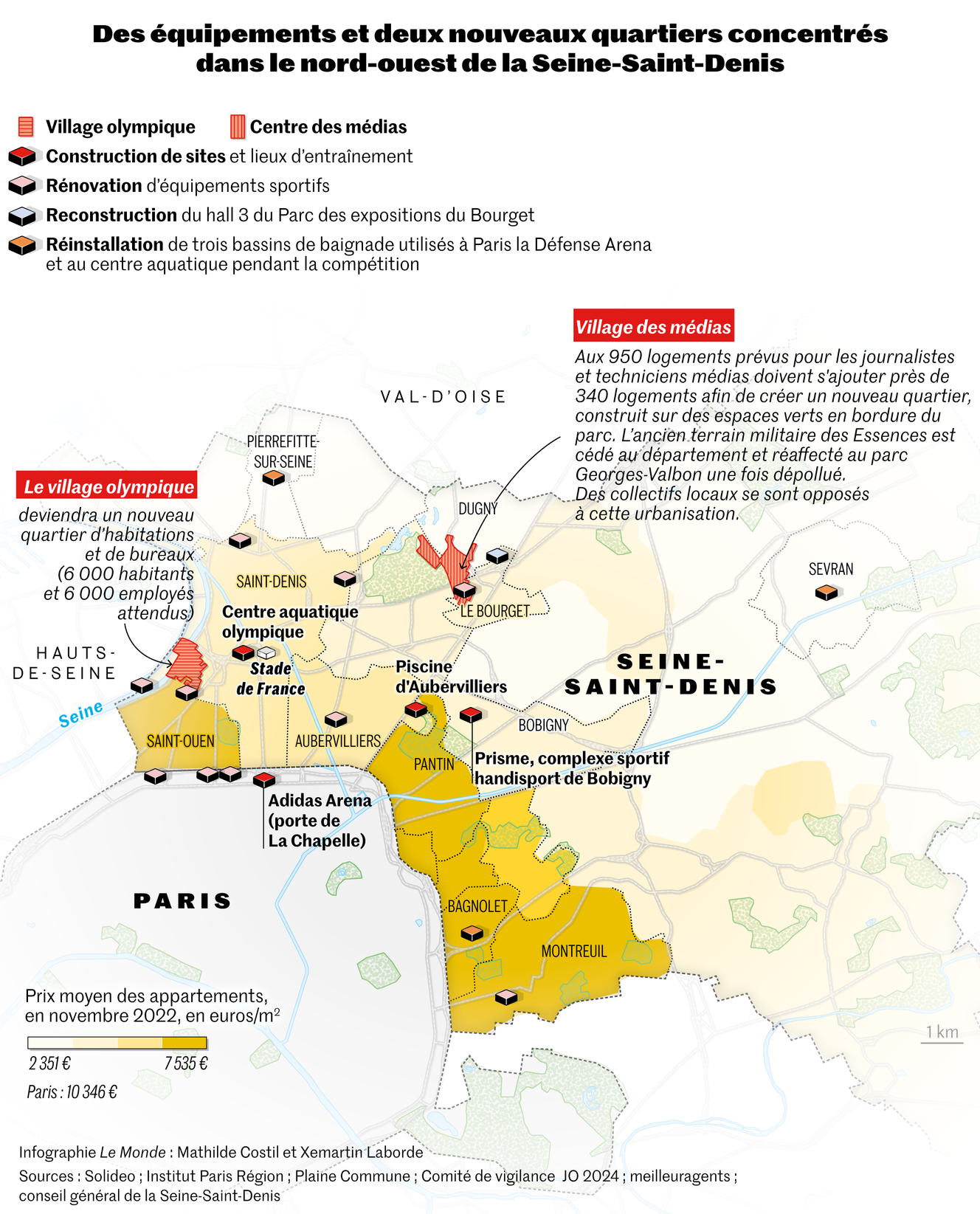Les Etats-Unis reprennent goût à l’usine

L’entrepreneur en série, Ken Rosenblood, patron d’obVus Solutions, était en Chine en 2019. Ce patron américain voulait y produire des bureaux ergonomiques qu’on peut utiliser assis ou debout. Il avait passé commande pour deux conteneurs, capables de transporter 16 000 unités. Et puis il a entendu parler du Covid-19. Son fournisseur a fermé ses portes… et les a rouvertes en mars. M. Rosenblood espérait alors récupérer sa commande. Mais ce fut plutôt « le début de la grande odyssée », s’amuse-t-il.
Le dirigeant, qui aime tout contrôler, a suivi le trajet de ses conteneurs sur l’océan. Un jour, on lui disait qu’ils étaient « à Shanghaï en partance vers le Vietnam. Ensuite, c’était Pékin et la Corée du Sud ». Puis les prix du transport ont explosé. Le coût du conteneur a été quasiment décuplé, de 2 500 dollars avant la crise à 20 000 dollars. Celui du travail et des matières utilisées a lui aussi grimpé.
M. Rosenblood s’est dit qu’il serait plus judicieux de produire aux Etats-Unis, en automatisant au maximum la production pour réduire le coût du travail, comparativement très cher aux Etats-Unis. Il a acheté des machines en Chine, converti un showroom en usine à Rochester dans l’Etat de New-York et trouvé des fournisseurs… bref, il a organisé la production des trois cents composants de son bureau. Il emploie aujourd’hui quinze personnes dans son usine. L’écart de coûts entre l’Asie et les Etats-Unis s’est réduit à 10 %. Et il fabrique en trois semaines ce qui serait arrivé de Chine six mois plus tard.
Gros coup de pouce de Washington
Ce retour de la production aux Etats-Unis n’a pas été facile, mais évite les ruptures de stocks. Et permet de servir la clientèle américaine plus rapidement. Un choix qu’obVus Solutions n’est pas la seule entreprise à avoir fait. Un nombre croissant de groupes américains et étrangers s’installent sur le sol de l’Oncle Sam.
Scott Paul, président de l’Alliance for American Manufacturing (« alliance pour la production américaine »), constate la montée en puissance des projets locaux, s’appuyant sur les aides financières fédérales. Les lois sur la réduction de l’inflation, l’énergie propre et l’industrie des semi-conducteurs ont permis de lancer des investissements milliardaires à long terme.
Ici le groupe First Solar s’installe en Alabama pour produire de l’énergie solaire en 2025. Sept cents emplois sont annoncés. Là, c’est Micron qui plante son drapeau à New-York pour fabriquer des semi-conducteurs, tandis qu’Intel choisit l’Ohio et que la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company construit son usine en Arizona. Pendant ce temps-là, Archer Aviation promet de fabriquer ses avions électriques près de l’aéroport de Covington en Géorgie. Et le français Pernod Ricard étend sa production de whisky et de vodka à Fort Smith dans l’Arkansas.
Il vous reste 51.64% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.