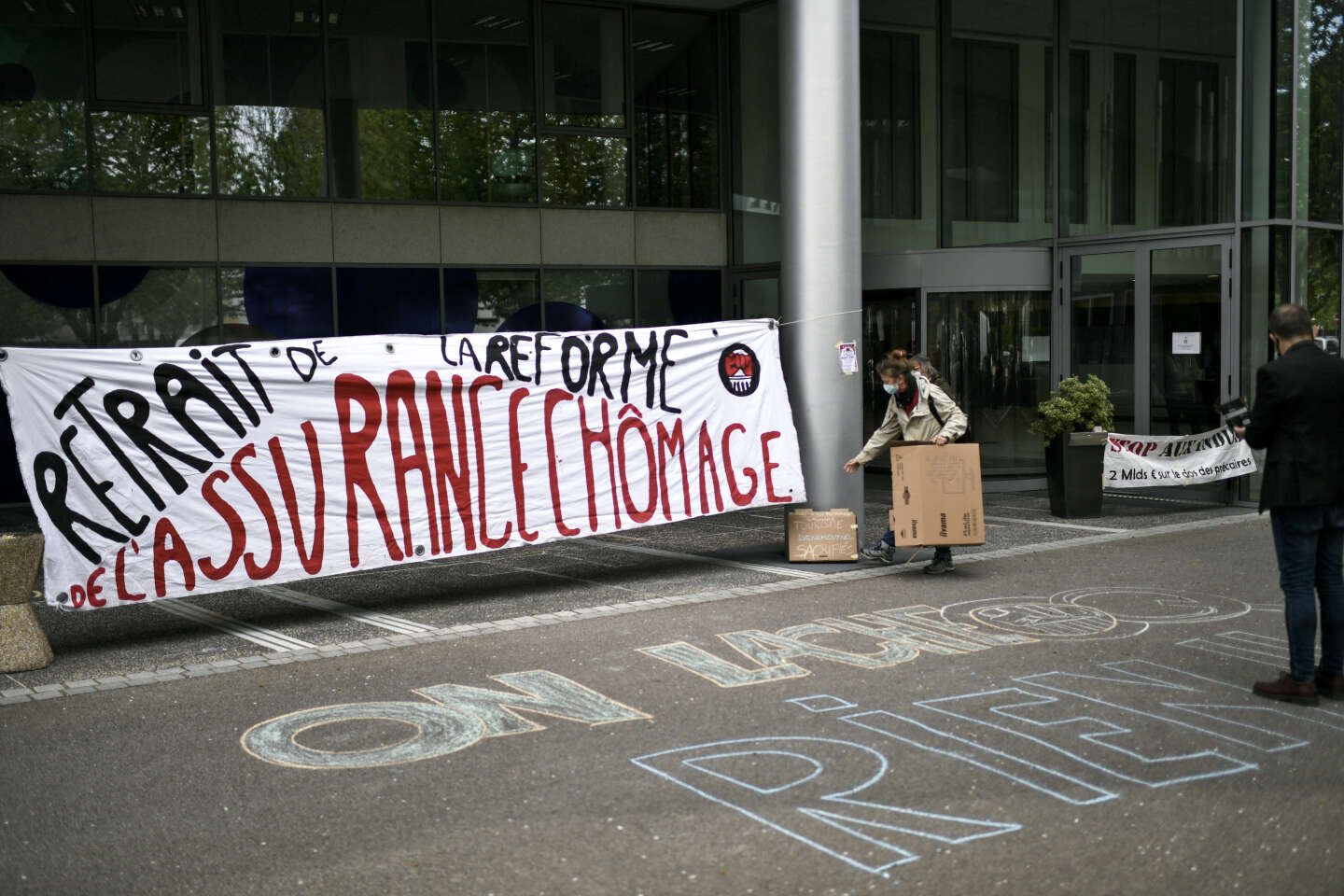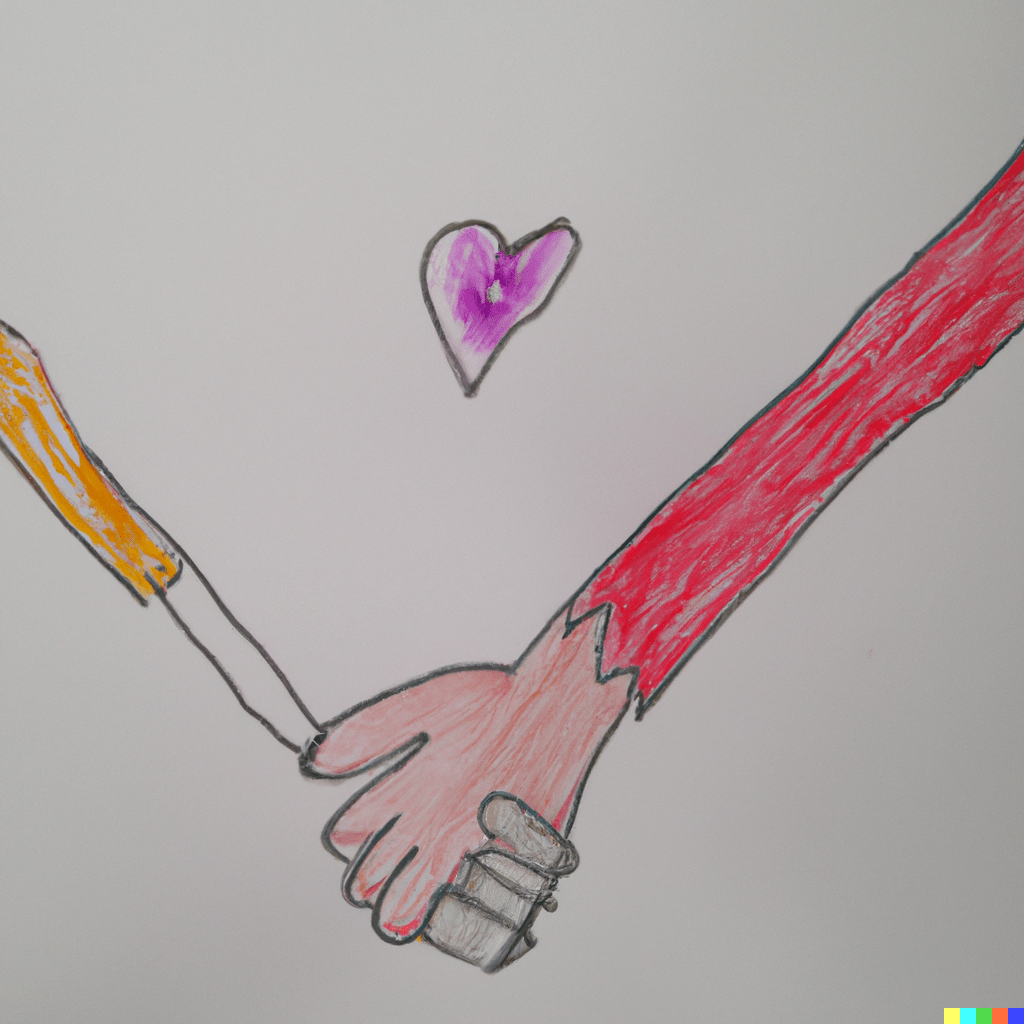« Les auditeurs RSE souhaitent passer du pur contrôle à une action de conseil »

Ils s’inquiètent depuis longtemps déjà du dérèglement climatique, et la chute de la biodiversité les préoccupe tout autant. Pour mettre leurs actes en cohérence avec leurs idées, de nombreux jeunes diplômés issus de filières comptables s’orientent vers un nouveau secteur en très forte croissance, l’audit de la responsabilité sociale et environnementale (RSE). Leur rôle : analyser les rapports RSE que les entreprises joignent à leurs états comptables, et vérifier que les actions « responsables » qu’elles mettent en avant correspondent bien à des réalités.
Un métier tout trouvé pour des personnalités particulièrement sensibles aux enjeux écologiques et humains ? Le comportement des entreprises a des conséquences majeures sur les émissions carbone et plus largement sur l’environnement. Traquer les opérations de « greenwashing » est à cet égard une mission pleine de sens. De même, à l’heure où le bien-être au travail est devenu une question sensible, confronter les annonces en la matière et les comportements managériaux paraît un travail indispensable.
Trois problèmes
Pourtant, le désarroi des auditeurs RSE est souvent à la hauteur de leurs attentes de départ (« L’audit RSE à la croisée des chemins », de Camille Gaudy, Jonathan Maurice et Christophe Godowski, Revue française de gestion no 306, 2022).
Nous avons interrogé des auditeurs de cabinets d’audit de taille moyenne, travaillant essentiellement avec des PME. Le chiffre d’affaires de ces cabinets indépendants est bien inférieur à celui des Big Four [PricewaterhouseCoopers, EY, Deloitte et KPMG], entités internationales qui contrôlent les comptes des grands groupes. Mais leur rôle est crucial, car plus de la moitié de l’activité française se réalise dans les PME et, pour la plupart, celles-ci ne bénéficient pas d’un autre accompagnement en matière de RSE.
Or, trois problèmes sont systématiquement pointés du doigt par ces auditeurs.
La question de leur compétence est d’abord posée. Formés pour être des professionnels du chiffre capables de décrypter la comptabilité financière des entreprises et de vérifier l’exactitude des données, par exemple le niveau des stocks ou la réalité d’investissements annoncés, ils savent lire les factures et trouver ces informations.
Désillusions
Mais on leur demande désormais d’évaluer aussi la sincérité d’engagements sociaux et environnementaux, ce qui nécessite des compétences spécifiques. Les Big Four peuvent s’offrir les services d’experts spécialisés en RSE pour aider les auditeurs dans leur travail, mais les petits cabinets n’ont pour l’instant pas ces moyens. Et très rares sont leurs salariés à avoir pu suivre des formations complémentaires pour assurer ces nouvelles missions.
Il vous reste 54.35% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.