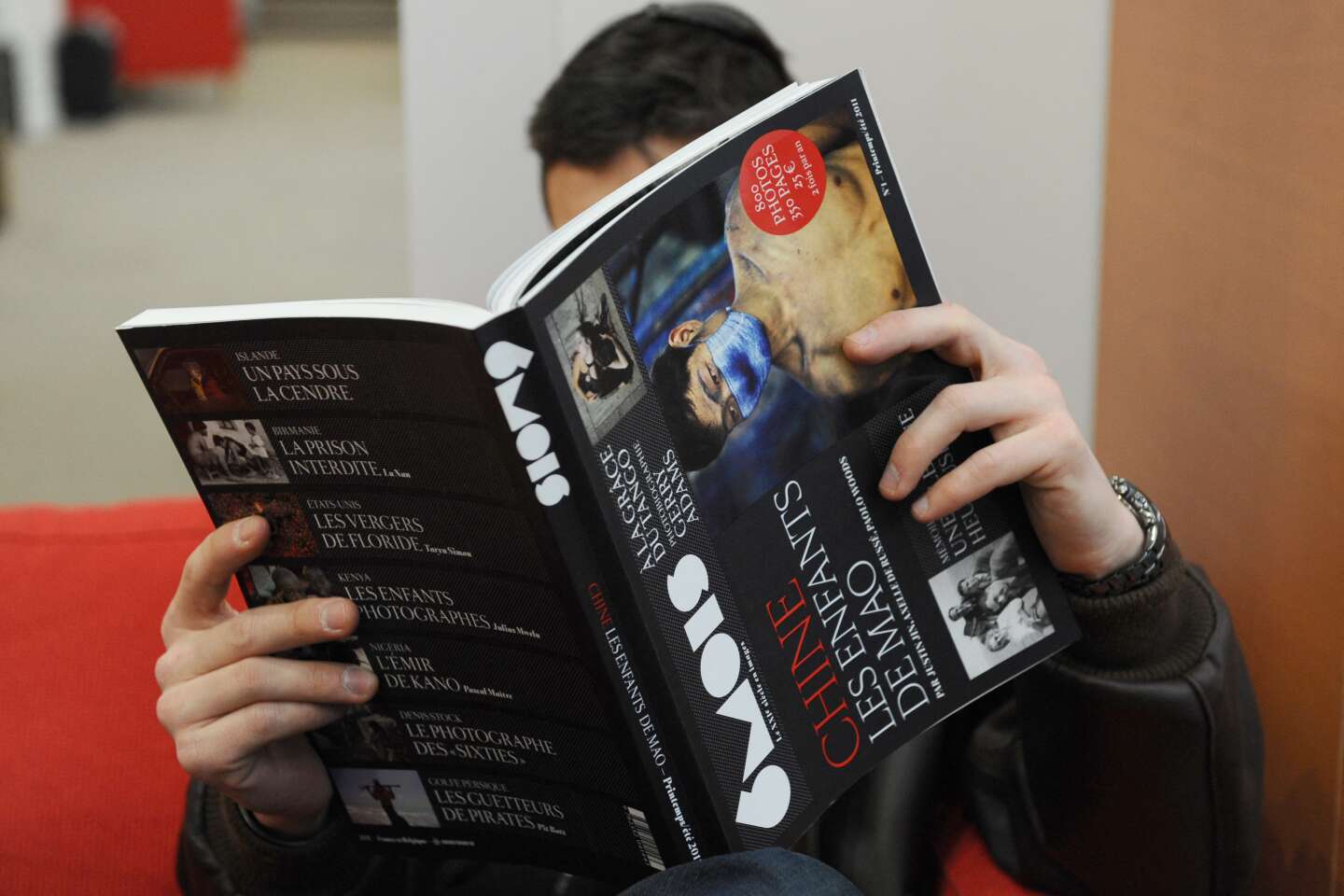« Le syndrome du patron de gauche » : quand les dirigeants n’assument pas leur rôle d’encadrants
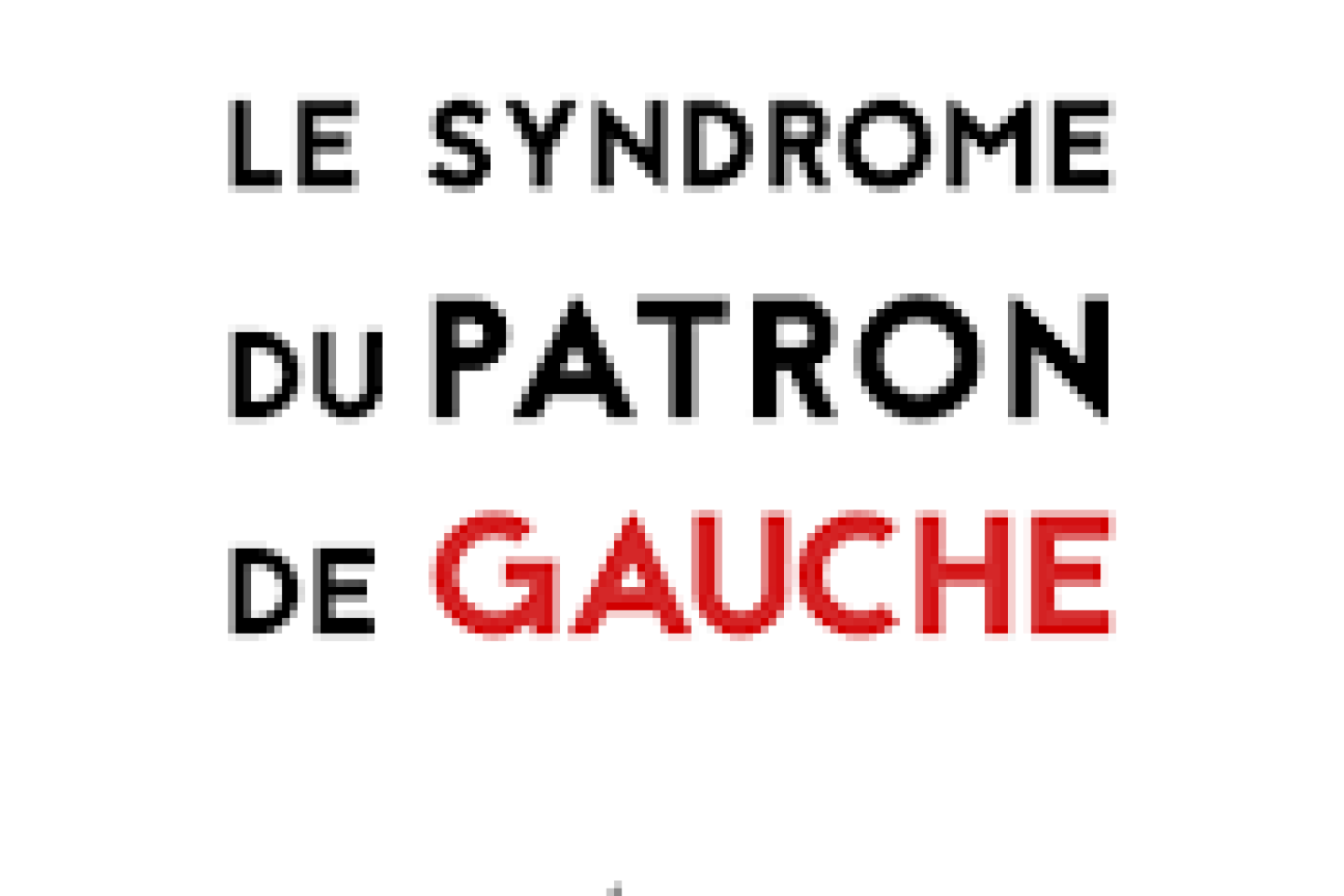
Livre. C’est l’histoire d’une désillusion. Fraîchement diplômé, Arthur Brault-Moreau commence sa carrière professionnelle dans l’équipe d’une élue de gauche. L’enthousiasme de travailler pour son « camp » va rapidement laisser place à la déception. Il cumule plus de cinquante heures de travail par semaine, la pression psychologique est là, les tensions aussi, dès lors qu’il porte des revendications sur les conditions de travail. « La réalité (…) était très éloignée des valeurs défendues par mon employeuse », explique-t-il. Il finira par quitter son organisation.
Après cette expérience, M. Brault-Moreau a mené une réflexion sur les structures de « gauche » – un terme arbitraire, mais assumé par l’auteur – et leurs responsables, l’impact qu’ils peuvent avoir sur les salariés. Il en a tiré un ouvrage, Le Syndrome du patron de gauche (Hors d’atteinte, 2022). Un essai engagé, imprégné par une expérience traumatisante, où s’égrènent au fil des pages souffrances, larmes et burn-out. Il y recherche des explications, après avoir fait un constat qui l’a sidéré : en responsabilité, des femmes et des hommes nient leurs propres valeurs et adoptent des comportements qu’ils sont censés combattre.
L’ouvrage n’a pas vocation à nous décrire les politiques de gestion des responsables de gauche dans toute leur diversité. L’essai est davantage un « recueil d’expériences de salariés » : à travers une cinquantaine de témoignages, M. Brault-Moreau a tenté de déceler des similitudes, des spécificités qui distingueraient cette même gestion de celle qu’aurait pu mener un autre dirigeant plus classique. Une quête des failles que peut porter en lui un responsable de gauche confronté à l’exercice du pouvoir.
La plus manifeste est certainement la difficulté à assumer une fonction d’encadrement (donner des ordres, accepter la relation de subordination…), qui peut être vécue comme contre-nature. En découlent parfois un amateurisme dans l’accompagnement des salariés, un « vernis d’autogestion », une camaraderie de façade, un flou dans les missions et la hiérarchie, l’attente d’un engagement sans borne et, in fine, un « management d’évitement ».
« Un conflit de valeurs encore plus intense »
Une situation qui peut être douloureusement vécue par les salariés, davantage considérés comme des militants. Les cadres manquent pour trouver ses repères dans l’organisation. Dans ce contexte, l’engagement des collaborateurs se retourne parfois contre eux. Ils doivent être « dévoués à la cause » et peuvent avoir mauvaise conscience à réaffirmer leurs droits. S’opposer à la structure militante à laquelle on appartient, n’est-ce pas le début d’une trahison ? Certains patrons ne se privent pas de le sous-entendre. De même, la porosité des frontières entre militantisme, bénévolat et salariat peut semer le trouble quant aux missions à accomplir et au temps à y consacrer.
Il vous reste 24.07% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.