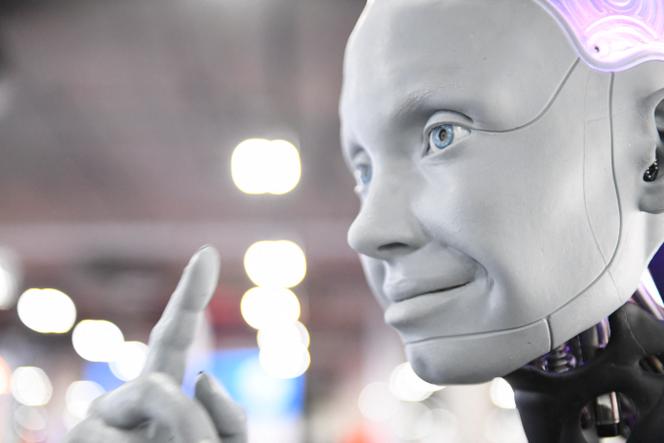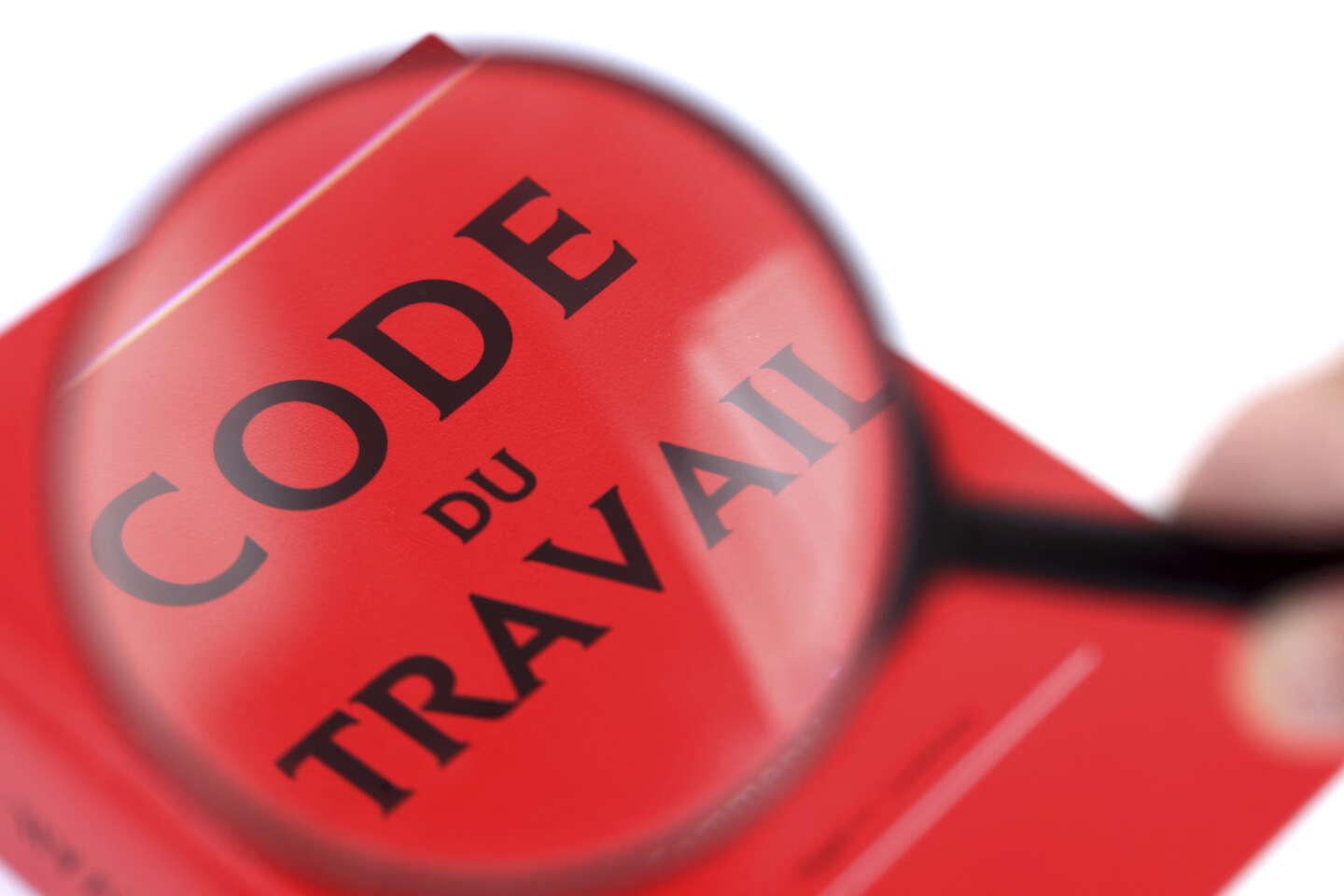Les collectifs d’indépendants, un juste milieu entre salariat et travail en free-lance

En mars 2021, Fred Lizée a cofondé, à Nantes, le collectif Away We Go, qui rassemble aujourd’hui une quarantaine d’indépendants, majoritairement autoentrepreneurs, dans les métiers du tourisme. « L’objectif était de mutualiser nos réseaux et expertises à la sortie du Covid, pour proposer de nouveaux services aux entreprises du secteur, qui ont du mal à embaucher et commencent à s’intéresser aux indépendants », explique ce chef de produit.
Ces dernières années, les regroupements d’indépendants comme celui-ci se multiplient, sous des statuts variés : association, société par actions simplifiée, coopérative… Dans une étude publiée en janvier avec la banque en ligne Shine, la plate-forme Collective estime qu’il existe 35 000 collectifs d’indépendants en France à ce jour, dont 10 000 se revendiquent comme tels.
Pour Jean-Yves Ottmann, chercheur en sciences du travail et coordinateur scientifique du Laboratoire Missioneo, le développement de ces nouvelles formes de travail est lié à l’« émergence de nouveaux métiers de la prestation intellectuelle, qui se sont structurés grâce aux outils numériques ». La technologie et le développement (24 % des collectifs selon l’étude Shine-Collective), la communication (16 %) et le conseil sont parmi les secteurs les plus représentés.
« Combattre la solitude »
Pour Yannick Fondeur, chercheur au Conservatoire national des arts et métiers, qui a notamment analysé un collectif de free-lances dans le numérique : « Il y a deux objectifs au départ, se partager des opportunités de missions, ainsi que faire équipe et avoir des compétences complémentaires. » Jean-Yves Ottmann identifie, lui, trois raisons : « politique, avec un rejet du salariat et des organisations traditionnelles ; psychologique, avec une volonté de quitter la solitude ; et pragmatique, pour accéder à des ressources et missions auxquelles on ne peut pas accéder tout seul ».
Cinquante-cinq pour cent des indépendants qui ont rejoint un collectif l’ont fait pour « combattre la solitude du free-lancing », selon l’étude Shine-Collective. En se réunissant, les free-lances cherchent aussi à mutualiser certaines dépenses : facturation, documents commerciaux, site Web, formations… « On a recréé ce qui nous plaisait dans l’entreprise et qu’on avait perdu en devenant indépendantes : travailler ensemble, avoir des gens sur qui compter », estime Louise Racine, cofondatrice de Lookoom, collectif spécialisé en identité de marque sur le numérique, qui fédère aujourd’hui 200 personnes.
En assemblant des compétences complémentaires, les indépendants peuvent surtout réaliser des missions plus ambitieuses, réservées jusqu’alors aux agences : 83 % des indépendants disent avoir rejoint un collectif pour « travailler sur des projets de plus grande envergure ». Par exemple, construire à plusieurs un site de A à Z pour un client.
Il vous reste 58.08% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.