Aux Etats-Unis, les « chatbots » désormais intégrés dans la vie des entreprises : « C’est un nouveau membre de l’équipe de direction »
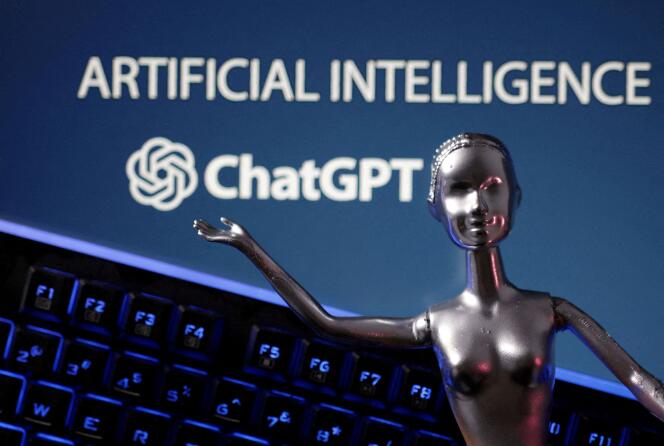
« Jeff, il faut absolument que tu regardes ça. » C’est le message qu’un ingénieur a envoyé sur la messagerie professionnelle Slack à Jeff Maggioncalda, patron des formations en ligne Coursera, à la fin de 2022. Ça ? C’était l’une des premières versions de ChatGPT, le robot conversationnel (ou chatbot) lancé par la start-up OpenAI en novembre 2022. « Je n’arrive pas à croire que ce tchat portait en lui tant de possibilités », s’exclame encore aujourd’hui M. Maggioncalda, émerveillé par la puissance d’analyse du big data de cet outil. Le dirigeant, conquis, s’en sert tous les jours. « C’est mon relecteur, dit-il. J’écris un premier jet, je lui demande de corriger les fautes et de raccourcir le texte. »
Sa secrétaire doit elle aussi utiliser ChatGPT. Lorsque celle-ci trie les e-mails reçus par M. Maggioncalda, elle prépare des réponses avec l’aide du robot… qui a appris à reproduire le style de son patron. Ce dernier n’a plus qu’à vérifier et l’affaire est entendue.
Le savant tchat n’est pas réservé qu’au dirigeant, la compagnie en profite tout autant : les coachs s’en servent pour affiner les choix des étudiants, les instructeurs lui demandent de résumer les parties essentielles de leurs cours. L’équipe marketing écrit quant à elle ses e-mails avec le chatbot et profite de la finesse de son analyse. « Cela nous libère de 20 % à 30 % de temps pour faire du brainstorming », dit M. Maggioncalda. Le robot, assure-t-il, est « un nouveau membre de l’équipe de direction ».
Une conversion à grande vitesse
Coursera n’est pas la seule compagnie à avoir embrassé avec passion les algorithmes d’intelligence artificielle (IA), capables de générer des contenus adaptés aux besoins de l’entreprise. Start-up et grands groupes se convertissent à grande vitesse : 49 % des 1 000 entreprises américaines sondées en février par le site Resume Builder déclarent utiliser ChatGPT. Ce qui, bien sûr, bouleverse de fond en comble l’organisation du travail.
Selon une étude Ipsos menée en avril, un sixième des Américains a déjà utilisé l’lA générative, et 29 % d’entre eux l’ont fait pour créer des textes pour leur travail. Le rédacteur free-lance Guillermo Rubio l’utilise pour écrire de courtes publicités, telles que des descriptions de produits. Marnix Broer, le numéro un de Studocu, une plate-forme d’échanges de cours visitée par huit millions d’étudiants américains, s’en sert pour classer ses documents, prendre des notes ou bien affiner les recherches.
Le développeur d’applications mobiles Willow Tree lui demande d’écrire des lignes de code et de tester ses programmes… avant l’intervention des experts. « C’est comme les voitures sans chauffeur, explique Tobias Dengel, le président de la compagnie. On a toujours besoin de contrôler. Mais ces premiers travaux sont d’ores et déjà très utiles. » Et d’enchaîner sur un usage encore plus complexe : « On peut construire notre propre système sur l’infrastructure de ChatGPT. » M. Dengel cite l’exemple d’un client dans l’agroalimentaire : « Nous introduisons tous ses fournisseurs dans le système et lui demandons de chercher lesquels laissent la moindre empreinte carbone. »
Il vous reste 44.76% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.







