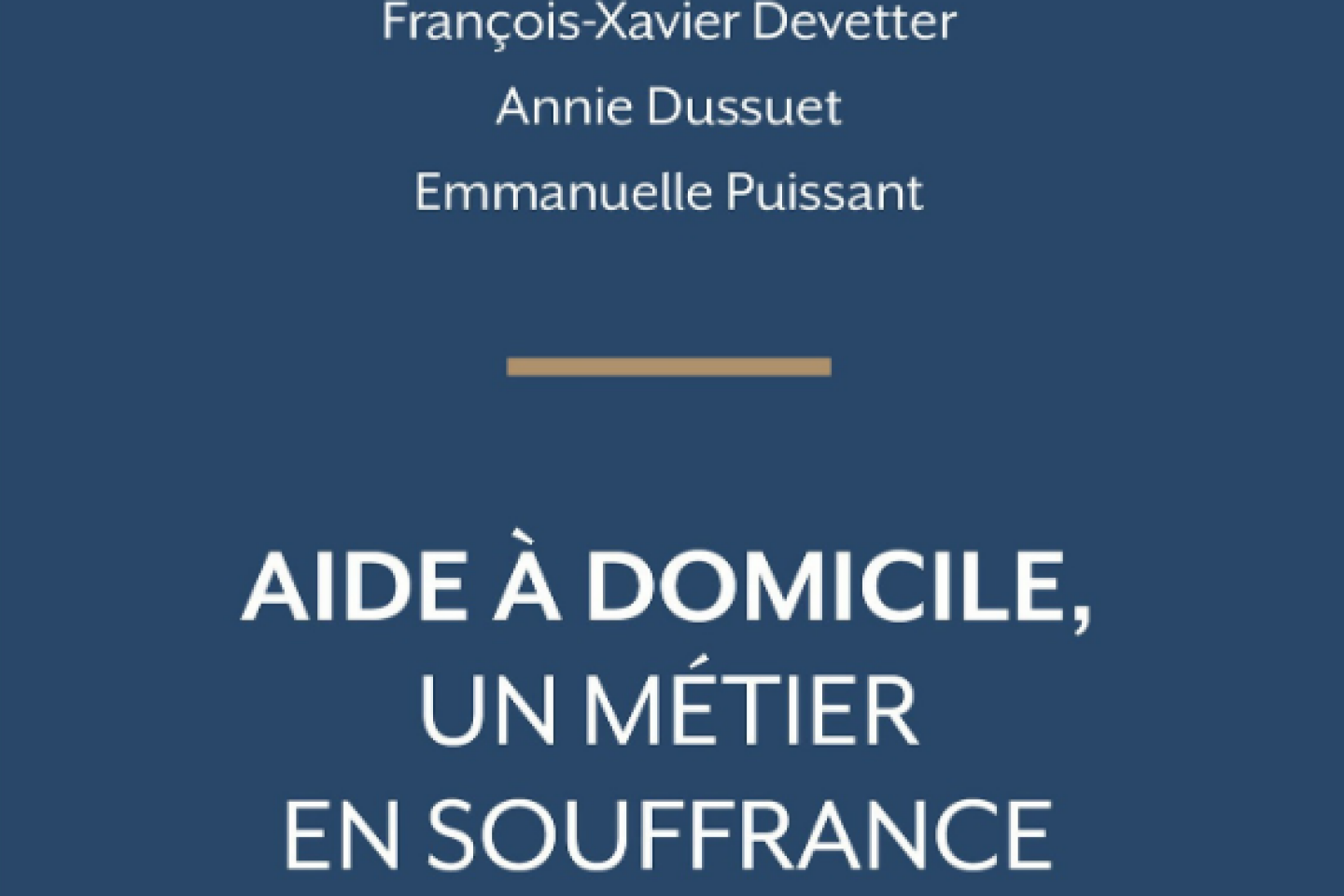La réforme du RSA grossira les rangs des demandeurs d’emploi

L’objectif est martelé depuis la campagne présidentielle. Emmanuel Macron souhaite atteindre le plein-emploi à l’horizon 2027. C’est dans cette quête d’un taux de chômage autour de 5 % de la population active – contre 7,1 % actuellement – que le gouvernement a déjà réformé l’assurance-chômage et les retraites. Le troisième levier qu’il enclenche est la réforme du revenu de solidarité active (RSA). Celle-ci fait partie du projet de loi « pour le plein-emploi » présenté, mercredi 7 juin, en conseil des ministres par le ministre du travail, Olivier Dussopt.
Le texte porte notamment la transformation du service public de l’emploi avec la création de France Travail, qui viendra remplacer Pôle emploi. Il prévoit que tous les demandeurs d’emploi, quelle que soit leur situation, soient inscrits à France Travail, notamment les 2 millions de bénéficiaires du RSA. Or, actuellement, seulement 40 % des allocataires sont enregistrés dans les fichiers de Pôle emploi. Cela signifie donc qu’environ 1,2 million de personnes supplémentaires pourraient venir grossir les rangs de France Travail. Une explosion du nombre de demandeurs d’emploi qui pourrait avoir des conséquences politiques non négligeables pour le gouvernement.
La réforme « augmentera automatiquement le nombre de demandeurs d’emploi inscrits auprès de Pôle emploi », a reconnu Olivier Dussopt, à l’issue de la présentation du projet de loi en conseil des ministres. Mais cela n’aura pas d’incidence sur les chiffres du chômage publiés chaque trimestre par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), ceux « sur lesquels l’Etat communique depuis au moins vingt ans » et « qui n’ont pas grand-chose à voir en réalité avec le nombre de demandeurs d’emploi inscrits chez Pôle emploi », a précisé le ministre du travail.
Différentes définitions
« Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits ne doit pas être confondu avec le nombre de chômeurs », complète de son côté le cabinet du haut-commissaire à l’emploi, Thibault Guilluy, pour déminer. Le taux de chômage est calculé sur la base d’un sondage réalisé à partir de la définition du Bureau international du travail (BIT), qui permet les comparaisons internationales. Un chômeur est une personne en âge de travailler, de 15 ans ou plus, qui n’a pas du tout travaillé – même pas une heure – durant une semaine de référence, qui est disponible pour prendre un emploi dans les quinze jours et qui doit avoir cherché activement un emploi dans le mois précédent. Une définition bien plus stricte que celle utilisée par Pôle emploi pour les demandeurs d’emploi.
Il vous reste 59.68% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.