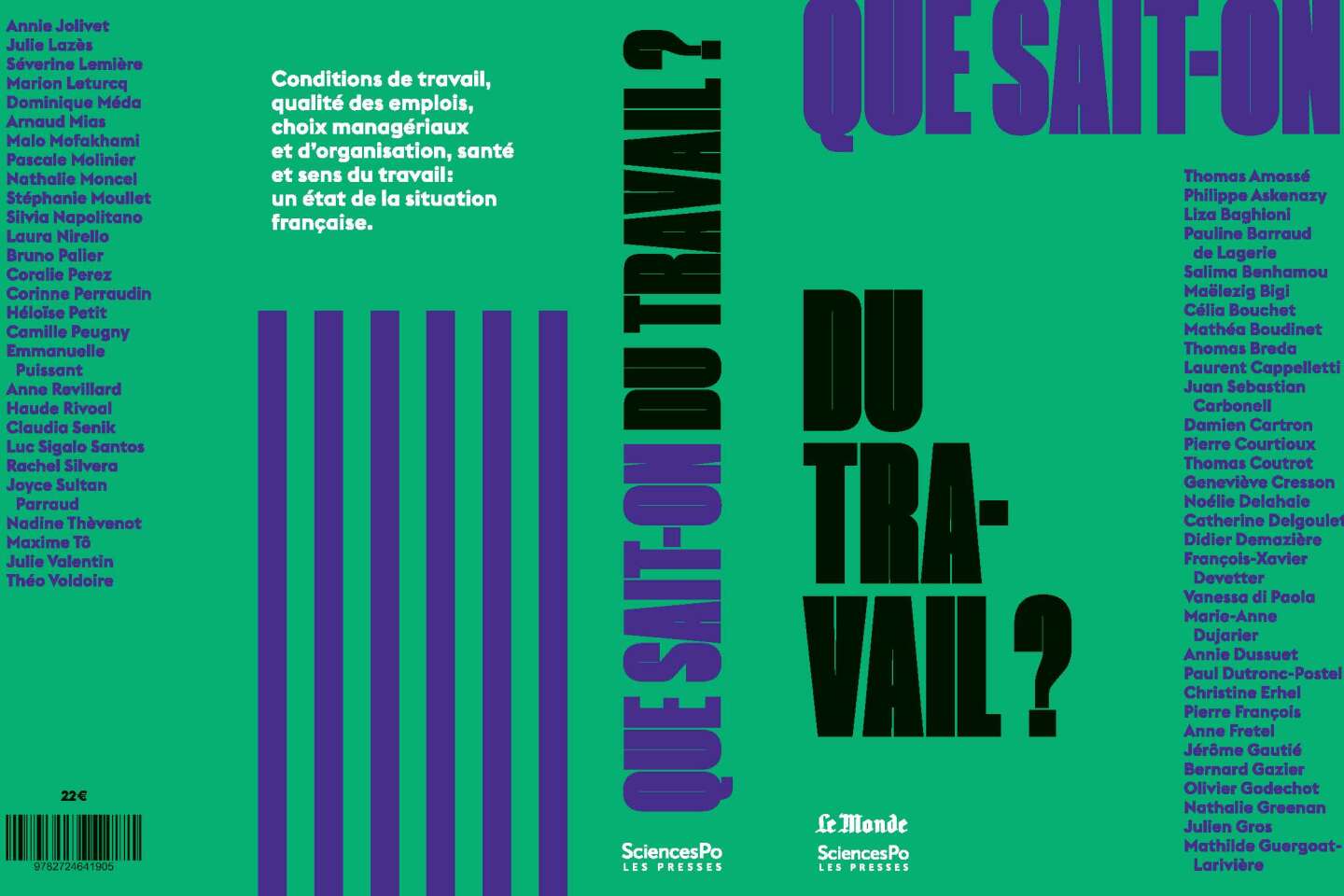Tesla en tête, les entreprises de la tech défient le modèle social suédois

La grève a commencé, le 27 octobre, dans les sept concessions de la marque Tesla en Suède. Depuis, les garagistes se sont joints au mouvement. Puis les dockers, qui ne déchargent plus les voitures électriques, arrivant par bateau de Rostock, en Allemagne. Dans les prochains jours, les électriciens, à leur tour, arrêteront de réparer les véhicules et les bornes de recharge, tandis que les facteurs ne livreront plus les pièces détachées et les agents d’entretien cesseront de faire le ménage.
De mémoire de syndicaliste suédois, on n’avait pas vu pareille mobilisation depuis des décennies. Il faut dire que l’heure est grave : selon les syndicats, c’est l’avenir du modèle suédois qui est en jeu, d’autant qu’Elon Musk, qui refuse de signer les accords collectifs en vigueur dans le royaume, n’est pas le seul à leur tenir tête. La compagnie de streaming suédoise Spotify est dans la même situation et il a fallu la menace d’une grève pour que la société Klarna, spécialiste du paiement fractionné – et suédoise elle aussi –, finisse par céder, le 3 novembre.
« Nous allons faire en sorte que ce soit aussi difficile que possible pour Tesla de continuer à tourner », explique Marie Nilsson, la patronne d’IF Metall, qui ajoute : « Nous sommes désolés pour les propriétaires des voitures de la marque, qui ne pourront pas les faire réparer [ils sont environ 50 000 en Suède]. Mais il faut que le conflit ait un impact pour que notre interlocuteur comprenne. »
Réglé par ces accords de branche
Le dernier face-à-face a eu lieu le 6 novembre. A cette occasion, les représentants de Tesla en Suède ont réitéré leur refus de se soumettre aux exigences du syndicat. « Le plus bizarre est qu’ils ne s’opposent pas au contenu de l’accord, mais refusent de le signer par principe, ce qui ne peut être interprété que par le fait que Tesla veut décider seule et de façon unilatérale des conditions de travail », constate Mme Nilsson. Avec, pour les salariés, le risque de se retrouver « sans protection à l’avenir », note la présidente d’IF Metall.
Car, en Suède, le marché du travail n’est pas encadré par la loi, mais réglé par ces accords de branche, négociés tous les deux ou trois ans par les partenaires sociaux. Même s’ils ne sont pas obligatoires, ils couvrent environ 90 % des salariés, syndiqués à 70 %. « C’est un modèle qui a assuré une hausse des salaires réels, tout en permettant aux entreprises de prospérer », vante Gabriella Lavecchia, présidente du syndicat des employés des services et des communications Seko.
Il vous reste 65% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.