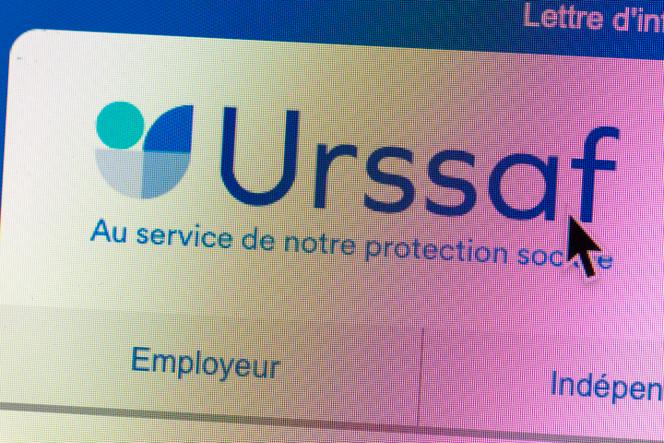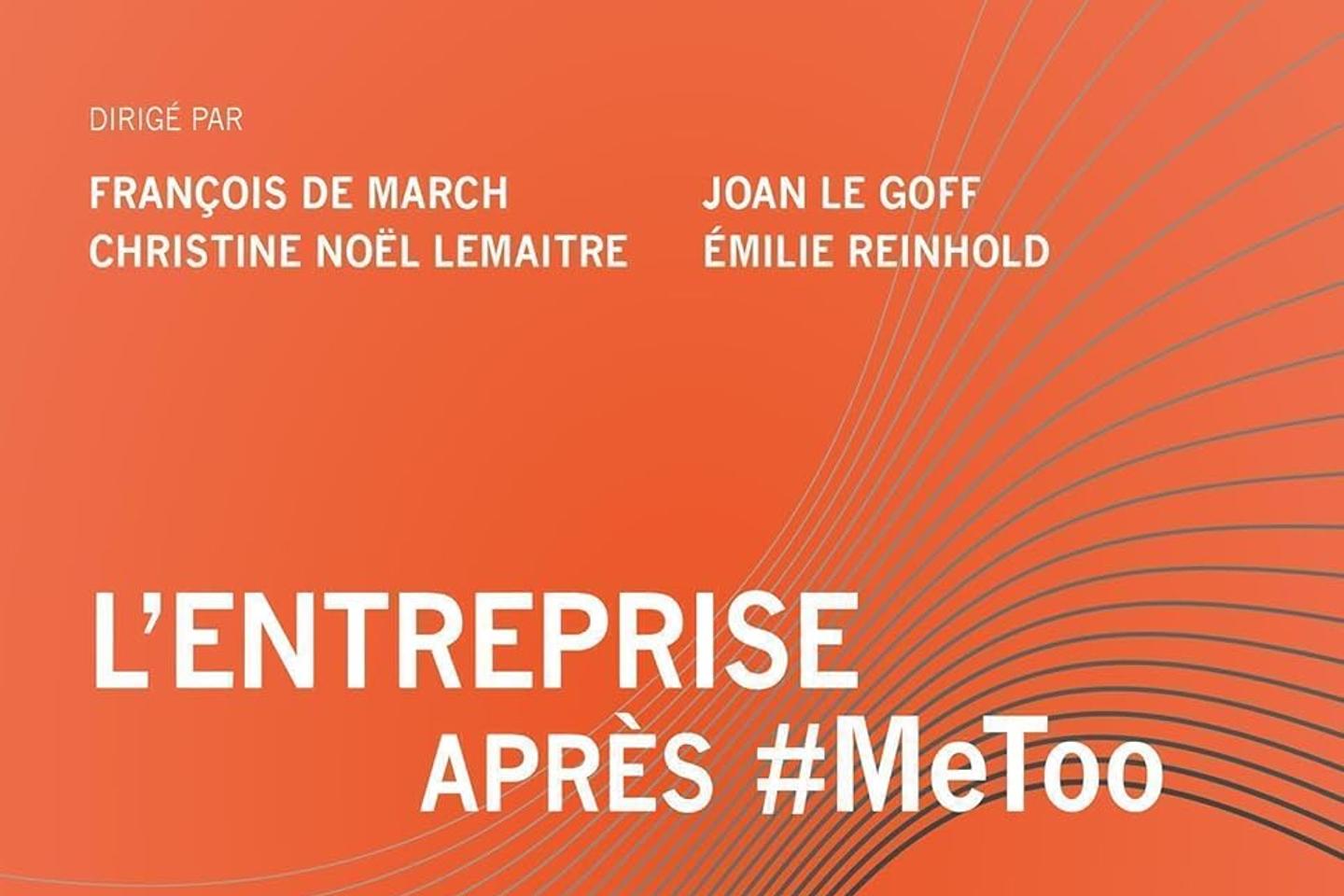2025, une année noire pour les défaillances d’entreprise

Le dernier coup de boutoir a été donné le 11 décembre 2025. A quelques jours de la fin de l’année, Brandt, groupe emblématique de l’électroménager made in France, a annoncé sa mise en liquidation judiciaire, laissant 700 salariés sur le carreau. Cette faillite retentissante a bouclé une année noire sur le front des défaillances : NovAsco, Ynsect, Carmat, pour ne citer qu’eux, et une pluie d’entreprises de la mode, du textile ou de l’aménagement de la maison, comme IKKS ou Alinéa, sont entrés en procédure de redressement, de sauvegarde ou ont été liquidées. Les conséquences de l’arrêt des politiques de soutien aux entreprises mis en place pendant la pandémie de Covid-19, mais aussi, de la succession des crises depuis 2022 : hausse des prix de l’énergie et des matières premières, recul de la consommation en raison de la forte inflation, résurgence des politiques protectionnistes et assauts de la concurrence chinoise.
Au total, 68 057 entreprises sont entrées en procédure en 2025, un record historique, en hausse de 3,5 % par rapport à 2024, selon les chiffres compilés par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ), lesquels voient passer l’intégralité des dossiers dans leurs cabinets, et publiés mardi 20 janvier. Pour 44 908 de ces entreprises, l’opération s’est soldée par une liquidation directe, tandis que 21 581 ont été placées en sauvegarde. Par rapport à la période d’avant la pandémie de Covid-19, ces chiffres sont très élevés : dans la décennie 2010-2020, l’étiage moyen était de 53 000 entrées en procédure par an. Le rythme des défaillances observé ces dernières années se rapproche plutôt de celui atteint au cours de la période 2012-2015, où l’on en comptait 63 000 par an, dans la foulée de la crise de 2008.
Il vous reste 67.35% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.