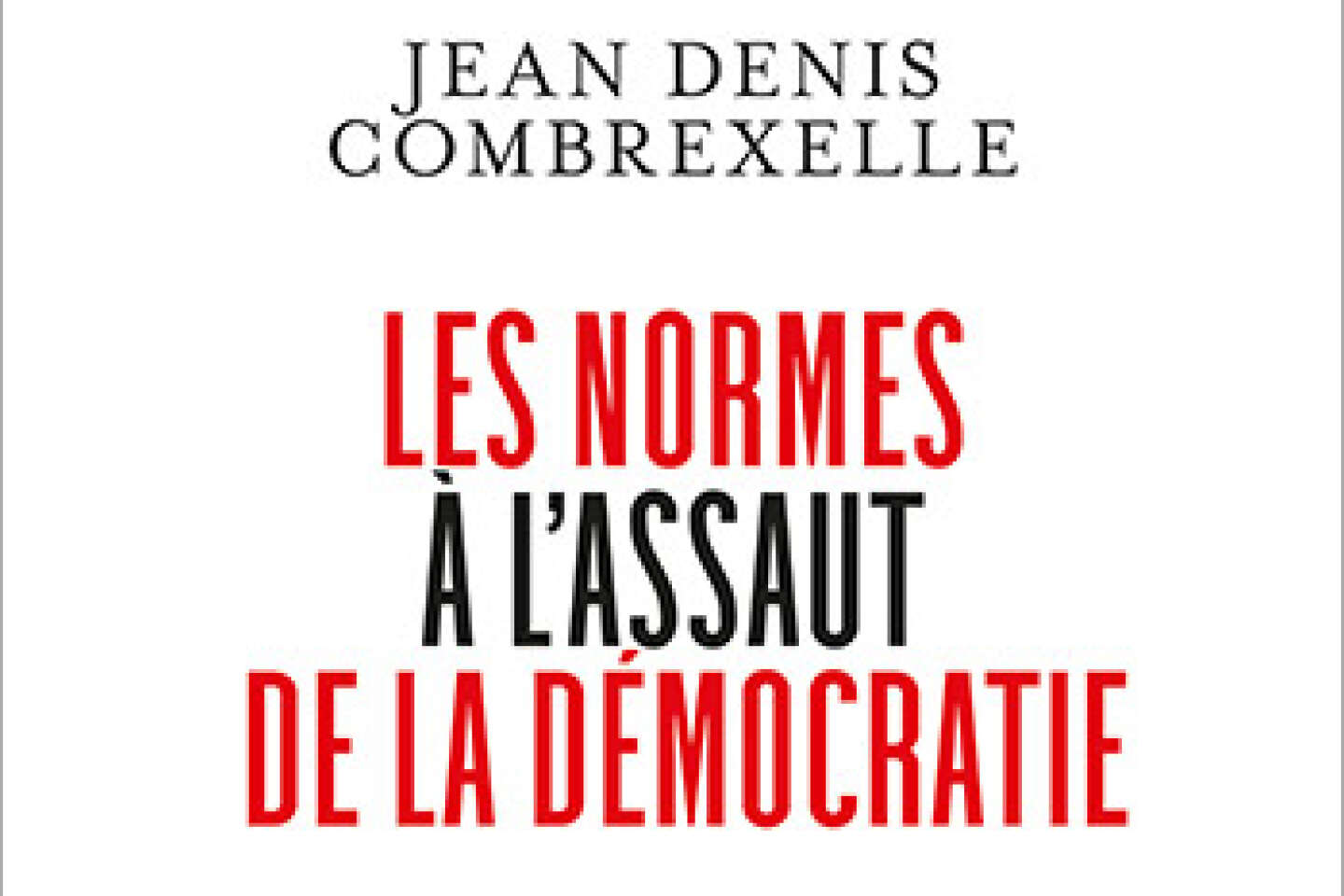Que fait-on du travail ? : « Il est essentiel d’associer les salariés aux décisions sur le travail, y compris sa finalité, mais on n’est pas dans la cogestion »

Dans le cadre du projet de médiation scientifique « Que sait-on du travail ? » du Laboratoire d’évaluation des politiques publiques de Sciences Po (Liepp), des chercheurs ont analysé les maux du travail et leurs origines dans une série de textes publiés par Le Monde tout au long de l’année. Pour « travailler mieux », ces mêmes chercheurs ont avancé quelques pistes d’actions. Dans une deuxième série « Que fait-on du travail ? », qui décryptera sur plusieurs mois ce qui est fait du travail, nous avons interrogé des dirigeants d’entreprise sur ce qu’ils pensent des propositions des chercheurs et s’ils les appliqueraient. Cet entretien ouvre le premier épisode de la série.
Le premier sujet abordé est celui de la perte de sens au travail, ses liens avec le management, en particulier avec la non-participation des salariés aux décisions qui concernent leur travail, analysé par les économistes Thomas Coutrot et Coralie Perez. Leurs recommandations ? Redonner aux salariés le pouvoir d’agir sur leur travail en faisant de leur parole un levier de transformation.
En tant que directeur général de la MAIF et coprésident du Mouvement Impact France, Pascal Demurger, qu’en pensez-vous ?
Sur la question du sens au travail, je suis 100 % d’accord avec ces chercheurs. Redonner la parole aux salariés comme levier de transformation pour redonner du sens au travail est essentiel. Le sujet du travail est un angle mort du débat public. On parle rarement des modalités du travail. Or, il y a vraiment du sens autour de l’objet même du travail et ça peut aller au-delà si l’entreprise propose une mission plus large de nature plutôt sociétale.
Ce premier sujet, le sens du travail, est fondamental sur la valorisation, y compris la valorisation par le salarié lui-même de la fonction qu’il exerce. Ça passe par la compréhension de sa contribution personnelle dans l’atteinte de l’objectif global de l’entreprise, au-delà de la simple création de bénéfices. Le second point consiste à montrer à chaque collaborateur que l’entreprise lui fait confiance dans l’exécution de son travail, et donc à ne pas l’enfermer dans un process établi par le haut, comme un script de téléconseiller par exemple, mais lui laisser une marge de manœuvre relativement importante, une capacité de jugement et d’adaptation en fonction des circonstances.
Avec la considération des salariés, ce sont les trois conditions pour que le travail soit épanouissant. Les collaborateurs donnent alors le meilleur d’eux-mêmes et on crée de la performance pour l’entreprise. L’employeur a une obligation morale au-delà de sa responsabilité légale de préserver la santé physique et mentale des salariés. Quand on a la responsabilité du bien-être des personnes qui nous entourent, on ne peut pas ne rien en faire.
Il vous reste 61.31% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.