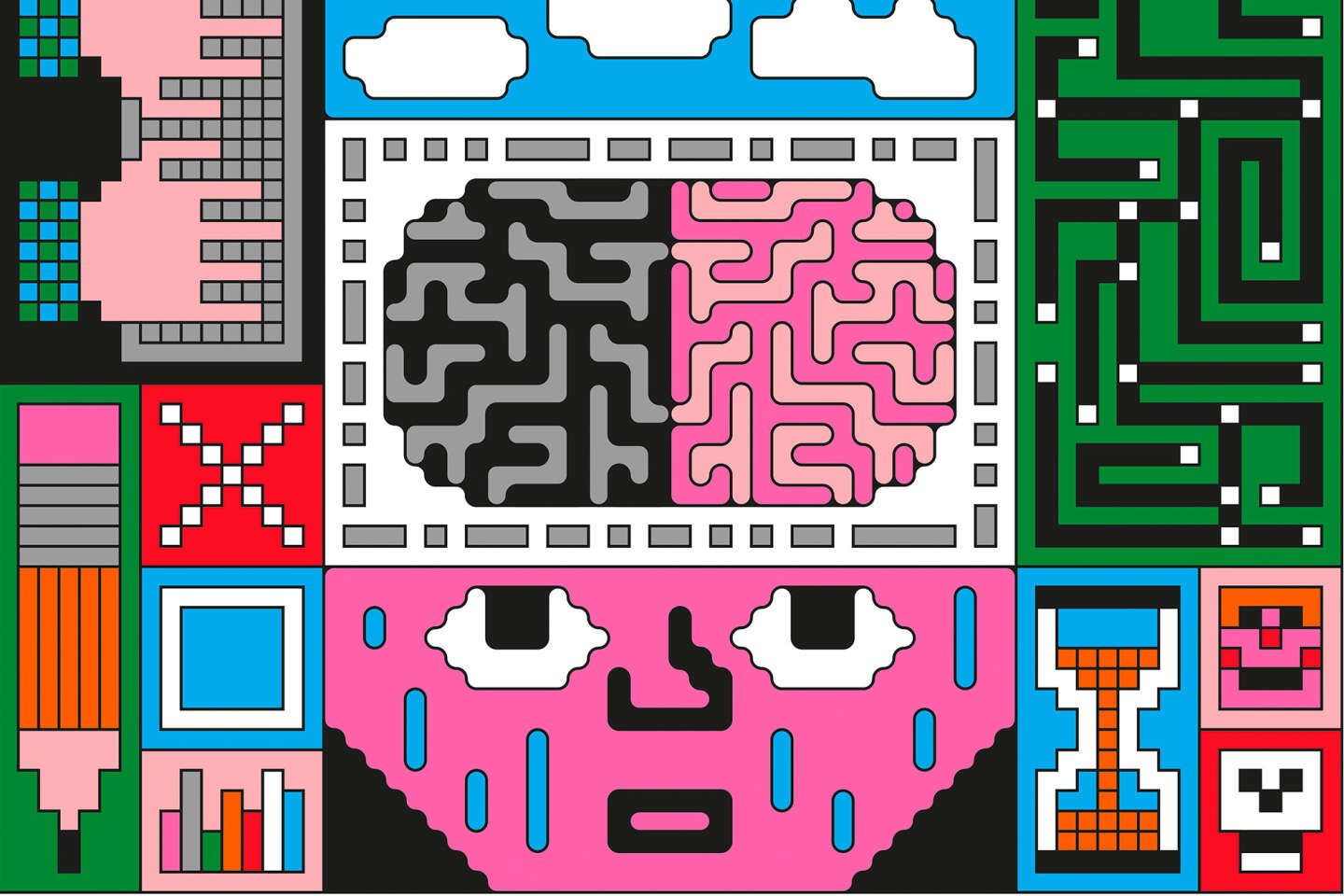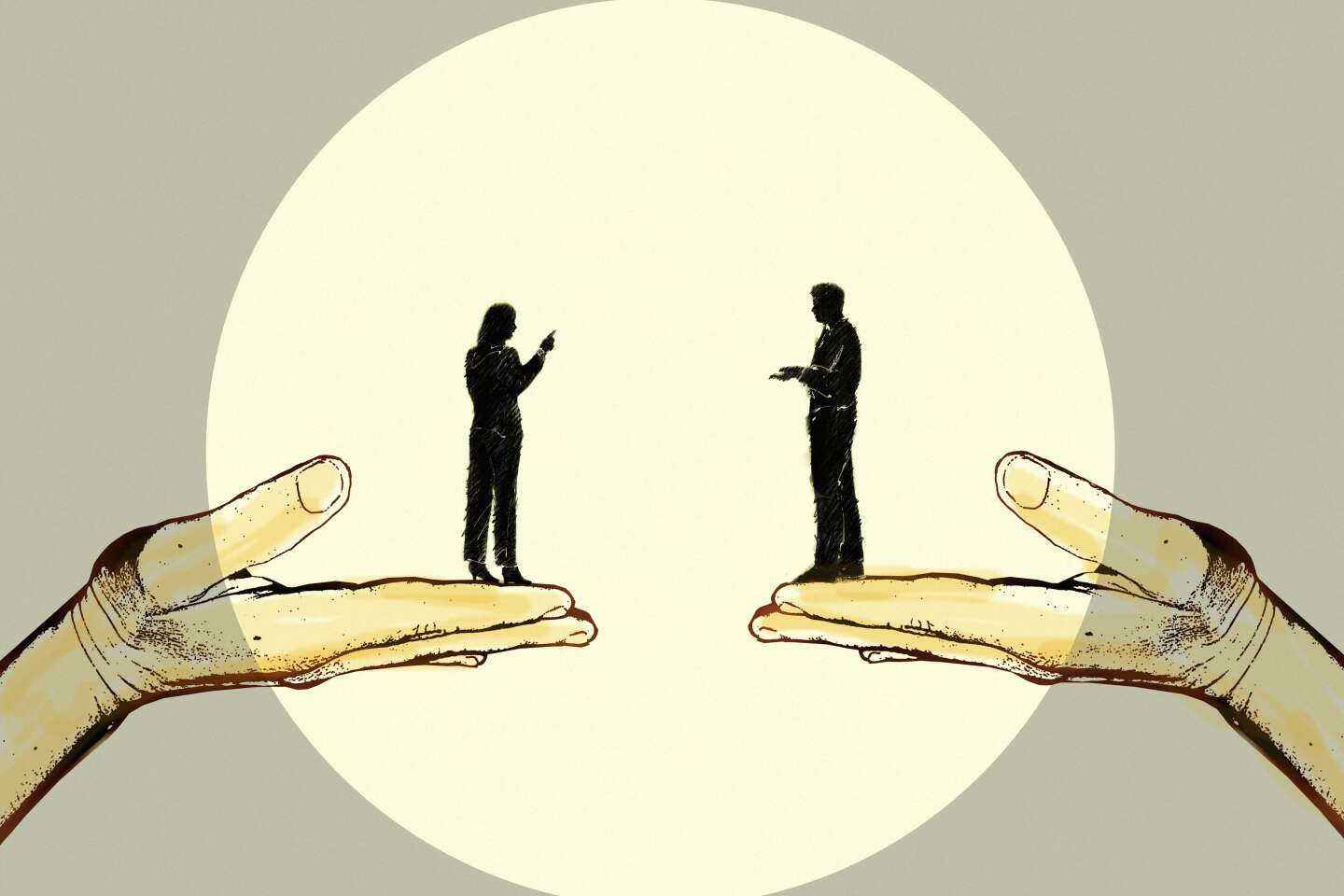« Il est temps d’améliorer la prévention et la reconnaissance des atteintes psychiques au travail »

La journée du 28 avril a été choisie par l’Organisation internationale du travail pour promouvoir la sécurité et la santé au travail. Le mouvement contre la réforme des retraites a montré à quel point il est urgent de rendre le travail plus soutenable. Les accidents du travail commencent maintenant à occuper une place importante dans le débat public, même si les réponses gouvernementales ne sont pas à la hauteur. Mais des pans entiers des atteintes à la santé au travail restent trop négligés, tant du côté de la prévention que du côté de la réparation : c’est le cas notamment des cancers d’origine professionnelle ou des atteintes à la santé psychique, dont il sera ici question.
Le management par les chiffres, les réorganisations permanentes et imposées, les conduites du changement délétères, le recours à l’emploi précaire ou sous-traité ont dégradé les solidarités au sein des collectifs et provoqué une rupture entre le travail et son sens. Les souffrances ainsi causées sont très peu reconnues, bien qu’elles participent des atteintes à la santé au travail proscrites par la loi.
Pour l’année 2018, les pathologies psychiques sont estimées par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail à 31 % de l’ensemble des pathologies en relation avec le travail dans les services publics, et à 41 % dans le commerce et les autres services. Or, elles ne représentent que 2 % des maladies professionnelles et 1 % des accidents du travail reconnus. Une récente étude de Santé publique France, portant sur un échantillon de 1 135 suicides, estime que 10 % sont en lien potentiel avec l’activité professionnelle. Si l’on applique ce taux au nombre total de suicides, cela représenterait plus de 800 suicides liés au travail en 2021 – sans compter les tentatives, dont le nombre est de 6 à 7 fois supérieur.
Intensité, autonomie
La commission de la Sécurité sociale chargée d’évaluer la sous-déclaration estime à 108 000 le nombre de pathologies psychiques qui auraient dû être reconnues comme accidents du travail ou maladies professionnelles en 2021. Mais la Sécurité sociale et les conseils médicaux de la fonction publique continuent à pratiquer le compte-gouttes en matière de reconnaissance de ces maladies professionnelles : on peut estimer que guère plus de cinq atteintes à la santé psychique sur cent sont actuellement reconnues. Sans oublier que les fonctionnaires, les indépendants, les agriculteurs et les salariés relevant de la Mutualité sociale agricole, les marins pêcheurs, les travailleurs détachés européens, les chômeurs, qui souffrent aussi du travail – soit un potentiel de plus de 10 millions de salariés –, sont exclus de ces chiffres.
Il vous reste 52.34% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.