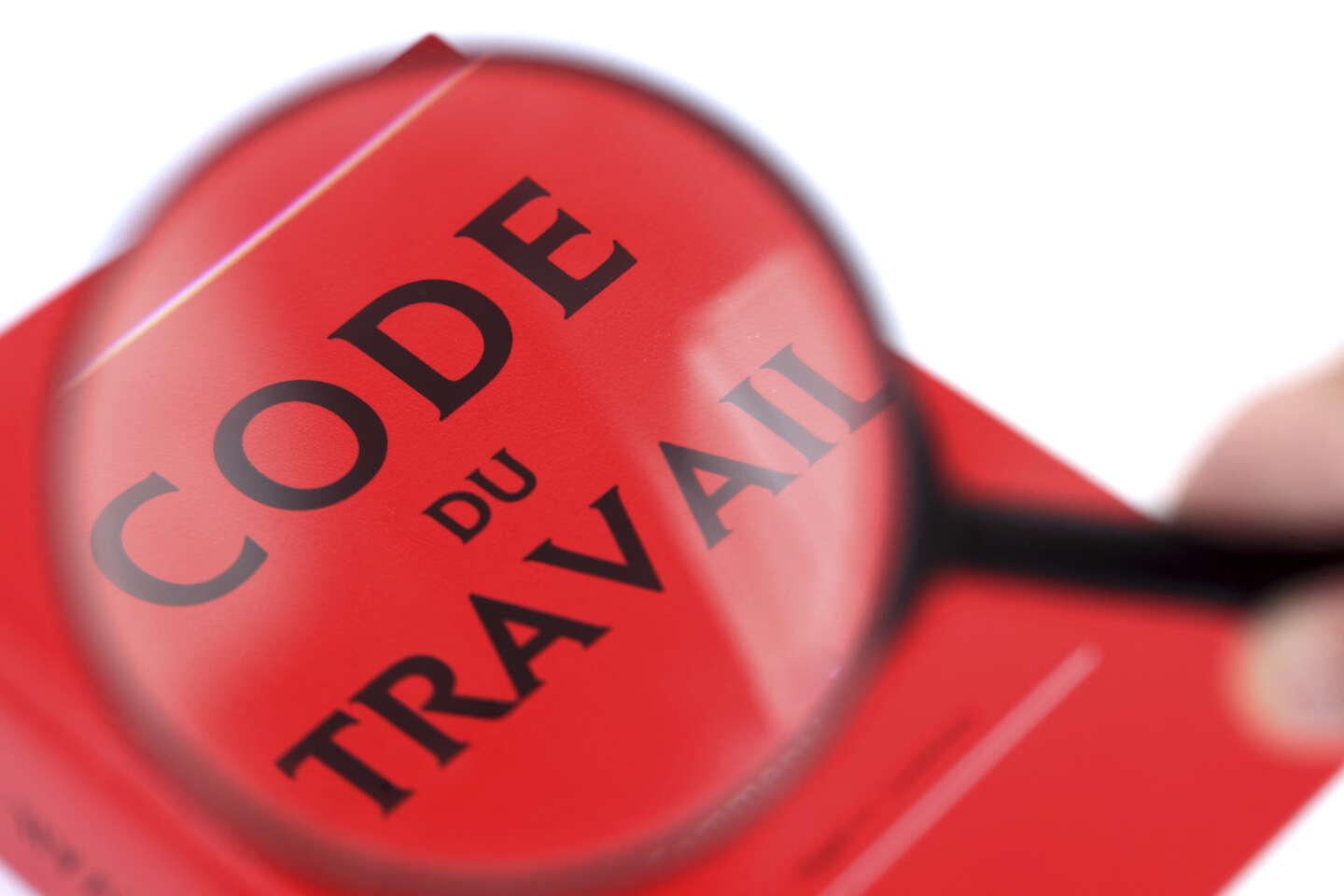Hollywood : la grève est déclarée chez les scénaristes

La crise couvait au royaume du cinéma et du divertissement. C’est à présent une réalité : des milliers de scénaristes de télévision et de cinéma américains vont se mettre en grève après l’échec des négociations avec les principaux studios et plates-formes – comme Netflix ou Disney – qui portaient sur une hausse de leurs rémunérations.
Les membres du conseil d’administration du puissant syndicat des scénaristes, la Writers Guild of America (WGA), « agissant en vertu de l’autorité qui leur a été conférée par leurs membres, ont voté à l’unanimité en faveur d’un appel à la grève » qui prendra effet après minuit (9 heures mardi, heure de Paris), a tweeté, lundi 1er mai tard dans la soirée la WGA. Cette grève devrait entraîner l’interruption immédiate des émissions à succès, comme les late-night shows (talk-shows de fin de soirée), et retarderait de manière importante les séries télévisées et films dont la sortie est prévue cette année.
Le dernier mouvement social d’ampleur à Hollywood remonte à la grève des scénaristes qui avait paralysé l’audiovisuel américain en 2007-2008. Ce conflit de cent jours avait coûté 2 milliards de dollars au secteur.
Les scénaristes réclament une hausse de leur rémunération et une plus grande part des bénéfices générés par le streaming, alors que les studios affirment devoir réduire leurs coûts en raison de pressions économiques.
Les salaires stagnent, voire baissent
« Tout le monde a l’impression qu’il va y avoir une grève », avait déclaré à l’Agence France-Presse sous couvert de l’anonymat un scénariste pour la télévision basé à Los Angeles. En jeu, « un accord qui va déterminer la manière dont [les scénaristes sont] rémunérés » pour le streaming, aussi bien aujourd’hui qu’à l’avenir, avait-il ajouté.
Les scénaristes affirment avoir du mal à vivre de leur métier, leurs salaires stagnent, voire baissent en raison de l’inflation, alors que leurs employeurs font des bénéfices et augmentent les salaires de leurs dirigeants. Ils estiment n’avoir jamais été aussi nombreux à travailler au salaire minimum fixé par les syndicats, tandis que les chaînes de télévision embauchent moins de personnes pour écrire des séries de plus en plus courtes.
L’un des principaux désaccords porte sur le mode de calcul de la rémunération des scénaristes pour les séries diffusées en streaming, qui, sur des plates-formes comme Netflix, restent souvent visibles pendant des années après avoir été écrites. Depuis des décennies, les scénaristes perçoivent des « droits résiduels » pour la réutilisation de leurs œuvres, par exemple lors des rediffusions télévisées ou des ventes de DVD. Il s’agit soit d’un pourcentage des recettes engrangées par les studios pour le film ou l’émission, soit d’une somme fixe versée à chaque rediffusion d’un épisode.
L’impact de l’intelligence artificielle en question
Avec le streaming, les auteurs reçoivent chaque année un montant fixe, même en cas de succès international de leur travail, comme pour les séries La Chronique des Bridgerton ou Stranger Things, vues par des centaines de millions de téléspectateurs dans le monde entier. La WGA, qui défend les quelque 11 000 scénaristes du pays, réclame la revalorisation de ces montants, aujourd’hui « bien trop faibles au regard de la réutilisation internationale massive » de ces programmes. Elle veut également évoquer le futur impact de l’intelligence artificielle sur le métier de scénariste.
Cours en ligne, cours du soir, ateliers : développez vos compétences
Découvrir
Les studios, représentés par l’Alliance des producteurs de cinéma et de télévision (AMPTP), relèvent que les « droits résiduels » versés aux scénaristes ont atteint un niveau record de 494 millions de dollars (450 millions d’euros) en 2021, contre 333 millions dix ans plus tôt, en grande partie grâce à la forte augmentation des emplois de scénaristes, liée à la hausse de la demande en streaming.
Après avoir été dépensiers ces dernières années, lorsque les diffuseurs concurrents ont cherché à augmenter le nombre d’abonnés à tout prix, les patrons affirment désormais être soumis à une forte pression de la part des investisseurs pour qu’ils réduisent leurs dépenses et fassent des bénéfices. Et ils nient prétexter des difficultés économiques pour renforcer leur position dans les négociations avec les scénaristes.
« Pensez-vous que Disney licencierait 7 000 personnes pour le plaisir ? », a déclaré une source proche de l’AMPTP, qui représente environ 300 producteurs et les grands studios. Selon elle, « il n’y a qu’une seule plate-forme qui soit rentable à l’heure actuelle, et c’est Netflix ». L’industrie du cinéma « est également un secteur très concurrentiel ».