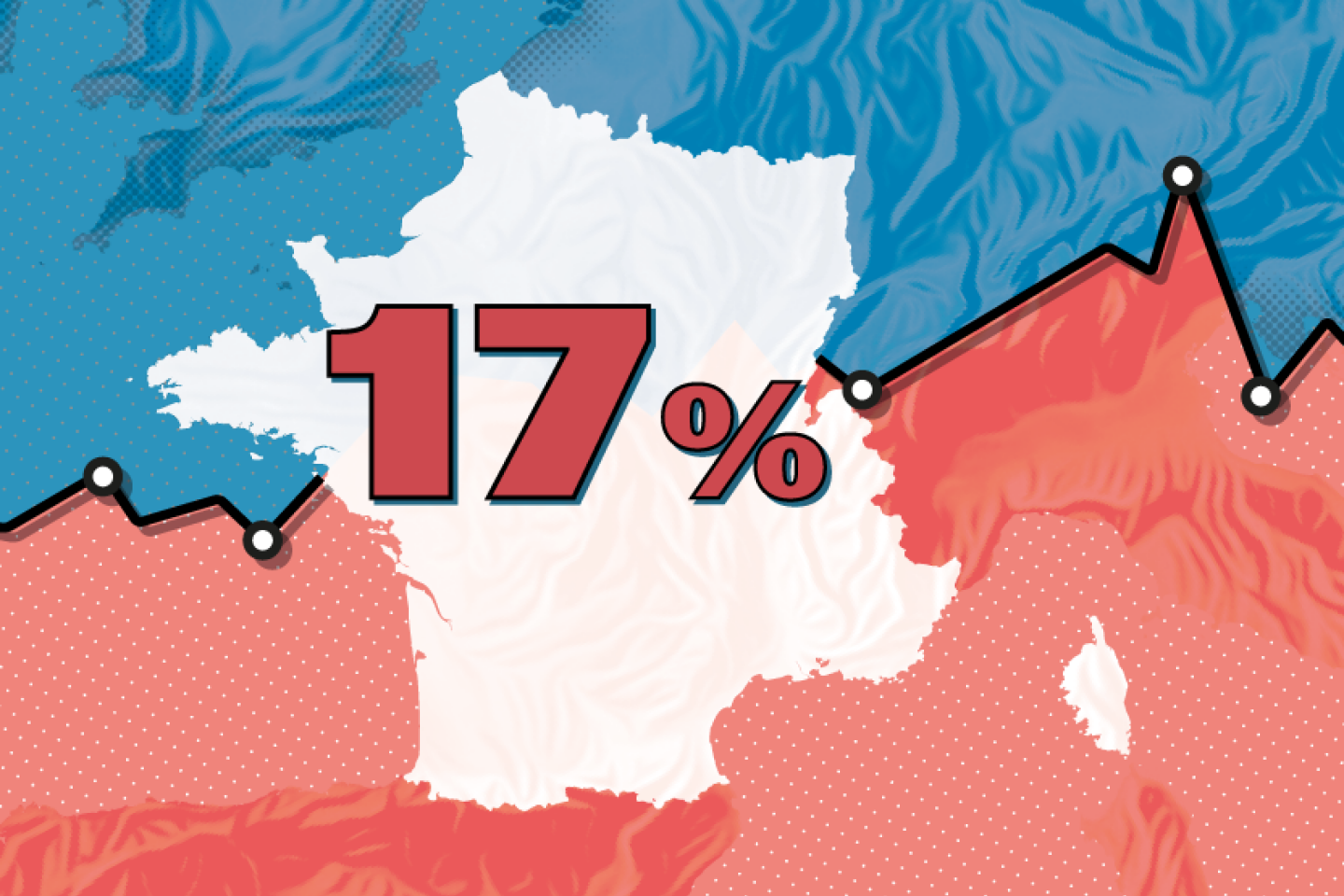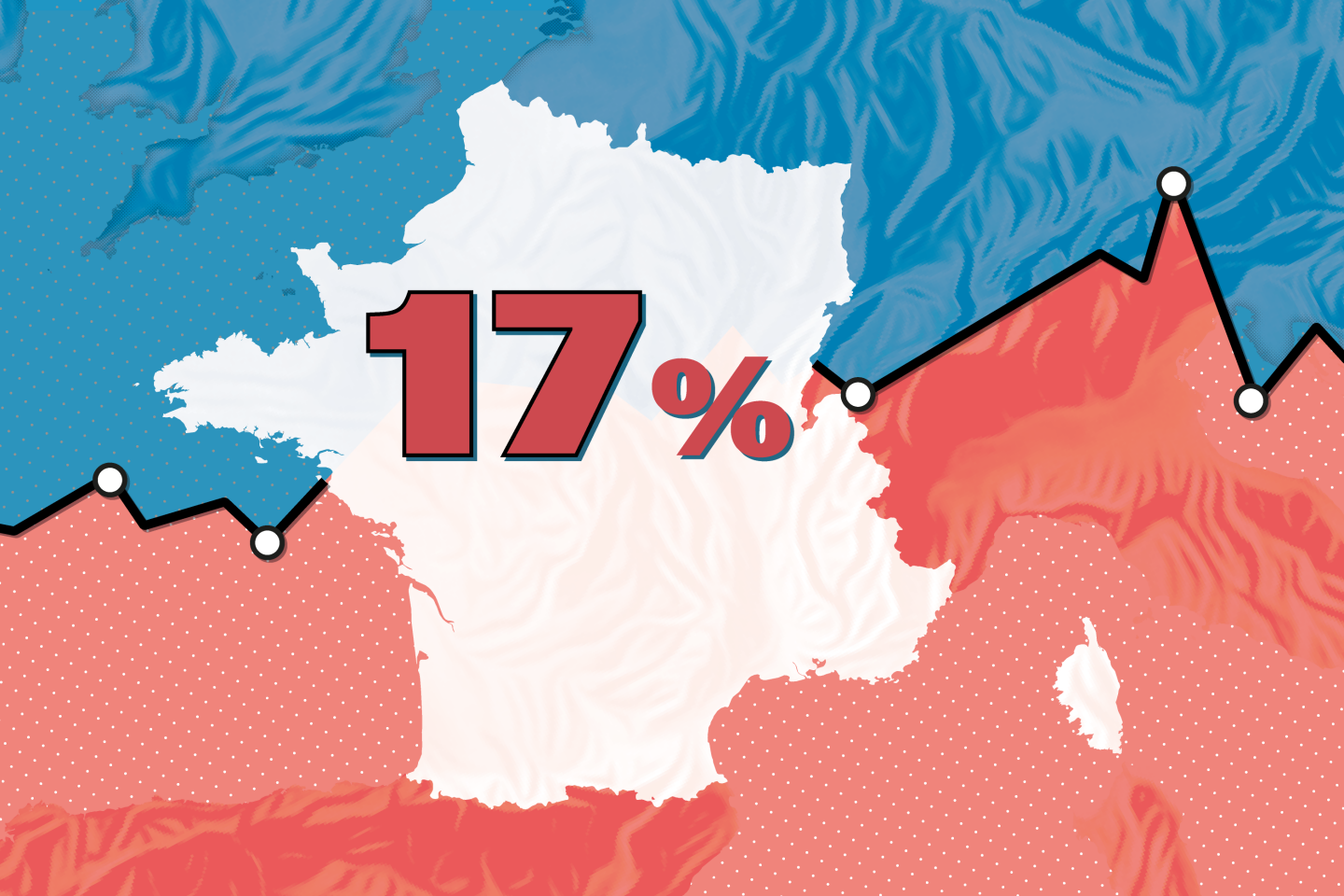En Allemagne, le syndicat IG Metall plaide pour la semaine de quatre jours à 32 heures

En Allemagne, le puissant syndicat de l’industrie IG Metall a mis la semaine de quatre jours en haut de son agenda. Lors des prochaines négociations dans la sidérurgie, qui débuteront cet automne, cette réduction du temps de travail figurera au cœur des revendications. IG Metall veut obtenir pour les travailleurs du secteur une semaine de trente-deux heures, avec compensation complète du salaire.
Depuis 1995, dans les industries du métal et de l’électronique, couvertes par les conventions collectives négociées par le syndicat, la semaine de travail est à trente-cinq heures, contre quarante heures dans le reste de l’économie, mais IG Metall ne compte pas s’arrêter là. Le syndicat, soutenu par la coprésidente du Parti social-démocrate (SPD), Saskia Esken, a lancé un large débat sur l’introduction de la semaine de quatre jours, à trente-deux heures de travail au maximum, plus largement dans l’économie.
Ils s’appuient sur des études récentes qui montrent que bénéficier de trois jours de repos par semaine améliore la satisfaction et l’efficacité des salariés, réduit les jours d’arrêt maladie… et augmente ainsi la productivité générale. IG Metall avance que la semaine de quatre jours serait même une solution contre le manque de personnel, endémique outre-Rhin.
Promesse de hausse de la productivité
Cette nouvelle organisation permettrait, selon le syndicat, de mieux concilier vie professionnelle et vie privée, offrant la possibilité à des « millions de femmes » actuellement contraintes au temps partiel ou à ne pas travailler en raison de leurs responsabilités familiales de revenir vers des emplois à plein temps plus attractifs.
Il s’agit aussi de s’ouvrir aux jeunes, très nombreux à souhaiter réduire leur temps de travail pour réaliser leurs projets personnels. Un sondage réalisé en septembre 2022 par la compagnie d’assurances HDI évalue ainsi à 75 % le pourcentage des travailleurs allemands désireux de passer à la semaine de quatre jours avec la même rémunération, avec une pointe à 83 % chez les moins de 40 ans, qui sont par ailleurs 17 % à envisager comme possible une réduction à quatre jours sans compensation de salaire.
« Une semaine de quatre jours avec compensation salariale pourrait contribuer de manière décisive à ce que l’industrie reste attractive pour les jeunes professionnels, expliquait Jörg Hofmann, président d’IG Metall, dans une interview au quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung, mi-avril. Compte tenu de l’évolution démographique et de la concurrence toujours plus forte pour une main-d’œuvre rare, c’est un facteur de réussite décisif. »
Il vous reste 41.3% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.