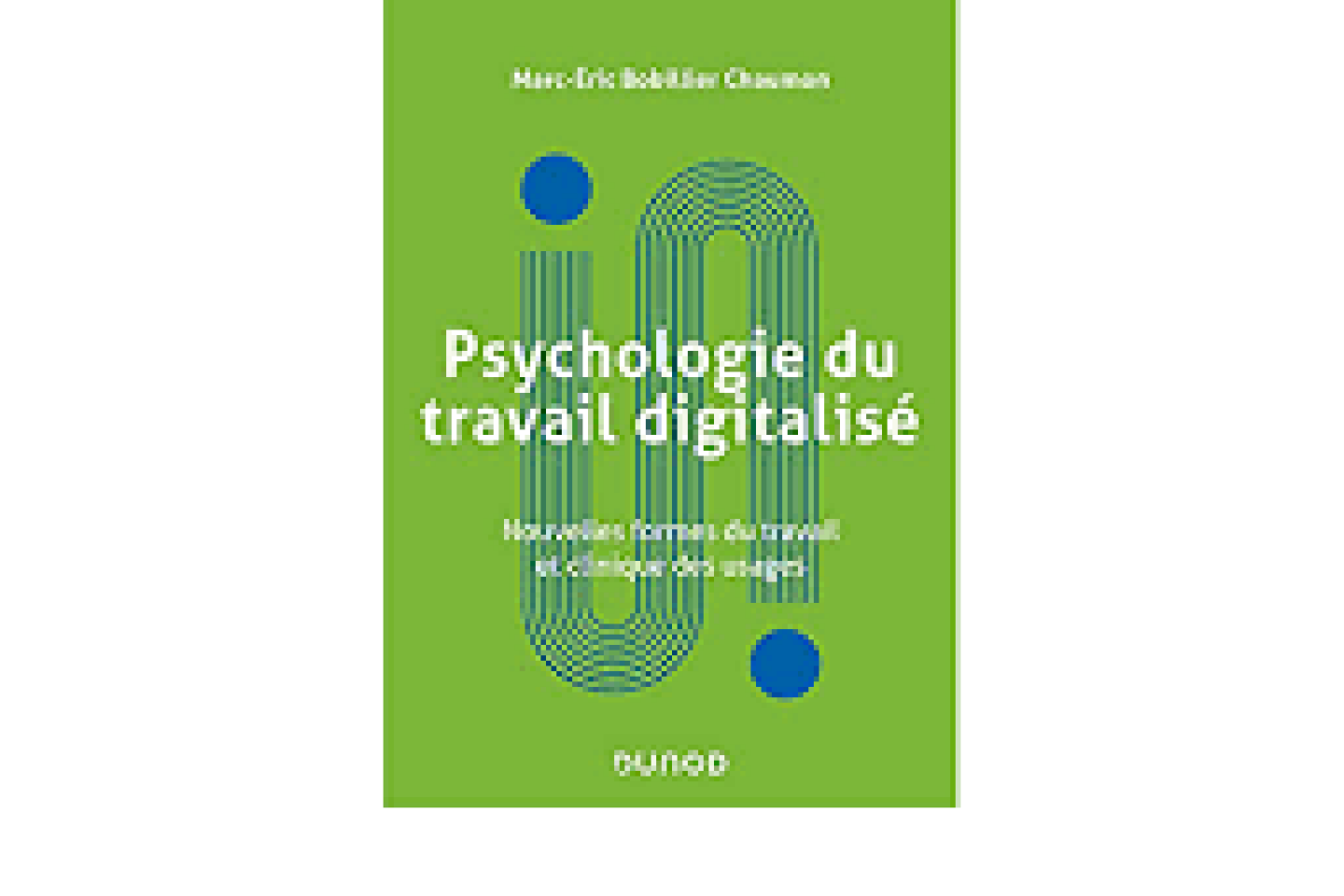Concours enseignants : à nouveau plusieurs milliers de postes non pourvus, qui confirment une crise structurelle

La crise n’est pas aussi aiguë qu’en 2022, mais elle est toujours là. Plus de 2 700 postes d’enseignant n’ont pas été pourvus à l’issue des concours de recrutement externes publics, selon les résultats publiés par le ministère de l’éducation nationale jeudi 6 juillet, faute de candidats au niveau en nombre suffisant.
Dans le premier degré, 1 584 places sont restées vacantes au concours de professeur des écoles, soit 16 % des postes ouverts, toutes concentrées dans les quatre académies de Mayotte, Guyane, Créteil et Versailles. Les vingt-six autres académies ont couvert l’intégralité de leurs besoins, et ont été autorisées à recruter les 1 581 candidats qu’elles avaient inscrits, en sus, sur les listes complémentaires.
Dans le second degré, l’agrégation pourvoit 97 % de ses postes mais presque un poste sur cinq reste en souffrance au capes, principal concours pour les professeurs de collège et de lycée. La situation est cependant contrastée entre les disciplines : l’histoire-géographie, les sciences de la vie et de la Terre ou encore la philosophie ont des listes de lauréats complètes, tandis qu’un quart des postes sont vacants en mathématiques et en physique-chimie, 20 % en lettres modernes, 58 % en allemand ou encore 70 % en lettres classiques.
Le déficit est plus marqué encore à l’issue du concours de recrutement des professeurs de lycée professionnel, où il manque 28 % des enseignants espérés. Une « hécatombe », selon le mot de Pascal Vivier, secrétaire général du Snetaa-FO, premier syndicat dans les lycées professionnels, pour un corps d’enseignants qui compte déjà plus de 14 % de contractuels, de loin le chiffre le plus élevé de tout l’enseignement public. « Nos élèves sont les plus fragiles scolairement, les plus défavorisés socialement, et ce sont eux qui ont les personnels les moins formés au métier », se désole le responsable syndical.
« Tout ne se résout pas en une année »
Au ministère de l’éducation nationale, on souligne « l’amélioration générale » des indicateurs du recrutement par rapport à 2022, lorsque la mise en place de la réforme de la formation déplaçant le concours à la fin du master 2 a conduit à laisser plus de 4 000 postes (20 %) vacants à l’issue des épreuves. « Cela nous permet d’aborder la rentrée 2023 de façon plus sereine que l’an dernier », assure-t-on, précisant que le recrutement de contractuels a été anticipé. Dans un changement de paradigme notable, le ministre, Pap Ndiaye, assume désormais le fait que ce volant de non-titulaires fasse partie intégrante du personnel de l’éducation nationale, sans qu’ils aient forcément vocation à devenir titulaires.
Il vous reste 65.38% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.