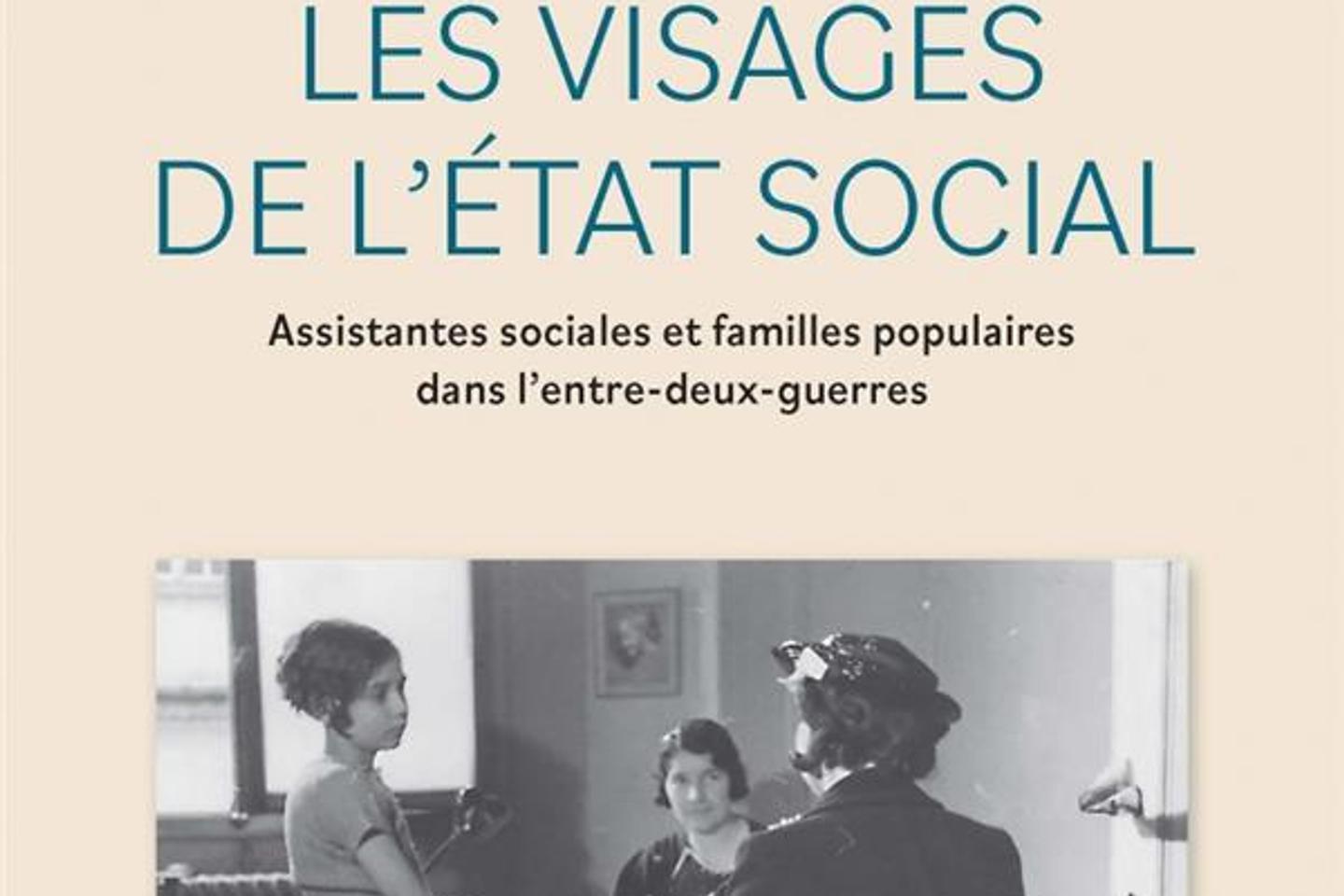Les salariés de Worldline, leader du paiement en ligne, en grève pour le « Black Friday »

Les salariés de Worldline le reconnaissent volontiers : « la culture de la grève » n’est pas dans leur « ADN ». Mais dans cette entreprise du CAC 40 comme ailleurs, l’inflation a réveillé la mobilisation collective. Pour la première fois depuis douze ans, la société spécialisée dans le paiement en ligne a connu six demi-journées de grève, cet automne, pour protester contre les propositions d’augmentations de salaire, jugées très en deçà des attentes, lors des négociations annuelles obligatoires anticipées pour 2023.
A savoir, 0,58 % d’augmentation générale, 3,57 % pour les augmentations individuelles et promotions. Quand l’inflation a atteint 6,2 % sur un an, et que le groupe se porte bien, avec un résultat brut d’exploitation en hausse de 25 % en 2021. « Franchement, 0,58 %, dans une boîte qui marche comme la nôtre, c’est se moquer de nous », s’indignaient des grévistes au pied de l’entreprise, à la Défense, à Puteaux, le 8 novembre.
Tout en affirmant avoir écouté « attentivement » les revendications des syndicats, la direction de Worldline explique au Monde, par écrit, devoir garder « à l’esprit qu’elle doit aussi garantir tout le reste des équilibres économiques de l’entreprise dans le contexte macroéconomique actuel incertain ». L’intersyndicale CFTC-CFDT-FO-CGT-CFE-CGC a lancé deux nouveaux appels à la grève, pour le « Black Friday », vendredi 25 novembre, et le « Cyber Monday », lundi 28 novembre, deux journées de soldes durant lesquelles l’activité explose sur les plates-formes de paiement.
1 050 signatures
Tout est automatisé, mais les grévistes préviennent qu’ils ne seront pas là pour rétablir le service en cas d’incident. Lors de la dernière grève, le 8 novembre, l’intersyndicale a compté près de 400 participants aux assemblées générales, sur 4 000 salariés en France (et 18 000 dans le monde). En outre, 1 050 d’entre eux ont signé la pétition qui rassemble leurs revendications. Soit un quart de l’effectif.
Ils demandent 150 euros brut d’augmentation par mois pour tous (contre entre 10 euros et 70 euros, proposés par la direction en deux fois, d’ici à juillet 2023) pour « couvrir l’inflation galopante », et 2 500 euros d’intéressement, pour une « plus juste redistribution de la marge réalisée par l’entreprise ». En juin, c’est le rejet commun d’un accord d’intéressement jugé « incohérent » qui a soudé l’intersyndicale. Aujourd’hui, la direction propose une « prime de partage de la valeur » de 1 600 à 2 000 euros, qu’elle conditionne à l’amélioration de la marge du groupe.
Il vous reste 63.02% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.