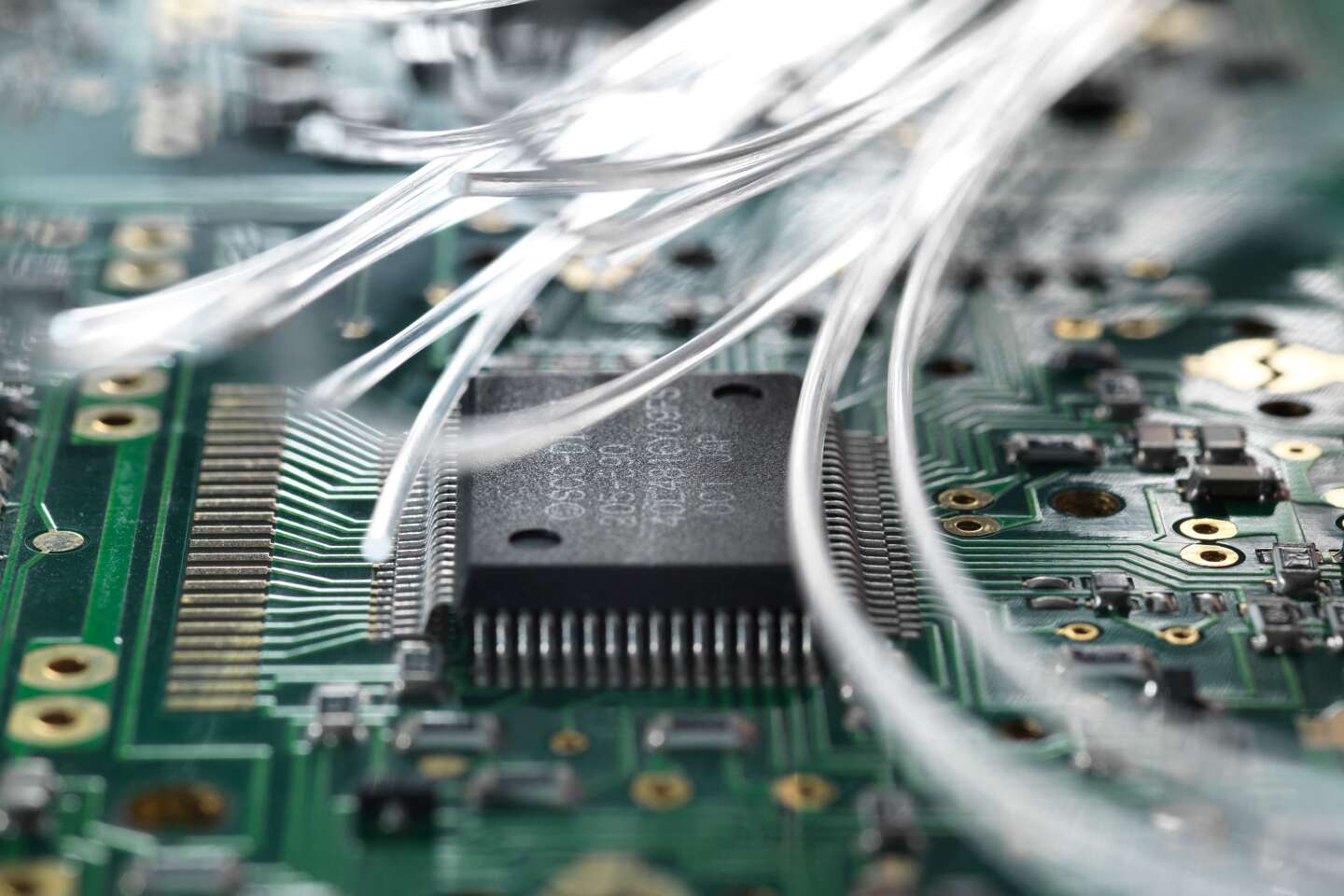L’écosystème des start-up affirme vouloir renforcer la lutte contre les discriminations

Inciter les plus gros fonds d’investissement à mettre au premier plan les questions de diversité, pour espérer que cela pousse les start-up à s’interroger davantage sur le sujet : telle est la stratégie du programme Tech Your Place, mené par l’association d’égalité des chances Diversidays et la fondation Mozaïk RH.
Ce mouvement a accueilli, lundi 17 octobre, douze nouveaux adhérents, tous des fonds (parmi lesquels Eurazeo, Alter Equity ou encore Ring Capital), qui se sont engagés à mettre en place une série de mesures en interne pour lutter contre toutes formes de discriminations (handicap, genre, origine, orientation sexuelle…), notamment à l’embauche.
Si le secteur associatif et les initiatives pour plus de diversité foisonnent déjà dans la « tech », les résultats sont plus qu’insuffisants. C’est d’ailleurs le constat d’une étude menée par Diversidays, et présentée en amont des annonces du soir, au ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Une démarche nécessaire
Réalisée en ligne début 2022 avec Occurrence et PwC auprès de 1 004 salariés français, auxquels s’ajoute un échantillon de 95 répondants travaillant ou ayant travaillé dans une start-up, cet état des lieux de l’inclusion dans l’écosystème montre un paradoxe : alors que 78 % des salariés ont une bonne opinion des start-up, seuls 20 % d’entre eux ont déjà envisagé de postuler au sein d’une de ces « jeunes pousses » (le chiffre tombe à 9 % pour les répondants sans diplôme, 8 % pour ceux entre 46 et 60 ans).
Quand on leur demande les critères susceptibles de restreindre le recrutement au sein de ces entreprises, les salariés évoquent le niveau de diplôme (pour 50 % d’entre eux), l’âge (48 %), l’origine géographique (16 %), l’origine sociale (15 %), l’origine ethnique (14 %) et enfin le genre (14 %). Autre donnée marquante, les salariés en start-up sont 39 % à déclarer avoir été victimes d’au moins une situation de discrimination lors de leur embauche, et 40 % ont été témoin d’une discrimination.
Les nombreux dirigeants présents à Bercy ont tous évoqué librement ce « problème ». « Les fondateurs sont quand même souvent des mâles blancs qui ont fait de belles études, ça me terrifie, assume Benoist Grossmann, CEO d’Eurazeo. On a donc choisi d’intégrer ces processus d’inclusion de manière officielle. »
De l’importance du passage à l’acte
Pour progresser, le mouvement Tech Your Place impose aux adhérents qu’il accompagne − notamment sur la formation à la lutte contre les discriminations et le recrutement inclusif − de respecter une dizaine de principes, parmi lesquels : insérer systématiquement une clause « inclusion et diversité – égalité des chances » dans les pactes d’investissement, comprenant notamment la mise en place d’une politique inclusion et diversité au sein des entreprises financées ; mettre en œuvre une politique d’inclusion et diversité dans leur propre organisation et, surtout, « mesurer l’efficience de cette politique avec des indicateurs chiffrés pertinents et outils adaptés », ainsi que publier leurs résultats annuels sur leur site internet ; ou encore, nommer au moins un référent inclusion et diversité.
Il vous reste 47.65% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.