« Une fondation actionnaire suppose une vision de long terme, la volonté de contribuer à l’intérêt général et d’inventer une nouvelle gouvernance »
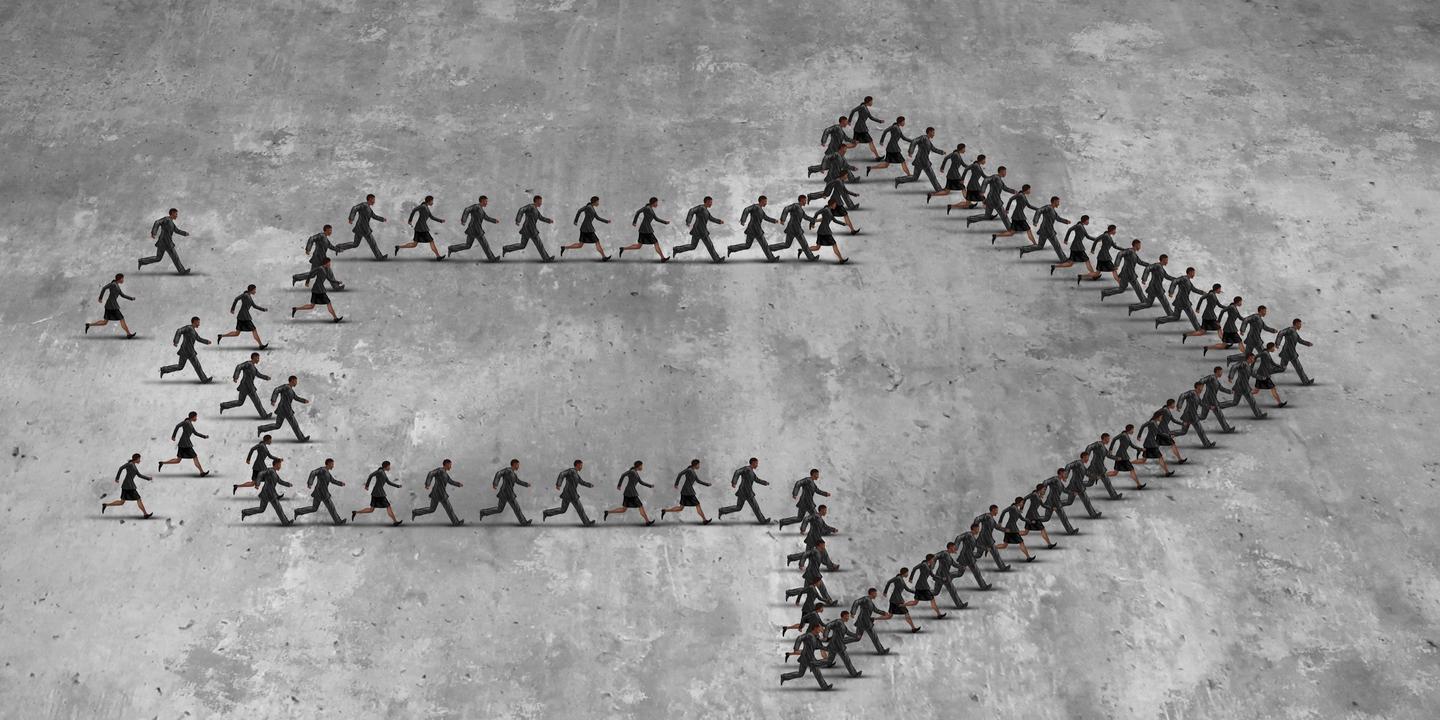
Tribune. Les protagonistes de l’opération financière qui fait actuellement la une de la presse économique entre Veolia et Suez semblent à première vue donner plus de visibilité à la loi du 22 mai 2019 « relative à la croissance et la transformation des entreprises », dite loi PACTE : Veolia, Suez et Engie ont élaboré leurs « raisons d’être », tandis que Meridiam est une « société à mission », deux innovations phares de cette loi.
Pourtant, l’évolution de leurs modèles de gouvernance se heurte à la dure réalité d’un capitalisme actionnarial, qui n’a jamais eu pour usage de s’encombrer des intérêts des parties prenantes. Pour se protéger du rachat de Véolia, Suez a ainsi décidé de transférer les titres de sa filiale eau au sein d’une fondation de droit néerlandais, non par préoccupation philanthropique, mais pour défendre ses intérêts en devenant temporairement incessible à son concurrent.
Avant cela, Patrick Drahi avait créé un fonds de dotation pour y loger les titres du journal Libération. Y-a-t-il de sa part une sincère et véritable intention philanthropique qui a pour but la préservation des intérêts de Libération et, au-delà, la liberté et l’indépendance de la presse ? Si personne n’est dupe, il serait préjudiciable que ces initiatives jettent le discrédit sur le bien-fondé d’un modèle très exigeant et vertueux : celui de la fondation actionnaire, dont elles semblent être une pâle imitation.
Intérêt général et préservation du capital et de l’emploi
Transmettre une entreprise à une fondation ne consiste ni à s’en débarrasser, ni à augmenter son pouvoir de négociation dans le cadre de tractations commerciales, ni à s’enrichir personnellement. La création d’une fondation actionnaire est un engagement majeur, qui suppose une vision de long terme, la volonté de contribuer à l’intérêt général par des actions philanthropiques, et la conviction que le modèle capitaliste traditionnel s’essouffle et qu’il faut inventer de nouveaux modes de gouvernance et de propriété.
Renoncer à vendre une entreprise pour la transmettre à une fondation ou à une structure d’intérêt général assimilée requiert détermination et altruisme. Aujourd’hui, en France, une quinzaine de fondateurs et propriétaires d’entreprises françaises, réunis au sein de la communauté De Facto, se sont engagés sur la voie de la fondation actionnaire. Ils ont décidé de transférer tout ou partie de leurs titres de façon irréversible à une structure à but non lucratif, d’intérêt général et sans propriétaires.
Il vous reste 36.12% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.







