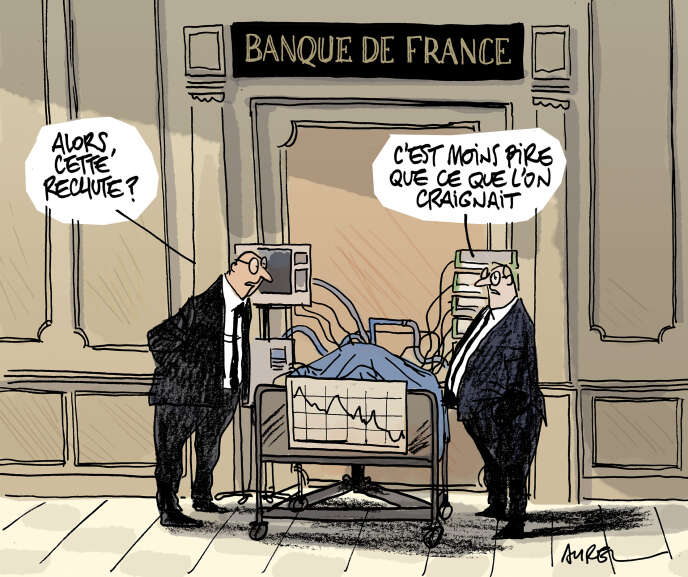Cordes et âmes : Mirecourt, terre de luthiers

PASCAL BASTIEN POUR « LE MONDE »
ReportageC’est dans ce village des Vosges que de prestigieux instruments à cordes utilisés par les meilleurs solistes de la planète sont fabriqués. Un savoir-faire perpétué par une poignée d’artisans d’exception.
Dans la plaine lorraine, un ciel anthracite pèse de toute sa masse sur l’horizon. Ce sont déjà les Vosges, mais pas encore ses reliefs. Des champs, des pâturages, des chênaies, un paysage presque plat, clôturé, imprégné de crachin, cerne Mirecourt en cette fin d’après-midi. Dans le village, les rues alignent leurs crépis abîmés jusqu’au centre-bourg, où la pointe effilée du clocher semble vouloir écorcher le coton gris des nuages.
« Nous subissons la concurrence de la Chine, mais eux utilisent des procédés industriels, pour aller vite. Alors que nous, nous avons besoin de lenteur », Alain Carbonaré, luthier à Mirecourt.
Mirecourt n’aimante pas autant les touristes que les thermes de Contrexéville et de Vittel, tout proches. Le village a pourtant du charme, avec sa rivière, le Madon, qui serpente sagement à l’ombre des tilleuls jaunis, des halles voûtées et des portes du centre-ville, qui ouvrent parfois, au bout d’étroits couloirs, sur d’incroyables cours Renaissance aux escaliers somptueusement décorés… Et c’est grâce à lui que la France chante et danse depuis près de cinq siècles.

A l’orée du XVIIe siècle, c’est ici, dans le chef-lieu d’un des grands bailliages du duché de Lorraine, qu’apparaissent les premiers « faiseurs » de violons. Là que naissent des dynasties de luthiers et d’archetiers, puis les grandes fabriques, au milieu du XIXe, qui accélèrent la cadence, employant jusqu’à 800 salariés. Violons, violoncelles, altos, contrebasses, guitares, orgues… A un tempo soutenu, le village inonde le pays de dizaines de milliers d’instruments, avant que le succès de la musique enregistrée puis la crise des années 1930 sonnent la fin du bal.
Enfin, pas tout à fait. Les politiques locaux ont mis beaucoup d’argent sur la table pour que le savoir-faire ne quitte pas le village. Une école de lutherie, aujourd’hui renommée, a été ouverte en 1970, puis un musée, trois ans plus tard, qui borde aujourd’hui le Madon. Mais surtout, une poignée de résistants, une quinzaine de luthiers et d’archetiers, fabrique toujours des pièces d’exception. Grâce à eux, c’est encore ici que s’écrit l’histoire presque mystique des plus prestigieux instruments à cordes français, qui passeront entre les mains des meilleurs solistes de la planète. Sur rendez-vous, ces « artistes du bois » ouvrent les portes de leurs ateliers aux visiteurs de passage.

Derrière le large portail de la maison-atelier d’Alain Carbonaré, on devine, entreposé dans une grange, un amoncellement de bûches débitées en quartiers. Le bois encombre en fait les deux étages de sa vaste demeure. Le couloir de l’entrée est enseveli sous une forêt de planches, des carcasses d’instruments aux courbes féminines sont suspendues aux murs, tandis que sur le sol se tortillent dans la sciure, comme des mèches blondes et bouclées, d’innombrables copeaux de bois.
Il vous reste 68.37% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.