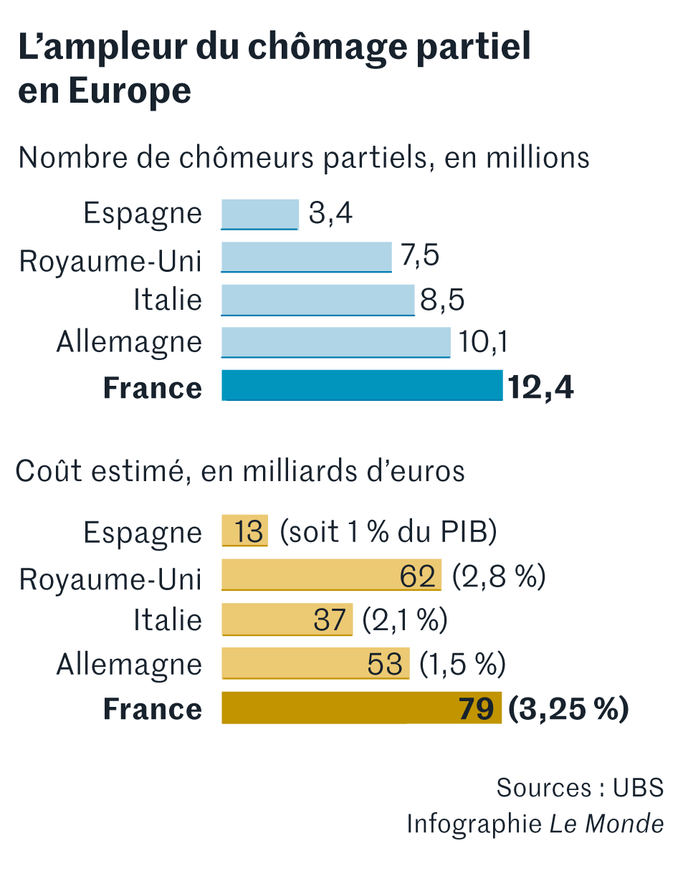Amazon entame la réouverture de ses six entrepôts en France

La bataille entre les syndicats et la direction d’Amazon, qui s’opposent sur les mesures de protection apportées aux salariés, connaît une trêve. Le spécialiste de la vente en ligne a annoncé, mardi 19 mai, renoncer à se pourvoir en cassation.
Saluant dans un communiqué la réouverture mardi de son entrepôt de Brétigny-sur-Orge (Essonne), la direction d’Amazon France dit se « réjouir que le dialogue avec les représentants du personnel, conduit dans une logique d’amélioration continue, permette d’aboutir à une reprise sereine et durable ».
« Au terme de la consultation, les deux parties ont accepté d’abandonner les recours en cours », ajoute le communiqué, précisant que « cela inclut la décision de porter notre affaire devant la Cour de cassation ».
Une reprise du travail sur la base du volontariat
Les six entrepôts d’Amazon en France étaient fermés depuis le 16 avril, à la suite de deux jugements enjoignant à l’entreprise de procéder à une évaluation des risques liés au coronavirus avec les représentants du personnel.
La cour d’appel de Versailles avait confirmé le 24 avril une ordonnance du 14 avril qui demandait à Amazon de limiter son activité à des produits essentiels (informatique, santé, nutrition, épicerie…) sous astreinte de 100 000 euros par infraction.
Le géant du commerce en ligne, jugeant impossible de se plier à cette contrainte sans risquer d’infraction, avait préféré fermer ses entrepôts, tout en poursuivant les livraisons depuis ses plates-formes à l’étranger. La justice relevait des manquements de sécurité, notamment dans les vestiaires ou aux portiques d’entrée, et surtout demandait à Amazon de consulter les représentants du personnel et non d’imposer unilatéralement des mesures.
Un accord a finalement été trouvé vendredi avec les organisations syndicales CFDT, CGT, FO et SUD. « Nos sites sont sûrs et l’ont toujours été », assure le communiqué mardi. A la suite d’une procédure de consultation et d’information avec les comités socio-économiques de l’entreprise, ils « ont pu reprendre leur activité avec un socle de mesures déjà en place avant la suspension d’activité, auxquels ont pu être apportés quelques ajustements ».
La reprise à 100 % doit s’étaler sur trois semaines, les salariés reprenant le travail « sur la base du volontariat », a précisé mardi le directeur général d’Amazon France, Frédéric Duval.