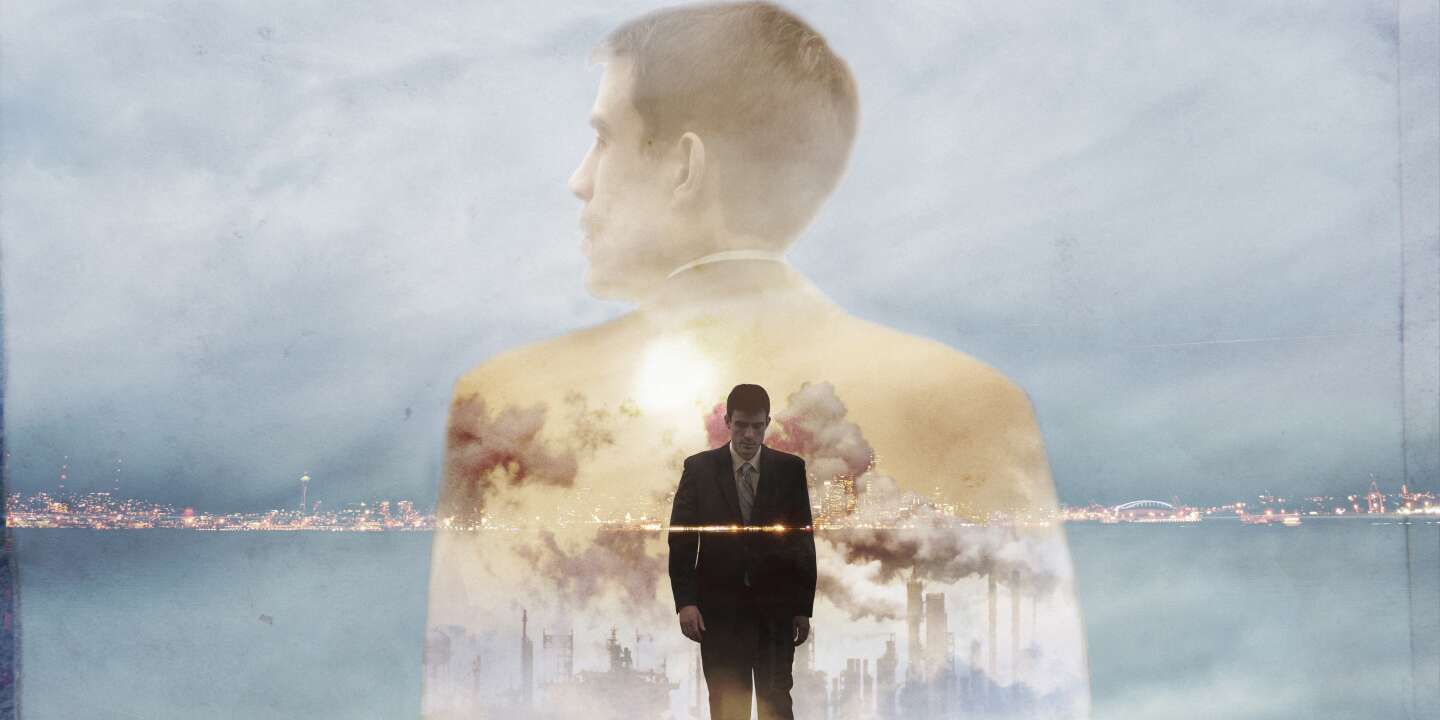Chômage partiel : les élus du personnel dénoncent des abus
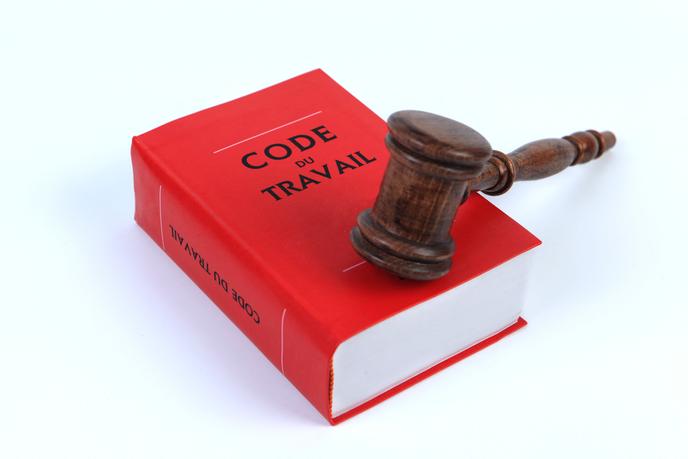
Plus de la moitié des élus et responsables syndicaux interrogés dans le cadre d’une étude du cabinet Technologia, dont l’entreprise a eu recours au chômage partiel, déclarent que des salariés sous ce dispositif ont continué à travailler. Sur les réseaux sociaux circulent des témoignages de salariés mis au chômage partiel, alors qu’ils ont poursuivi leur activité.
On soupçonnait l’existence de tels abus, mais le phénomène restait difficile à quantifier. Alors que le nombre de salariés mis au chômage partiel a atteint des sommets en avril, une étude du cabinet de conseil en prévention des risques professionnels Technologia donne une première idée des fraudes potentielles concernant le recours par les entreprises à ce dispositif, assoupli suite à la crise du Covid-19. Et leur ampleur interroge.
A en croire les réponses des 2 620 élus et responsables syndicaux qui ont été interrogés dans le cadre de cette étude en avril, les salariés qui ont continué à travailler sur leurs dossiers ou à répondre aux sollicitations de leurs clients pendant leur période de chômage partiel sont légion.
Plus de la moitié des élus, dont l’entreprise a eu recours à ce dispositif, estime qu’il y a eu des abus. Dans le détail, 24 % déclarent que des employés au chômage partiel auraient poursuivi leur activité à la demande de l’employeur dans leur entreprise. D’autres ont continué à travailler de leur propre initiative, rapportent 28 % des élus.
Un investissement motivé par la « peur de perdre leur emploi », avance le cabinet Technologia : la crise économique inciterait ces salariés à maintenir leur activité coûte que coûte, « dans une démarche sacrificielle ». Paradoxalement, ce dévouement peut causer du tort à l’entreprise : même si le salarié poursuit de lui-même son activité pendant sa période de chômage partiel, son employeur est dans l’illégalité.
Enfin, des élus rapportent que des salariés au chômage partiel auraient été appelés par leur manager (30 %) et/ou leur dirigeant (11 %) dans leur entreprise.
Rappelons que le salarié doit complètement cesser son activité s’il est mis au chômage partiel total. Même un simple coup de fil, pour savoir où en en est un dossier par exemple, est prohibé. Dans le cas où il continue de travailler partiellement, son entreprise doit le rémunérer à hauteur des heures travaillées.
Effet d’aubaine
Si l’ampleur des abus dénoncés dans cette enquête ne manque pas de surprendre, des voix se sont déjà élevées pour pointer les potentiels effets d’aubaine de ce dispositif, qui offre la prise en charge par l’Etat de la quasi-totalité du salaire. Sur les réseaux sociaux circulent des témoignages de salariés mis au chômage partiel et qui ont tout de même poursuivi leur activité.
Il vous reste 55.75% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.