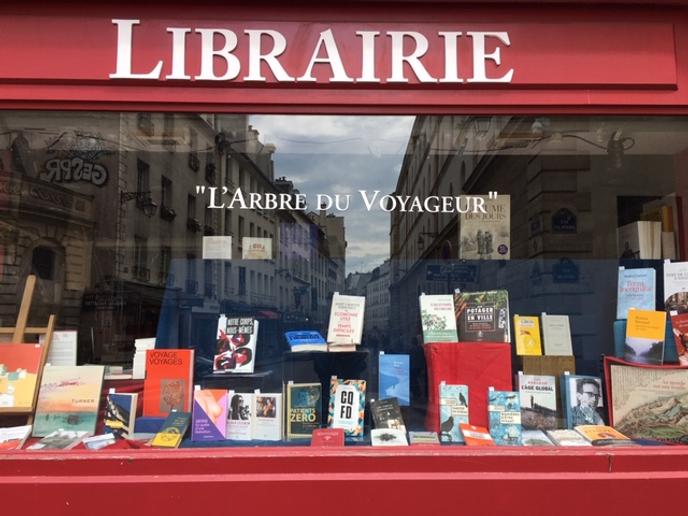Les contrastes de l’innovation sociale
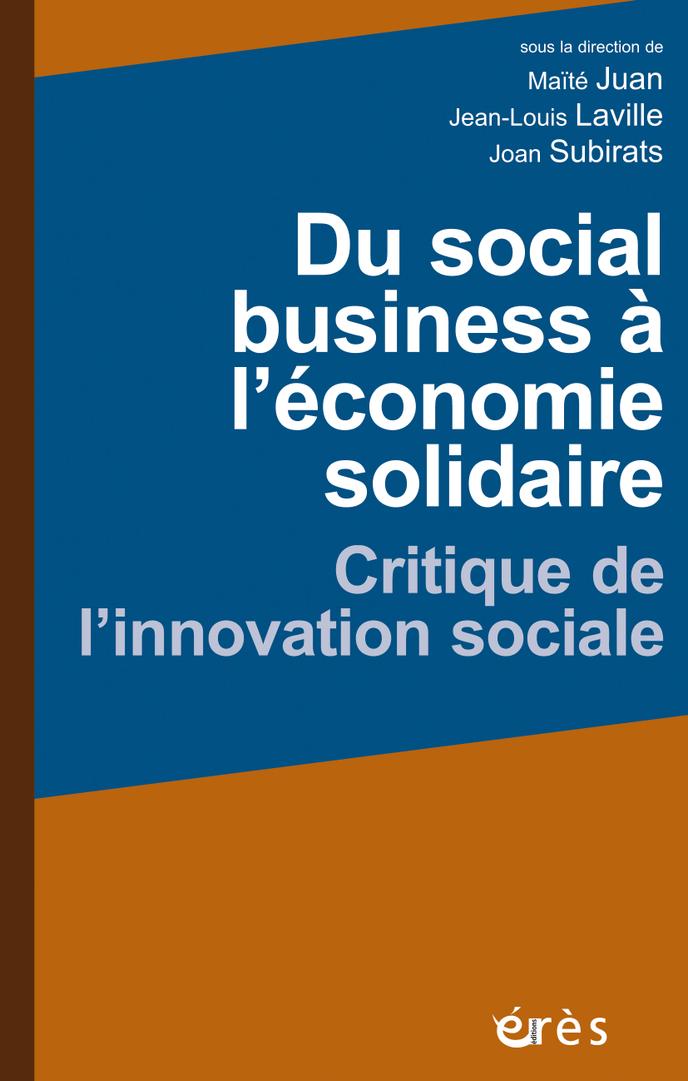
Le livre. Méfiez-vous de l’éloge unanime de l’innovation sociale : le consensus autour de sa virtuosité dérive de la variété de représentations et de pratiques englobées sous cette appellation. « Cette polysémie permet à de nombreux auteurs de se ranger sous une même bannière alors qu’ils ont des références et des orientations distinctes, voire divergentes », soulignent Maïté Juan et Jean-Louis Laville dans Du social business et à l’économie solidaire (Erès), un ouvrage que la docteure en sociologie et le professeur au Conservatoire national des arts et métiers dirigent avec le professeur en sciences politiques Joan Subirats.
Deux acceptions contrastées de l’innovation sociale se font face.
La première version, « qui peut être qualifiée de faible », aménage le système existant et valorise l’entreprise privée dans sa capacité à trouver de nouvelles solutions aux problèmes de société.
La seconde version affiche une visée transformatrice et prône, en réaction à la démesure du capitalisme marchand, une articulation inédite entre pouvoirs publics et société civile pour répondre aux défis écologiques et sociaux. Depuis quelques années, des restrictions budgétaires importantes ont favorisé la première version. Cette « instrumentalisation de l’innovation sociale par le néolibéralisme » est détaillée dans la première partie de l’ouvrage, qui décrit le tournant néolibéral de l’innovation sociale grâce à des contributions sur l’Amérique du Nord, l’Asie et l’Europe.
Un gage de changement
Expérimentations démocratiques œuvrant à la création de services d’utilité sociale, à la mobilisation des sans-voix, à la mise en œuvre des modalités alternatives de consommation, ou encore à des formes d’autogouvernement citoyen… la seconde version n’a pas disparu pour autant. « Très présentes sur le terrain, les initiatives citoyennes sont délaissées au profit de démarches plus managériales et pourtant beaucoup moins répandues. » Ce « déni de démocratie en matière d’innovation sociale » est développé dans la deuxième partie de l’ouvrage.
Engagées dans une lutte pour leur reconnaissance, ces initiatives se heurtent « aux mécanismes technocratiques dans la gouvernance des territoires, excluant les citoyens ordinaires du débat public, ainsi qu’à des logiques d’évaluation quantitative qui ne permettent pas de mesurer finement leur utilité sociale ». La mise en visibilité de ces expérimentations dépendrait alors de l’avènement de nouvelles relations entre science et société, aptes à mettre en valeur la pluralité des formes de connaissance. « Les recherches participatives, en plein essor, peuvent jouer ce rôle car elles interrogent le monopole de l’expert dans la production et la validation du savoir. »
Il vous reste 20.91% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.