Le mérite est la « bonne attention des gagnants du système »
David Guilbaud, technocrate issu de la classe moyenne, déconstruit le mythe d’un système scolaire français qui admettrait l’ascension sociale. Selon lui, l’idée que « quand on veut, on peut » est en conflit avec « la rigidité de notre société ».
Le principe du mérite agit comme une fiction très forte, notamment parce qu’il donne « bonne conscience » aux gagnants du système. C’est ce que démontre David Guilbaud, 26 ans, haut fonctionnaire, ancien élève de Sciences Po et de l’ENA, dans l’essai L’Illusion méritocratique, publié fin 2018 chez Odile Jacob. Originaire de Rennes, David Guilbaud est issu de la classe moyenne, avec un père cadre qui a connu de longues périodes de chômage et une mère qui a débuté des études supérieures sur le tard. Il raconte son expérience et sa pédagogie des codes de « l’élite » parisienne.
« Vous êtes l’élite de la nation » : voilà le genre de phrase que les étudiants de Sciences Po entendent dès leur arrivée, comme vous l’écrivez dans votre livre. Pourquoi cela pose-t-il problème ?
Ce genre de phrase collabore à ancrer dans l’esprit des étudiants qu’ils sont, par essence, différents des autres, que s’ils sont là, c’est parce qu’ils ont davantage de valeur que les autres. Pourtant, dans le cas de Sciences Po, ce ne sont jamais que des jeunes de 18 ans qui ont réussi un concours, certes exigeant mais reposant sur l’apprentissage d’une méthode et la mémorisation d’un contenu. Cette phrase acte le fait qu’avec l’étiquette donnée par la grande école, l’élève n’aura plus à faire ses preuves, ou en tout cas profitera partout et tout le temps d’un a priori favorable.
Ce genre de discours existe pareillement ailleurs, à l’ENA notamment : il alimente le sentiment que les élèves sont d’une valeur telle qu’ils peuvent se suffire à eux-mêmes et que, quel que soit leur poste, ils pourront s’en sortir grâce à leurs qualités personnelles. C’est mauvais pour le fonctionnement de l’administration et pour l’intérêt général, car l’une des qualités premières des cadres de la fonction publique doit être de savoir assister avec leurs collègues et écouter leurs critiques.
Vous faites le portrait-robot d’un diplômé type de Sciences Po, mélange d’« arrogance tranquille » et de « mépris souriant », qui n’a pas connu de vraies difficultés mais aime « donner des leçons sur la valeur travail ». N’est-ce pas ces caractéristiques qui sont reprochées au gouvernement actuel ?
L’idée que « quand on veut, on peut » est en contradiction avec la rigidité de notre société et du marché de l’emploi. Les jeunes ont le sentiment que tout est joué dès la sortie de l’école et, de fait, les destins sociaux sont largement déterminés à l’âge de 30 ans. Cette impression de blocage n’est sans doute pas sans lien avec ce qui se passe actuellement.
De même, il est assez impressionnant de voir que toutes les analyses sur les « gilets jaunes » se concentrent sur la manière dont le mouvement s’exprime, alors que le véritable sujet est de comprendre pourquoi cela est arrivé. Ce mouvement est la traduction concrète de cette réalité sociale que nient précisément les discours méritocratiques du type « quand on veut on peut ». La violence de ce discours a été exaspérée par certaines petites phrases, critiquées pour le mépris social qu’elles incarnaient : là se trouve sans doute un facteur conjoncturel majeur dans l’embrasement du mouvement des « gilets jaunes ». Si on est démocrate, on ne peut que se réjouir de constater que, chez ceux qui manifestent, s’affiche une volonté de se réapproprier leur destin social.
Vous parlez à plusieurs répétitions de « l’indigence » de certains enseignements dans les grandes écoles…
Le contenu de la scolarité à l’ENA telle que je l’ai vécue était insuffisant. Aucun sujet de fond ne pouvait être creusé, faute de temps. A cela s’ajoute la pression des « épreuves de classement », qui encouragent une logique utilitariste chez les élèves et les détourne, donc, de cet effort intellectuel. Parce que l’ENA se considère comme une école d’application, le cursus est construit sur le postulat que l’essentiel des contenus intellectuels nécessaires a déjà été intégré pour le concours. C’est une erreur, car cela corrobore qu’une réflexion de fond sur les enjeux auxquels nous sommes confrontés dans nos métiers de hauts fonctionnaires n’est finalement pas obligatoire tant que nous sommes de bons techniciens.
Pour les oraux de l’ENA, vous écrivez que « la joute d’esprit, la repartie, (…) la détente sans l’insolence… » sont autant de qualités maîtrisées par les enfants des classes supérieures…
A l’oral de l’ENA, il faut présenter qu’on fait partie du même monde que l’examinateur, tout en sachant rester humble, et arriver, pour les plus doués, à glisser un mot d’esprit subtil au moment juste. C’est presque du théâtre. C’est pour cela qu’il est très compliqué d’apprendre à se comporter « convenablement » quand on vient d’un milieu social qui n’a pas ces codes culturels. L’apprentissage de ces savoir-être est long, difficile et jamais complètement réussi – il subsiste toujours quelque chose d’un peu forcé, d’un peu artificiel chez ceux qui n’y ont pas été sensibilisés sur le temps long.
D’où vient historiquement cette notion de méritocratie ?
Le terme a été forgé par le sociologue Michael Young [1915-2002], au milieu du XXe siècle, mais notre rapport au mérite, sur un plan politique, est lié à l’héritage de la Révolution française. C’est un principe de légitimation qu’il a été nécessaire de mettre en avant pour justifier la fin des privilèges féodaux et soutenir la montée en puissance politique et économique de la bourgeoisie. C’est l’affirmation qu’il existe une égalité en droit des individus : vision théorique, idéalisée, d’un monde où la réussite n’est plus déterminée par la naissance mais par les efforts de chacun.
« La méritocratie est un principe de légitimation puissant pour les catégories sociales dominantes, qui peuvent proclamer qu’elles ont mérité leur sort. »
C’est évident que cette idée occulte le fait que les conditions économiques et culturelles dans lesquelles grandit un enfant affectent sensiblement ses perspectives dans la société. Cette fiction est un principe de légitimation extrêmement puissant pour les catégories sociales dominantes, qui peuvent proclamer qu’elles ont mérité leur sort.
Mais la mobilité sociale est de nos jours relativement limitée : en 2009, seuls 18 % des enfants de salariés connaissaient une trajectoire sociale ascendante d’ampleur, c’est-à-dire les voyant accéder à un emploi de cadre supérieur alors que leurs parents étaient employés ou ouvriers. Un parcours comme celui de Pierre Bourdieu, fils de petit fonctionnaire, devenu professeur au Collège de France, est désormais, sinon impossible, en tout cas plus difficile. Par ailleurs, cette évolution n’est ni un processus à sens unique ni une dynamique irréversible : certains individus connaissent ainsi une trajectoire « descendante », qui les conduit à une position sociale moins favorable que celle dont bénéficiaient leurs parents. Le sociologue Camille Peugny a ainsi montré que les risques de mobilité sociale descendante étaient plus élevés pour les enfants de cadres lorsque leurs parents étaient issus de milieux dits « populaires ».
Pourquoi les dispositifs d’égalité des chances des grandes écoles manquent-ils leurs objectifs ?
Ils fonctionnent ponctuellement, parce qu’ils permettent à une poignée d’étudiants venant de milieux défavorisés de s’en sortir. L’expérience n’est d’ailleurs pas toujours rose pour ceux qui en bénéficient : parfois, l’étiquette « égalité des chances » colle à la peau. Je me souviens que, lorsque nous avons été admis à l’ENA, le directeur de Sciences Po avait fait une conférence devant les lauréats en soulignant que l’un d’entre nous venait des CEP [conventions éducation prioritaire]. Un hommage, de son point de vue, mais aussi, inconsciemment, le rappel que l’intéressé restait marqué par cette filière « différente » par laquelle il était entré à Sciences Po. L’adaptation des élèves concernés au nouveau milieu social auxquels ils accèdent est souvent difficile : une enseignante à Sciences Po m’expliquait ainsi qu’elle reconnaissait tout de suite les copies des CEP, parce qu’elles étaient plus « scolaires ». La carence de maîtrise de la culture légitime est aussi un handicap, dans un milieu où certains savent manier leur connaissance de l’opéra pour marquer leur appartenance à une certaine classe sociale.
Principalement, la principale délicat que l’on peut faire sur ces dispositifs est qu’ils ne changent hélas rien au problème systémique. Ce qui ne signifie pas qu’il faille les abandonner : si l’on parvient ainsi à permettre à un étudiant de s’en sortir, c’est toujours cela de pris. Mais politiquement, ils ont un effet pervers : celui de servir de « bonne conscience » aux défenseurs d’une organisation sociale inégalitaire dont ils bénéficient, et à laquelle ils doivent le fait qu’ils se situent en haut de la pyramide. Il faut donc faire l’effort de penser plus loin : à court terme, poursuivons les actions pour l’« égalité des chances », mais à long terme, interrogeons-nous sur les moyens d’atteindre une plus grande égalité des places en réduisant les différences dans la société.








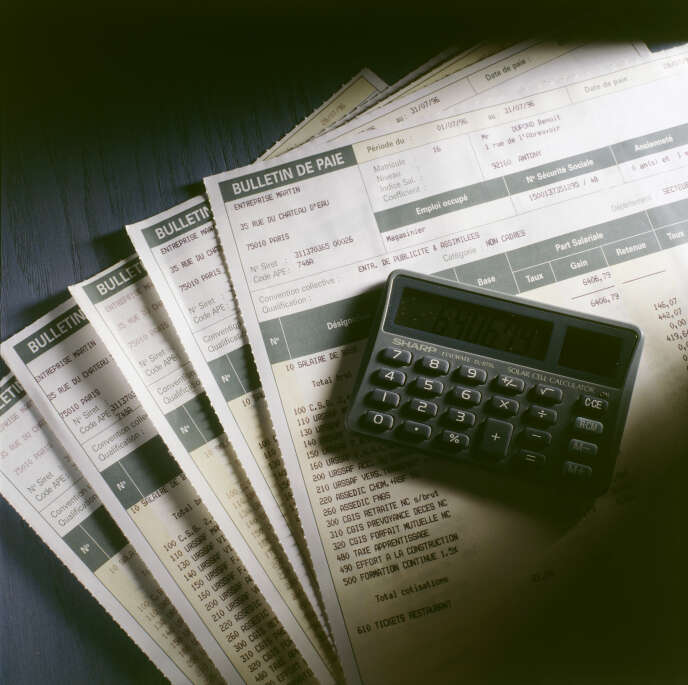
« Cocotte » est un vélo triporteur à assistance électrique et le cœur de l’activité de Vépluche : collecter les épluchures des restaurants locaux pour les transformer en compost. Un compost qui servira à faire de nouveaux légumes qui seront distribués aux restaurateurs. La boucle est bouclée.
Projet de fin d’études
L’idée de Vépluche, c’est donc de concevoir les poubelles. Ce ce n’est pas exactement ce qu’imaginait Clara en poussant la porte de Sciences Po, rue Saint-Guillaume, à Paris (7 e). L’étudiante voulait alors, simplement, « changer le monde ». Son plan : enseigner dans cette grande école, « avoir une grille de lecture de la société » pour faire une carrière dans une grande organisation où elle aurait de « grandes responsabilités ». Dans sa ligne de mire, l’Organisation des nations unies, rien de moins.
« En seulement quatre mois, nous avions établi un échéancier, un plan financier et trouvé la meilleure forme juridique. »
« “Tu voulais être diplomate”, m’a évoqué récemment ma grand-mère ! », déclare l’entrepreneuse. Mais, entre le moment où la native de Toulouse a gommé son accent du Sud-Ouest et celui où ses camarades de promotion ont passé le concours de conseiller cadre d’Orient, sa vision des choses à faire pour « changer le monde » s’est infléchie. Elle a, en amuse-bouche de sa future carrière, testé la grande entreprise lors d’un stage chez Airbus en tant que « storyteller ». « J’étais chargée d’écrire sur les succès de l’avionneur », explique-t-elle. Après quelques mois, elle éprouve le besoin de se confronter à un public et intègre l’Institut français, à Rome, où elle travaille à promouvoir la littérature française.
Simultanément, une autre voie s’esquisse. « A mon arrivée à Paris, à 18 ans, j’avais constaté qu’il n’y avait pas de tri des déchets alimentaires dans la capitale », déclare-t-elle. Une idée germe alors dans son esprit. Et, cette fois encore, l’école lui donne une clé : son projet de fin d’études de master en affaires européennes qu’elle décide d’orienter « business ». Clara et trois autres étudiantes imaginent un projet de collecte des déchets des lieux de restauration en vélo cargo. « En seulement quatre mois, nous avions été hyper loin. Nous avions établi un échéancier, un plan financier et trouvé la meilleure forme juridique », se félicite-t-elle. Romain Slitine, maître de conférences en entrepreneuriat social à Sciences Po, remarque la qualité du projet. « L’enjeu, c’est de le rendre concret et de passer à l’action », témoigne-t-il. Vépluche existe sur le papier et les tableaux Excel… Il ne reste plus qu’à le lancer. Ou pas.
« Souvent, les femmes s’autocensurent »
« La peur, c’est comme une petite sœur. Sa petite voix, on la laisse à l’arrière de la voiture », s’amuse Clara. Mais parfois, elle vous couvre : « Est-ce que je veux autant de responsabilités ? Est-ce que je veux monter une boîte ? Est-ce que je peux seulement le faire ? Est-ce que je dois mettre une jupe ou un col roulé ? Comment cela va-t-il être interprété ? Souvent les femmes se freinent, s’autocensurent. Elles se posent tellement de questions… »
« On pourrait enlever 5 000 camions de livraison de Paris. Vous imaginez l’impact ? »
Son master en poche, la jeune femme essai d’entrer à HEC. Première claque, elle n’est pas admise. « De rage, j’intègre un programme, Women4Climate, un système de mentorat qui encourage l’action des femmes qui veulent lutter contre le changement climatique, chacune à sa manière. » Un réseau de décideuses dont la voix porte bien plus fort que la petite sœur abandonnée à l’arrière de l’auto. Boostée par ces femmes qui osent, Clara lance Vépluche en 2018.
« J’avais déjà aperçu les possibilités de l’entrepreneuriat social chez Phenix », une jeune société qui s’attache à donner une seconde vie aux produits usagés et travaille à rendre la consommation plus responsable et économe en ressources. « J’y ai découvert qu’on pouvait faire du business avec un impact social ou environnemental positif. Ça m’a aidée à ôter les œillères que j’avais pour le privé. En janvier 2018, je suis repartie de zéro pour monter mon entreprise. »
Avec le soutien d’un associé et l’aide de deux collaborateurs, « Cocotte », le vélo fourgon, déambule quotidiennement dans les rues de la ville à l’assaut des poubelles des restaurateurs. Le défi : convaincre, expliquer aux gérants et patrons de cuisine l’intérêt collectif d’un circuit court et circulaire. A Boulogne-Billancourt, les restaurants L’Atelier, La Terrasse Seguin, 750 g La Table figurent parmi les trente clients pionniers. Grégory, patron du Pré en bulles, avoue « approuver une démarche qui (…) permet de [se] sentir responsables ».
L’espoir de Vépluche, c’est une prise de conscience collective que ce qui peut être consommé et transformé à l’échelle locale doit l’être. « On pourrait enlever 5 000 camions de livraison de Paris, prévoit Clara. Vous imaginez l’impact ? » Sortir le diesel, voire le moteur à explosion de la grande ville et le modifier par des transports doux. Pourquoi pas ? « Allez, Cocotte ! »