Bureau lumineux, cabine climatisée : quand l’espace de travail est modulable en fonction de l’usage des salariés
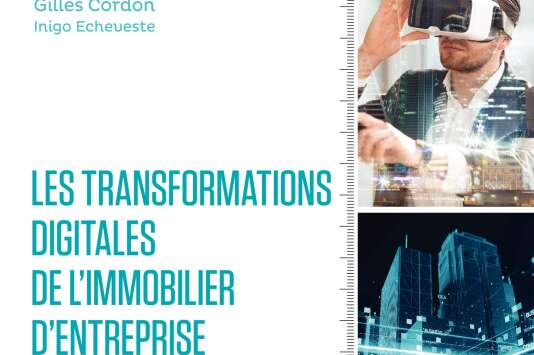
Livre. Il sait où vous habitez, connaît la voiture que vous conduisez, le nombre de sucres que vous prenez dans votre café. Il saura même, après la prochaine mise à jour logicielle, qui vous devez rencontrer. Officiellement inauguré à Amsterdam en mai 2015, The Edge est probablement l’espace de bureaux le plus intelligent jamais construit. Le bâtiment est équipé de 28 000 capteurs qui mesurent la température, la lumière, les mouvements et l’humidité. Environ 2 500 travailleurs de Deloitte s’y partagent 1 000 bureaux.
Les espaces de travail sont basés sur votre horaire et vos préférences : bureau assis, bureau debout, cabine de travail, salle de réunion ou salle de concentration. Où que vous alliez, l’application connaît vos préférences en matière de lumière et de température. Elle modifie l’environnement en conséquence.
Deloitte collecte des gigaoctets de données sur la façon dont The Edge et ses employés interagissent. Les jours où les absents sont nombreux, une section entière peut même être fermée, réduisant ainsi les coûts de chauffage, de refroidissement, d’éclairage et de nettoyage. « A l’avenir, tous les bâtiments seront connectés, tant en interne qu’à d’autres bâtiments », explique Erik Ubels. Le directeur de la technologie d’OVG, le promoteur immobilier commercial néerlandais qui a conçu The Edge, est cité dans Les Transformations digitales de l’immobilier d’entreprise, de Gilles Cordon et Inigo Echeveste.
L’apparition de l’iPhone et des premières applications en 2007 ont concrétisé l’entrée de l’« Internet of Everything » dans notre quotidien : les connexions entre les personnes, les processus, les données et les objets se sont multipliés. Cette nouvelle mobilité révolutionne la société, les habitudes de consommation, de communication et les modes de travail.
Un standard d’usage
La nouvelle génération d’actifs, qui vit dans l’immédiateté du numérique, attend de trouver sur son lieu de…








