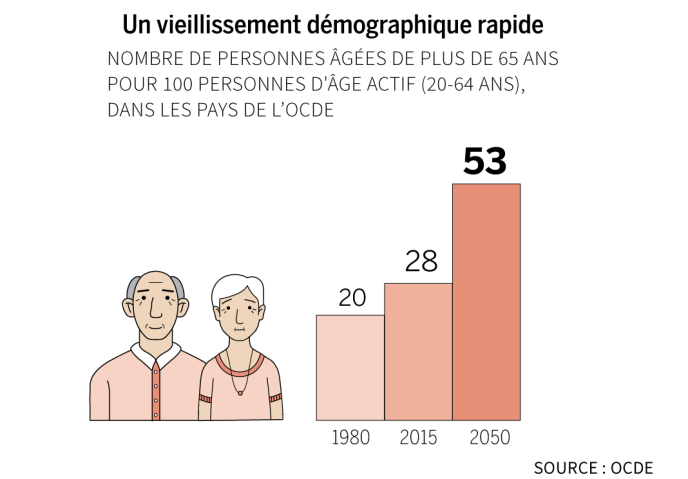Covoiturage et vélo : est-ce fiscalement captivant ?

L’embaucheur peut décider de prendre en charge les frais embauchés par ses travailleurs pour leurs voyages à vélo suivant certaines règles, et cette éventualité sera prochainement étendue au covoiturage.
Existe t-il des encouragements fiscaux au covoiturage et au déplacement à vélo ?
Oui, des privilèges fiscaux sont espérés pour le covoiturage et les déplacements à vélo. Ils peuvent faire économiser… quelques poignées d’euros.
Selon l’administration fiscale, les revenus du covoiturage fuient à l’impôt s’il s’agit d’un partage de frais, donc d’un voyage effectué pour votre compte, pour lequel vous acquittez vous aussi une part du carburant et du péage. Et le prix du voyage ne doit pas excéder la quote-part, par voyageur, du coût consécutif du barème kilométrique pour les frais réels. Sinon il s’agirait de revenus d’une entreprise, à exiger selon le régime micro ou réel.
Par ailleurs, l’employeur peut retenir de prendre en charge les frais engagés par ses salariés pour leurs excursions à vélo entre leur résidence et leur lieu de travail (dans la limite de 0,25 euro/km), et cette éventualité sera bientôt étendue au covoiturage. Pour le covoiturage, le prix par kilomètre doit être fixé par un décret.
Attention nonobstant, s’il est possible de profiter d’une exonération – cotisations sociales, contribution sociale généralisée (CSG), participation au rétribution de la dette sociale (CRDS) et impôt sur le revenu –, une limite globale de 200 euros par an et par salarié est prévue pour les compensations vélo, covoiturage et prise en charge par l’employeur des frais de carburant (ou pour l’alimentation de véhicules électriques).