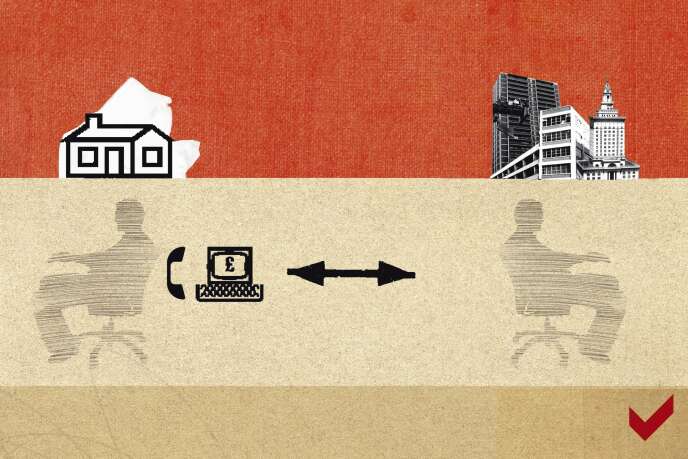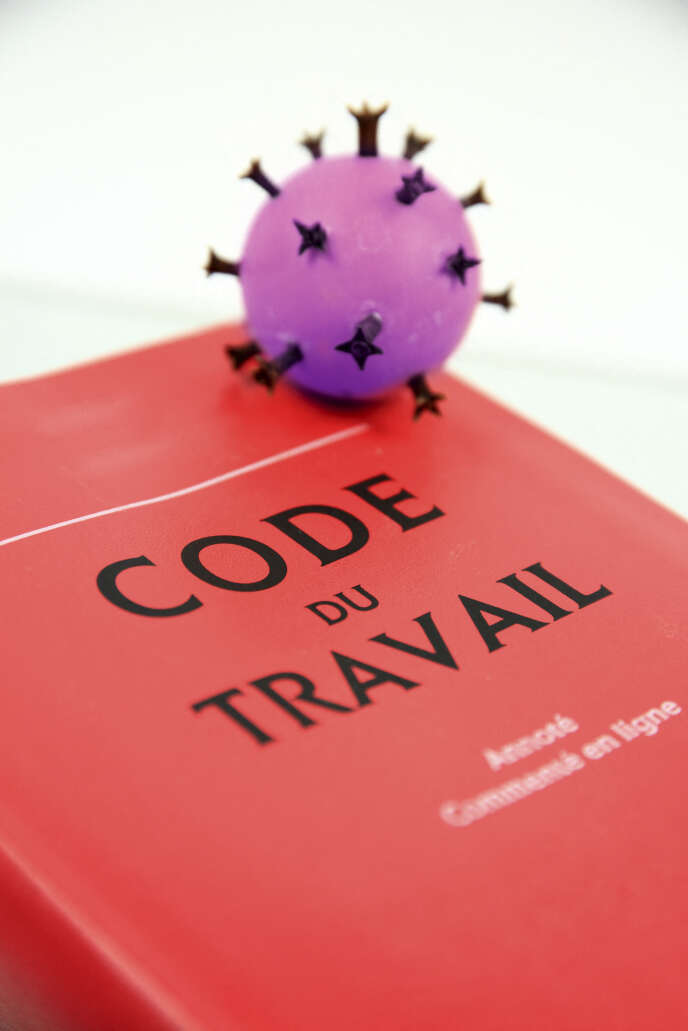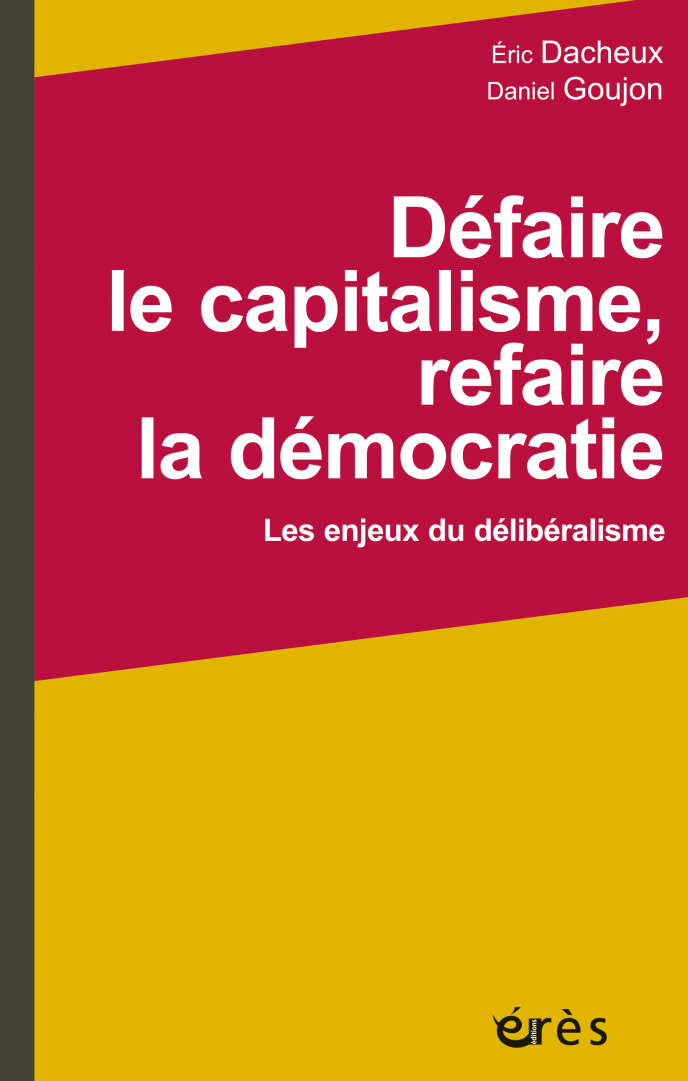Avec 11,3 millions de chômeurs partiels, l’Unédic est dans le rouge

Le montant de la facture commence à se préciser pour l’assurance-chômage. La crise liée à l’épidémie de Covid-19 a entraîné une brutale dégradation de sa trésorerie qui atteint 4,3 milliards d’euros « à ce jour ». Un montant significatif si on le rapporte aux ressources annuelles du régime (environ 39 milliards en 2019). Le chiffre figure dans des documents diffusés mardi 28 avril par l’Unédic, l’association paritaire qui pilote le système d’indemnisation des demandeurs d’emploi. Face à cette situation préoccupante, des responsables syndicaux réclament l’ouverture d’une réflexion pour colmater les brèches.
Envolée des dépenses d’un côté, affaissement des recettes de l’autre : les comptes de l’assurance-chômage sont victimes d’un redoutable effet de ciseau. S’agissant du premier volet – les dépenses, donc –, la principale raison résulte du recours massif à « l’activité partielle » – terme officiel pour désigner le chômage partiel. Ce dispositif, qui concerne 11,3 millions de personnes selon les indications fournies, mercredi, par la ministre du travail, Muriel Pénicaud, est financé, à hauteur d’un tiers, par l’Unédic. Sur mars, avril et mai, le coût pour le régime pourrait atteindre près de 7,8 milliards d’euros. Ces « estimations » sont susceptibles d’être revues à la hausse : elles n’incluent pas le transfert vers l’activité partielle (à partir du 1er mai) des individus qui étaient en arrêt de travail pour pouvoir garder des enfants ou parce qu’ils sont jugés vulnérables.
D’autres facteurs alourdissent le fardeau : accroissement du chômage, donc du volume des allocations versées ; allongement de l’indemnisation pour les demandeurs d’emploi arrivés en fin de droit à compter du 1er mars – une mesure récemment prise par l’exécutif ; diminution du nombre de personnes qui, ayant retrouvé un poste, quittent le dispositif et ne touchent plus de prestation, etc. Soit, au total, près de 3 milliards d’euros supplémentaires, pour la période allant de mars à mai.
« Décalage de trésorerie »
Quant aux recettes, elles « diminuent dans des proportions jamais observées », d’après une des notes publiées mardi. Le très net ralentissement de l’activité économique, conjugué à l’envolée des arrêts de travail et à la généralisation du chômage partiel, se traduit, in fine, par un affaissement des cotisations attribuées au régime. Une perte évaluée à un peu plus de 2,6 milliards d’euros, entre mars et mai.
Il vous reste 48.14% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.