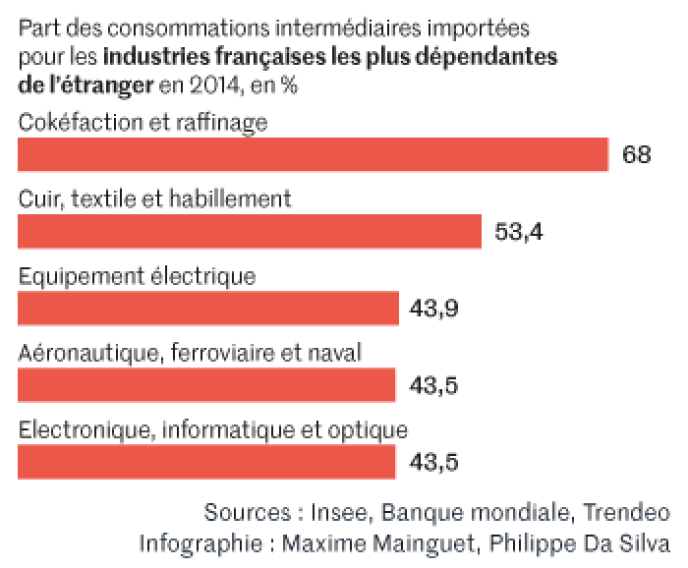Reconfinement : cent nuances de télétravail

« Depuis vendredi, au travail c’est comme d’habitude. Il n’y aurait pas eu d’allocution du président de la République que ça aurait été pareil », constate Tom (tous les prénoms ont été changés), technicien, dans son usine en banlieue parisienne. « J’arrive à la même heure, je croise les mêmes collègues. Absolument rien n’a changé », s’étonne également Angèle, assistante sociale dans une collectivité territoriale en région Centre-Val-de-Loire. « Mon responsable m’a dit “on reste comme ça”. Donc je suis à 100 % à mon poste », témoigne encore Laurent. Pour cet ingénieur dans un bureau d’études en Normandie comme pour nombre de Français, depuis le reconfinement, la vie au travail « continue comme si de rien n’était ».
Aucun taux de télétravailleurs n’est encore disponible – contrairement à ce qu’affirmait, mardi 3 novembre sur RTL, le ministre de la santé, Olivier Véran, qui déclarait que « les chiffres du télétravail attestent que les entreprises jouent le jeu et les salariés également ». Mais la RATP nous donne un indice : à l’heure de pointe du matin, lundi 2 novembre, les métros parisiens n’étaient qu’à moitié pleins. Une baisse toute relative, car depuis la rentrée de septembre, ces rames ne se remplissaient déjà plus qu’à 70 % aux heures de pointe. Le reconfinement ne marque donc qu’une baisse de 20 % par rapport à ce niveau. Sans commune mesure avec le printemps où les rames du matin n’étaient remplies qu’à 5 %.
Si le président de la République, dans son discours du mercredi 28 octobre, demandait à chacun de participer à l’effort – « L’économie ne doit ni s’arrêter ni s’effondrer ! » – loin du « restez chez vous » du printemps, la règle édictée par la ministre du travail, Elisabeth Borne, dès le lendemain semblait pourtant claire : le télétravail « n’est pas une option » mais « une obligation » pour les travailleurs, salariés ou indépendants qui peuvent exercer leur activité à distance.
Le nouveau protocole national en entreprise actualisé le 29 octobre ne reprend pas ce terme d’obligation. Il stipule néanmoins que le télétravail « doit être la règle », précisant que « le temps de travail effectué en télétravail est porté à 100 % pour les salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs tâches à distance ». Pour les autres, les entreprises doivent prévoir des aménagements dans l’organisation, pour réduire au maximum les déplacements domicile-travail et le temps de présence en entreprise.
Il vous reste 63.21% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.