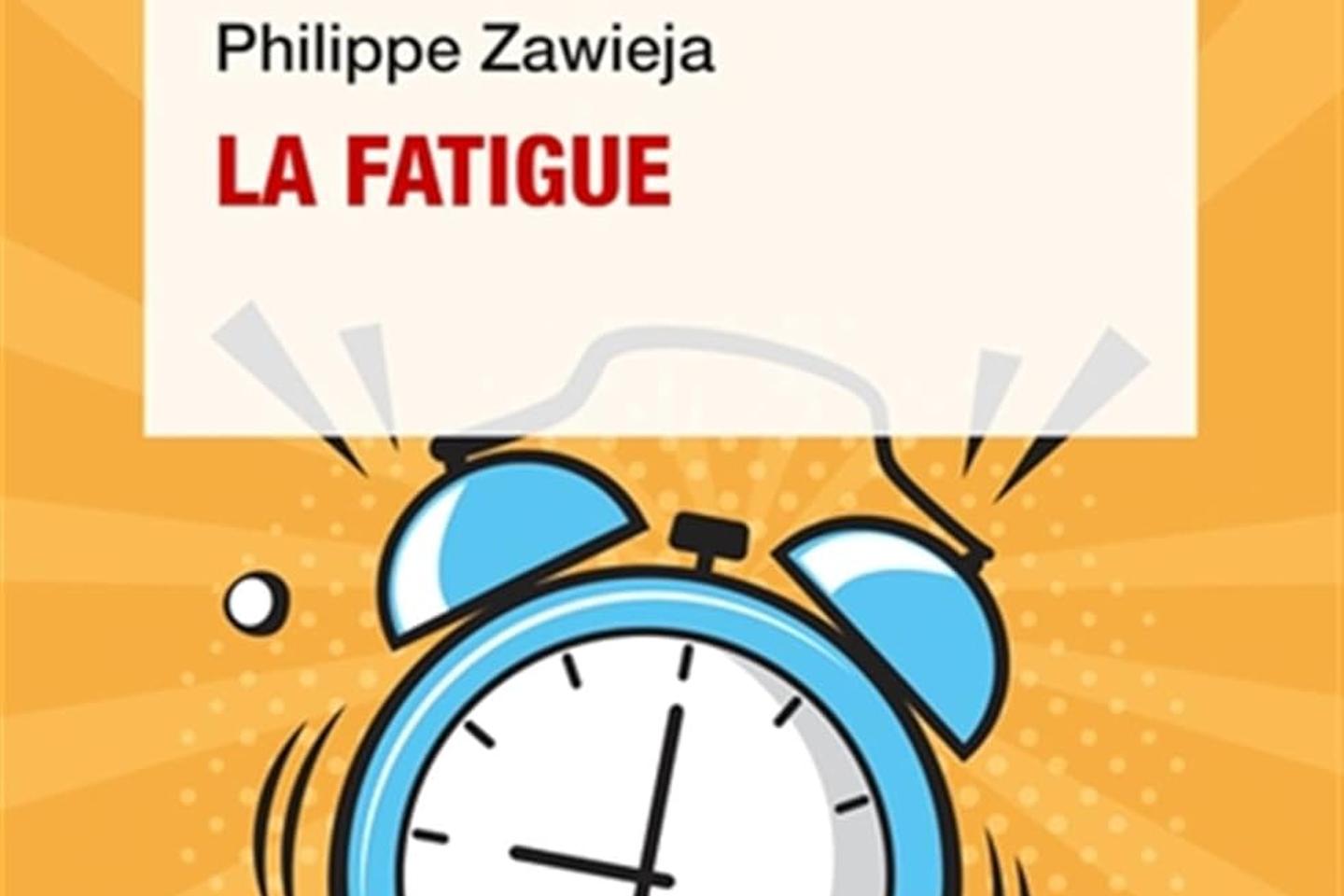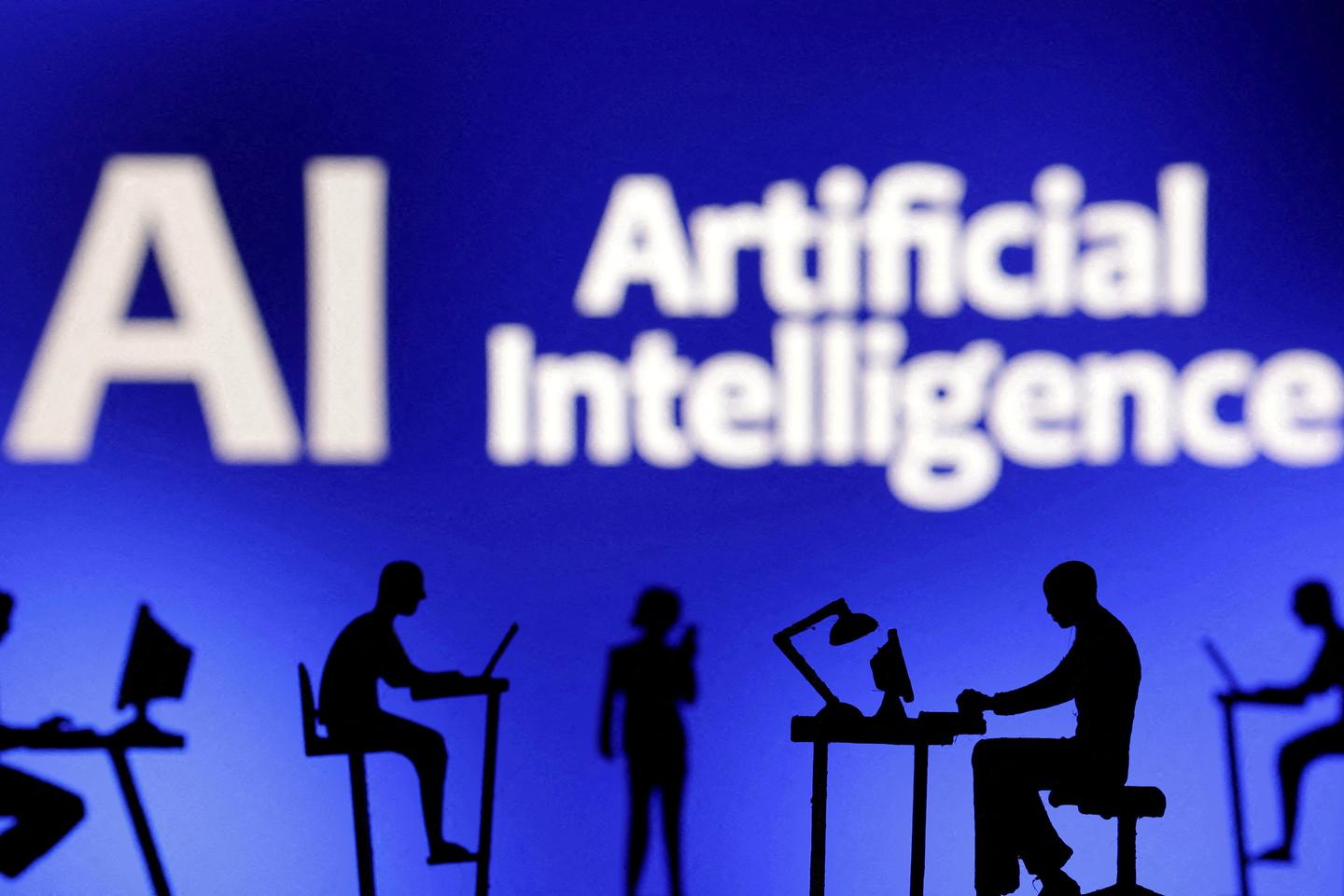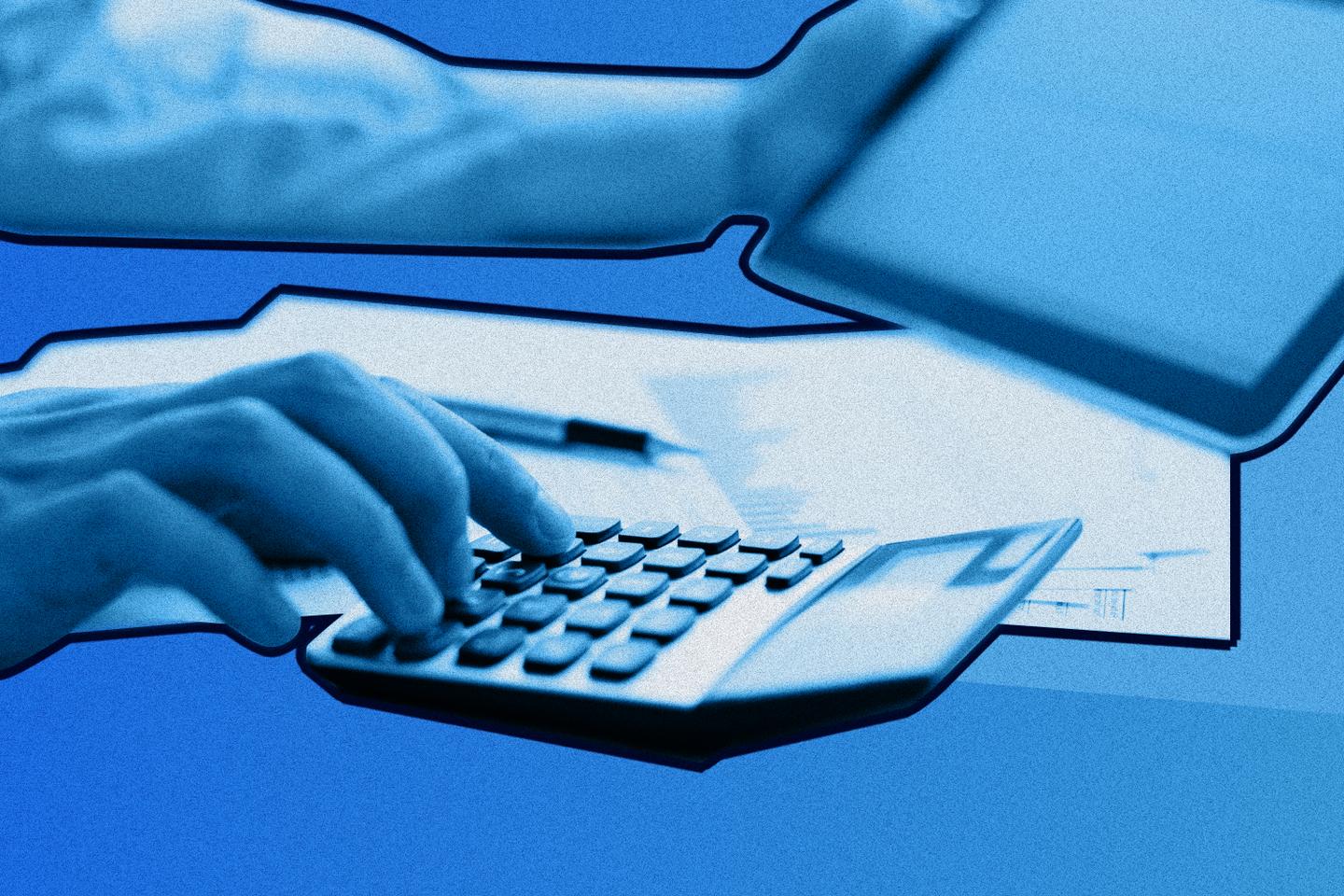« Faut-il être pour ou contre le télétravail ? »

Depuis quelques mois, certaines grandes entreprises, en France comme à l’étranger, réduisent le nombre de journées de télétravail. A la Société générale, la direction a annoncé le passage à un jour de télétravail par semaine, contre deux ou trois auparavant. Elle a expliqué cette décision par la nécessité « d’interagir, d’échanger, y compris de façon informelle, pour renforcer chaque jour notre culture et notre unité autour d’ambitions stratégiques partagées et de défis opérationnels surmontés ensemble ».
Chez JCDecaux, une nouvelle règle impose quatre jours de présence au bureau, contre trois auparavant. Comme l’a déclaré le directeur des ressources humaines France : « Compte tenu de notre forte culture d’entreprise reposant sur la proximité, l’innovation et la performance, nous avons constaté que les interactions entre équipes, manageurs et collaborateurs étaient plus efficaces en présentiel. »
Chez Iliad, maison mère de Free, le nombre maximal de jours de télétravail chaque mois est passé de huit à six. A cela s’ajoutent des restrictions telles que pas plus de deux vendredis en télétravail par mois et l’interdiction de télétravailler deux jours consécutifs.
A chaque fois, le même scénario se répète. D’un côté, les dirigeants estiment que le télétravail nuit à la dynamique d’équipe et à la productivité. De l’autre, une majorité de salariés défend le télétravail, qui offre plus de flexibilité et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Faut-il être pour ou contre le télétravail ?
De nombreux travaux de recherche ont été publiés sur ce sujet. En particulier, une méta-analyse récente (« A dual pathway model of remote work intensity : A meta‐analysis of its simultaneous positive and negative effects », par Ravi S. Gajendran, Ajay R. Ponnapalli, Chen Wang et Anoop A. Javalagi, Personnel Psychology, 2024, 77 (4), 1351-1386) a synthétisé les résultats de 162 études, portant sur plus de 78 000 salariés. Alors qu’il est difficile de tirer des conclusions d’une étude isolée, une méta-analyse offre des résultats bien plus fiables. Elle permet d’apporter des éclairages utiles sur l’impact du télétravail, tant pour les salariés que pour les employeurs.
Il vous reste 54.3% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.