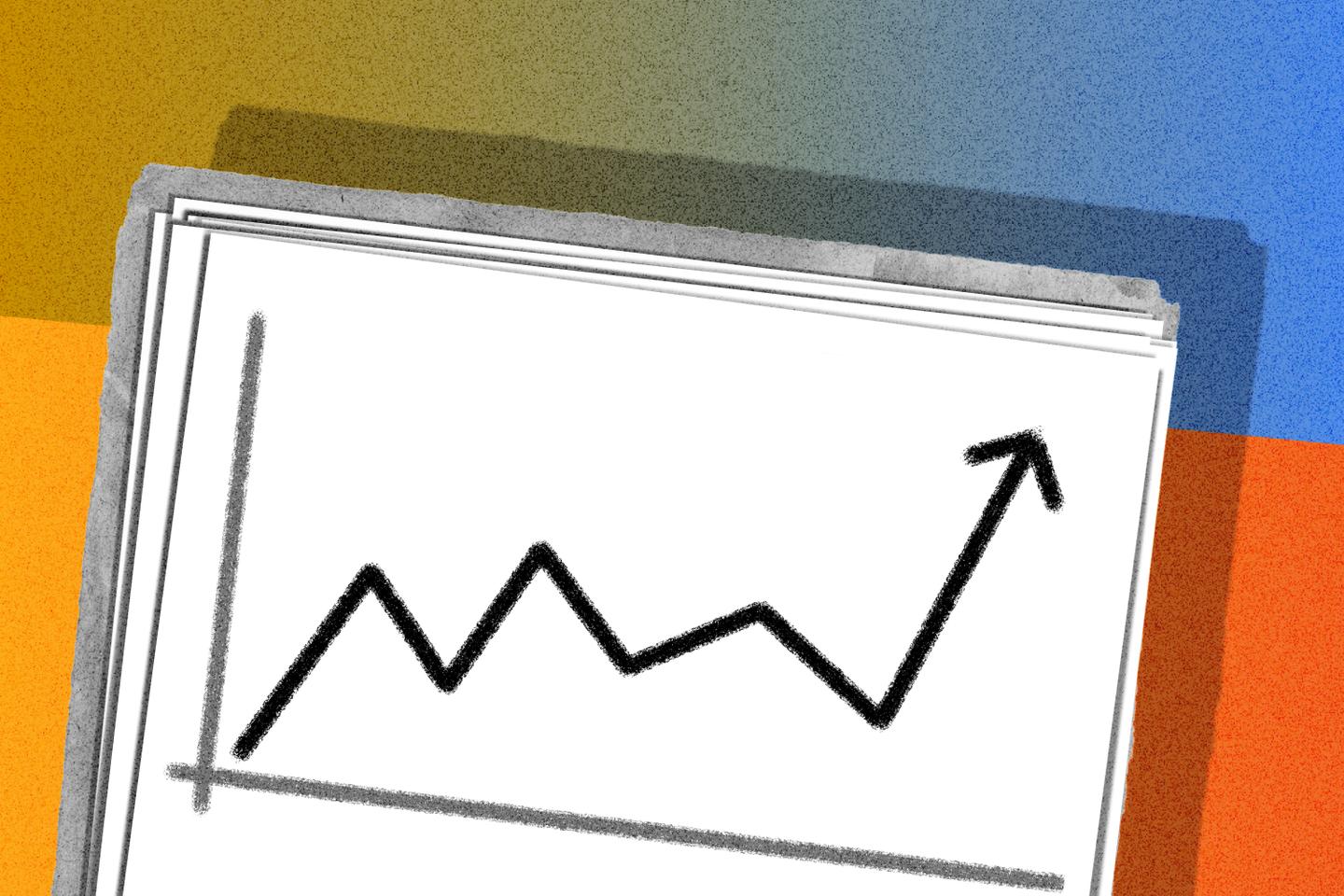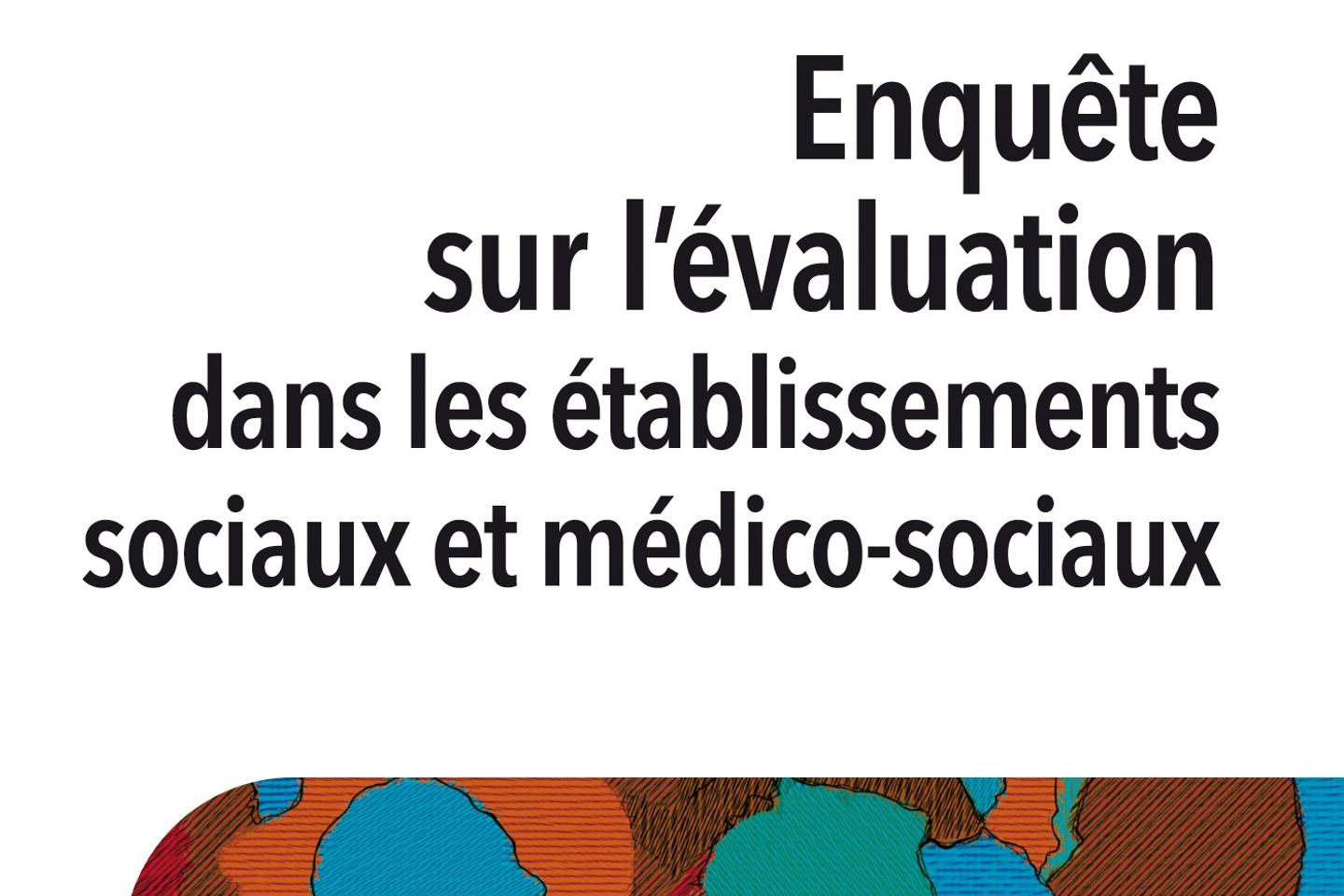Emploi des seniors : la priorité des DRH reste le départ progressif
Selon l’Insee, 45 % des actifs ni en emploi ni en retraite âgés de 55 à 61 ans l’étaient pour raison de santé ou de handicap en 2021. Quelles politiques d’accompagnement les entreprises mettent-elles en place pour maintenir les seniors dans l’emploi ? C’était le sujet des rencontres RH, le rendez-vous mensuel de l’actualité du management, organisé par Le Monde en partenariat avec l’Association pour l’emploi des cadres (APEC), qui a réuni des professionnels des ressources humaines mardi 13 mai à Paris.

En introduction des échanges, Catherine Delgoulet, titulaire de la chaire Ergonomie au Conservatoire national des arts et métiers, a rappelé le retard de la France sur le taux d’emploi des seniors, par rapport à ses voisins européens : « Il y a un effet de bascule à 59-60 ans, où on a une chute brutale de l’activité des seniors, et le taux de personnes entre 62 et 64 ans qui ne sont ni en emploi ni en retraite ne cesse d’augmenter. »
« Ce ne sont absolument pas des questions nouvelles, et elles perdurent car on n’a pas trouvé comment les résoudre. Elles sont marquées par quatre grandes influences, constate la chercheuse : les tendances de fond démographiques (un tiers de la population active a plus de 50 ans en 2023), les dispositifs institutionnels qui vont permettre des départs précoces ou inciter au maintien en emploi, les actions des employeurs – accès à la formation tout au long de la vie, amélioration des conditions de travail, aménagement des fins de carrière –, et enfin les aspirations des salariés eux-mêmes. »
Il vous reste 71.65% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.