Arjowiggins Papiers Couchés classé en liquidation judiciaire, des centaines salariées inquiétés dans la Sarthe



La Fnac et Nature & Découvertes négocient un partenariat avec une prise de participation.
C’est la récente marotte de la grande attribution, qui tente par tous les moyens à faire regagner les clients dans ses magasins. Après avoir fait pénétrer la restauration dans les commerces, place au « shop in shop », des espaces parfois importants de marques situés à l’intérieur d’un autre magasin. « C’est le commerce de demain », garantit, convaincu, Antoine Lemarchand, le patron de Nature & Découvertes. Face à la rivalité des GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) et à des clients habitués à repérer en magasin les produits qui les charment avant de les acheter moins cher sur une plate-forme du Web, la seule solution est de « produire des articles exclusifs, et d’adopter une enseigne pour faire du “shop in shop” ».
La Fnac, les Galeries Lafayette, Cdiscount ou Amazon, tous l’ont approché. Son privilège est allé à la Fnac, dont il pourrait aussi assimiler le site de vente en ligne. « Nous sommes en train de négocier un partenariat commercial adossé à une entrée au capital. Mais rien de plus. Et rien n’est visé à ce jour », confie-il. Une façon de répondre à un article du Figaro qui prêtait à la Fnac la volonté de s’offrir cette enseigne créée, en 1990, par son père, François Lemarchand, le créateur de Pier Import, et qui appartient encore à plus de 80 % du capital à la famille.
Ce modèle du « shop in shop » se joint, dans le monde physique, aux places de marché sur Internet avec des vendeurs externes rassemblés sous un même site. Les hypermarchés espèrent captiver de nouveaux clients et ainsi compenser les pertes accusées sur les rayons non alimentaires. « Ils enregistrent souvent des pertes représentant 5 à 10 % de leur chiffre d’affaires sur les rayons techniques du fait des conditions d’achat, d’une logistique embarrassée et d’un service après-vente qui coûte très cher, rappelle Bernard Demeure, directeur associé et consultant au sein du cabinet de conseil Oliver Wyman. Historiquement, ce n’était pas grave car les acheteurs remplissaient leur chariot. Actuellement, ce n’est plus vrai. »
Une manœuvre semblable a été mise en place par la Fnac et Darty
Casino a déjà traversé le pas depuis juin 2017. Son site d’e-commerce Cdiscount dispose actuellement d’un secteur de choix dans 57 hypermarchés du groupe. L’idée : l’acheteur accède à toute l’offre disponible sur Internet au prix du Web, se fait guider sur place et se fait livrer à domicile ou en magasin. Les premiers résultats seraient à ce point concluants, au niveau du chiffre d’affaires des hypermarchés qui ont mis en place cette stratégie, que cette méthode sera étendu à 70 % des magasins du groupe.

Alors que certains bouleversements industriels défraient maintenant la chronique, dont ceux d’Arc International et d’Arjowiggins, 50 000 postes n’ont pas pu être pourvus dans le secteur en 2018, examine Philippe Escande.
Chronique « Pertes & profits ». On ne saura pas dire que Xavier Bertrand ne met pas les petits plats dans les grands pour son industrie régionale, en l’occurrence celle qui, nettement, fabrique assiettes et verres à pied. Jeudi 28 mars, le conseil régional des Hauts-de-France, qu’il galère, a voté à l’accord un prêt de 12 millions d’euros pour soutenir le plan de relance de la société Arc International, géant mondial des arts de la table. La motivation est forte, puisque l’entreprise emploie 5 100 employés et se trouve en énorme difficulté. Il s’agit donc d’éviter la casse, même si le plan en question prédit tout de même 700 suppressions de postes.
Autre part en France, c’est le papetier Arjowiggins qui fait parler de lui. Le tribunal de commerce de Nanterre (Hauts-de-Seine) devait s’exprimer, vendredi, sur la liquidation de l’entreprise. Autour du principal site, dans la Sarthe, on rappelle une catastrophe économique qui pourrait palper plus d’un millier d’emplois dans la région.
Chronique habituelle d’un drame français, celui de la désindustrialisation, en trente ans, d’un pays autrefois couvert d’usines. On en connaît le principal responsable : avec la concurrence mondiale, le coût du travail dans l’industrie française est trop élevé par rapport au niveau de gamme des produits vendus. On ne peut attendre enrichir en vendant des produits de qualité espagnole à des prix allemands. Etat et entreprises partagent la responsabilité de cette catastrophe.
Changement du système de formation
Mais l’autre drame qui se joue actuellement n’est pas celle-là. En dépit de l’effet de loupe des problèmes locaux comme Arc International et Arjowiggins, l’industrie française progresse sa qualité et ne perd plus d’emplois. En 2018, elle en a même créé 250 000 de plus. Le seul problème est qu’elle aurait pu aisément en fournir 50 000 de plus.
Malgré cela, les entreprises n’ont pas aperçu de candidats ! Situation ubuesque d’un pays plombé par un chômage de masse – 8,8 % de solliciteurs d’emploi (juste dépassé par la Grèce, l’Italie et l’Espagne) – et qui n’arrive pas à le résorber quand la demande revient. Ce qui simule toute l’économie, puisque ces emplois qui faillissent sont de la croissance en moins.
Ce ne sont pas les baisses de charges qui vont garantir ces postes vacants, mais la refonte du système de conception (il n’y a que 5 % de chômage chez les diplômés du supérieur), une forme de réenchantement de la filière (les sciences attirent deux fois moins d’étudiants en France qu’en Allemagne) et l’augmentation de la mobilité des solliciteurs d’emploi. Un chantier privilégié.

Le groupe français de BTP a préparé, dans l’émirat, une visite pour la presse, alors que l’association Sherpa a reproduit sa plainte pour travail forcé et diminution en esclavage des ouvriers étrangers.
Au nord de du capital du Qatar, entre les trempas de l’île artificielle The Pearl et les tours en construction de la ville nouvelle de Lusail, des centaines d’ouvriers s’activent pour achever la gare souterraine, qui doit ajuster, à 35 mètres de profondeur, les réseaux de métro et de tramway. C’est l’un des infinis chantiers qui métamorphosent la capitale Doha pour la Coupe du monde de football, en 2022. Sur des kilomètres, des gratte-ciel à l’architecture incertaine s’élèvent entre les voies rapides et les centres commerciaux, sous les efforts de bataillons d’ouvriers indiens, népalais ou bangladais nommés dans une chaleur de four et la poussière du désert.
Casque, chaussures de sécurité, gilet, gants, rien ne manque à la panoplie des 600 travailleurs étalés sur la station de Pearl. Quelques hommes fument à l’ombre d’un abri en tôle. Des dizaines d’autres saisissent leurs déjeuners, attablés à l’intérieur d’une large tente doucement climatisée. Sur des panneaux s’affichent les consignes à respecter en cas de pic de chaleur – combinée à l’humidité, la température ressentie peut dépasser les 50 °C l’été. « On n’a eu aucun mort sur ce chantier et on affiche un taux d’accidents moitié moindre que ce qu’on peut observer en Europe », déclare Nicolas Dansette, directeur du projet de tramway de Lusail pour l’entreprise Qatari Diar Vinci Construction (QDVC).
Disposée à 51 % par le fonds souverain Qatari Diar et à 49 % par Vinci, QDVC a entassé pour 5 milliards d’euros d’accords au Qatar depuis 2007, dont 35 km de métro et les 28 km du tramway de Lusail. Mais si le numéro un mondial du BTP a déterminé, les lundi 25 et mardi 26 mars, de guider quelques journalistes sur ses chantiers qataris longtemps défendus d’accès, ce n’est pas pour vanter ses prouesses techniques. C’est pour tenter d’y présenter les conditions de travail de ses ouvriers sous un jour favorable, alors que le groupe est gravement mis en cause au Qatar. L’association française Sherpa, pourfendeuse des « crimes économiques », le reproche, depuis 2015, de travail forcé, de réduction en servitude, de traite des êtres humains et de mise en danger délibérée.
Plusieurs enquêtes de journaux, d’ONG ou de syndicats l’attestent : parmi les laborieux migrants mobilisés par centaines de milliers dans le sous-continent indien pour donner corps aux rêves de modernité du Qatar, beaucoup nécessitent payer l’équivalent d’un an de salaire à des intermédiaires, se voient confisquer leur passeport et sont totalement enchaînés à des employeurs qui les font travailler jusqu’à onze heures par jour, six jours par semaine, sans appui contre la chaleur, sans eau, et les recueillent dans des conditions indignes, accumulés dans des camps au milieu du désert.

Plus qu’un manuel de motivation, « Laugh to lead », de Serge Grudzinski, est une apologie du rire dans l’entreprise.
Article réservé aux abonnés
Livre. Le rire peut-il aider à manager, peut-il faciliter la mise en place d’un projet ou renouer des équipes après une fusion d’entreprises ? Serge Grudzinski, un polytechnicien qui a fait du rire son hobby des années durant avant de se décider à monter sur les planches, l’affirme et l’illustre dans l’essai Laugh to lead. Quand le rire débloque, soigne, rassemble et motive les entreprises (HCG).
Initialement consultant en stratégie d’entreprise, il a fait du rire une nouvelle technique de management et raconte les one-man-show qu’il a montés pour restituer les audits des entreprises. Le vaste champ observé est dicté par le carnet de commandes de la société qu’il a créée pour son projet, Humour Gonsulting Group : assurance, restauration, distribution, énergie, etc.
Serge Grudzinski relate son expérience le plus sérieusement du monde, avec tableaux comparatifs des attitudes des salariés avant et après spectacle. Sans forcément partager son humour, force est de constater que ses interventions ont permis à AXA, Mac Donald’s, Orange ou Capgemini, par exemple, de mesurer la force du rire pour sortir les salariés de leur organisation en silo, pour briser les tabous ou déclencher une prise de conscience sur les inégalités femmes-hommes.
La mécanique du rire provoque des réactions psychologiques et soulève un enthousiasme partagé, explique l’auteur. « Je leur présente le miroir des tensions qui les animent et de leurs souffrances et ils rient ! (…) C’est le mécanisme de la purge psychologique », écrit-il. « C’est merveilleux de tant rire de ce qui nous fait tant souffrir ! Quand on a ri, c’est derrière nous », se confie un spectateur. La mise en humour des problèmes quotidiens de la vie au travail réhabilite l’empathie, la bienveillance et la transparence que les salariés avaient souvent perdues de vue.
« Le non-dit est un phénomène qui se développe de façon quasi systématique dès que des êtres humains vivent ensemble », rappelle l’auteur. En entreprise, il crée des tensions, des intrigues, toutes sortes de malaises et de démotivation, dont le rire vient à bout. Métiers, questions stratégiques, relation client, problèmes opérationnels, il est possible de « faire rire sur tout », estime Serge Grudzinski. Plus qu’un manuel de motivation, Laugh to lead est une apologie du rire dans l’entreprise.
« Laugh to lead. Quand le rire débloque, soigne, rassemble et motive les entreprises », de Serge Grudzinski. Editions HCG, 184 pages, 19,50 euros.

C’est l’ultime victime en date de la « bataille de l’Atlantique » que s’offrent les compagnies aériennes low cost. La compagnie WOW Air a cessé, jeudi 28 mars, ses opérations et annulé tous ses vols. Le gouvernement islandais estime à 4 000 le nombre de voyageurs réunis – dont 1 300 en transit.
WOW Air, qui amène plus d’un tiers des voyageurs en Islande, n’avait plus aucun investisseur pour prévoir une punition depuis que sa compatriote Icelandair s’était retirée des négociations en vue d’une reprise. « WOW Air a cessé ses opérations », a avisé lapidairement le transporteur dans un communiqué.
Plan d’urgence lancé
La compétition continuellement forte des low cost sur les routes transatlantiques et le regain des cours du carburant ont miné les performances de WOW Air. La compagnie a convoqué les passagers lésés par la suppression des liaisons aériennes à « vérifier les vols disponibles avec d’autres compagnies aériennes ».
Des dizaines de passagers se sont brusquement retrouvés bloqués jeudi matin à l’aéroport de Reykjavik, où une trentaine de vols WOW Air ont été annulés, particulièrement en provenance ou à destination de Paris, New York et Montréal. Le ministre des transports islandais a annoncé à la presse le déclenchement d’un plan d’urgence à destination des voyageurs bloqués dans les aéroports, sans accorder davantage de détails.
3,5 millions de passagers en 2018
En 2018, WOW Air, qui emploie un millier de personnes, a transporté 3,5 millions de passagers vers vingt-sept destinations en Amérique du Nord, en Europe et en Israël. Mais le transporteur, déficitaire, a diminué la voilure ces derniers mois, en cédant des avions et en annulant des dizaines d’emplois. Sur les neuf premiers mois de 2018, la compagnie a proclamé une perte avant impôts de près de 42 millions de dollars (37 millions d’euros).
Après le premier repli d’Icelandair dans la course au rachat de la compagnie fin 2018, le fonds d’investissement spécialisé dans le transport aérien Indigo Partners avait touché un accord de principe pour entrer au capital de WOW Air à hauteur de 49 %. Le 21 mars, la société américaine d’investissement a toutefois abandonné à son offre de reprise tandis qu’Icelandair annonçait reprendre les contestations pour le rachat de sa compatriote… avant son retrait définitif annoncé dimanche.
La compagnie low cost avait depuis déclenché des discussions avec ses créanciers afin de trouver un accord de restructuration – dont la conversion de la dette actuelle en capital. Lundi, ses créanciers avaient concédé la conversion de leurs obligations en capital à hauteur de 49 % de la dette de la compagnie, mais celle-ci devait malgré cela encore trouver des acquéreurs pour les 51 % restants, afin d’esquiver la faillite.
« Je ne me pardonnerai jamais de ne pas avoir agi plus tôt car il est évident que WOW est une compagnie aérienne incroyable et que nous étions sur la bonne voie pour faire à nouveau de grandes choses », a regretté le directeur général et fondateur de la compagnie, Skuli Mogensen, dans une message adressée au personnel.
La ruine du transporteur, fondé en 2011, pourrait déchaîner une contraction du PIB islandais de 3 %, la chute de la couronne et un accroissement de l’inflation, selon les lancements du gouvernement. Mais certains analystes considèrent ces calculs alarmistes.

Pour la ministre du travail, 20 % des chômeurs ont une contribution supérieure à leur salaire. L’Unédic avance un chiffre plus faible.
Le débat sur la modification de l’assurance-chômage vient de connaître un effet très intrigant. A l’origine de ce nouvel épisode, une note de quatre pages rendue publique, mercredi 27 mars, par l’Unédic, l’association égalitaire qui pilote le dispositif de compensation des solliciteurs d’emploi. Ce document remet en cause l’un des arguments-clés de l’exécutif pour transformer le régime : il s’agit de l’idée selon laquelle 20 % des chômeurs profiteraient d’une allocation supérieure à leur salaire mensuel moyen, perçu avant de s’inscrire à Pôle emploi.
Ce chiffre avait été déclenché, fin février, par la ministre du travail, Muriel Pénicaud, lors d’une déclaration de presse à laquelle collaborait le chef du gouvernement, Edouard Philippe. Tout deux avaient estimé que le « système » repose sur des règles susceptibles d’engendrer des situations où le travail s’avère moins rémunérateur que l’indemnisation-chômage. Un discours qui avait plongé dans une colère noire plusieurs leaders syndicaux : Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, avait crié à la caricature et attrapé au pouvoir en place de vouloir faire passer les solliciteurs d’emploi pour des profiteurs.
Ecarts significatifs
Dans ce contexte très polémique, la note de l’Unédic, diffusée mercredi, fournit une participation très utile. Elle se penche sur le sort des bénéficiaires, « avant et après le début » de leur prise en charge par l’assurance-chômage, en exploitant des données relatives à novembre et décembre 2017. D’après ce document, ce sont surtout les personnes ayant travaillé « moins de 25 % de l’année précédant leur ouverture de droit » qui ont affecté une prestation supérieure à leur salaire antérieur. Or, elles sont peu nombreuses : 4 %, au total, soit un pourcentage très éloigné de celui invoqué par Mme Pénicaud. Précision importante : le cas de figure d’un demandeur d’emploi gagnant mieux sa vie au chômage peut se retrouver dans les catégories qui ont travaillé plus que 25 % des douze mois écoulés, mais « c’est rare », montre l’Unédic.
Ces conséquences ne vont pas certainement dans le sens des statistiques mises en avant, il y a un mois, par l’exécutif. Le ministère du travail avait alors exposé qu’il appuyait ses dires sur des recherches réalisées par Pôle emploi. L’opérateur public a, par la suite, apporté des explications orales à plusieurs journalistes, désireux d’en savoir plus, ainsi qu’à des responsables syndicaux. Mais à ce jour, aucun écrit n’a été diffusé – à la presse, tout au moins – pour exprimer l’analyse de Pôle emploi.

Le vote au Parlement de Strasbourg sur des écrits pointant à installer de nouvelles règles pour le secteur a été référé.
Le perfectionnement des conditions de travail des chauffeurs routiers sur le Vieux Continent devra encore prévoir plusieurs mois. Mercredi 27 mars, le président du Parlement européen, Antonio Tajani, a résolu de stimuler un vote capital à Strasbourg sur des textes visant à lutter contre le dumping social dans ce secteur, où les abus sont légion (temps de repos minimal, non-application des règles du détachement des travailleurs, etc.).
Près de 1 600 rectificatifs au texte avaient été établis, dont certains, à la veille du vote, n’avaient pas encore pu être traduits, alors que les textes concernés sont pourtant en discussion depuis dix-huit mois. De l’obstruction ? « Oui », assure une source au sein des Verts. Toutefois, les étiquettes politiques touchant ce dossier importent peu. La fracture est profonde, et surtout géographique. Les élus de la péninsule Ibérique et des pays de l’Est s’opposent à ceux de l’Ouest (France, Allemagne, Benelux) et rechignent face à des lois plus protectrices, jugées protectionnistes et dommageables pour la compétitivité de leurs entrepreneurs.
Au Conseil européen, en décembre 2018, les capitales étaient malgré cela arrivées à un compromis estimable, et plutôt favorable à l’Ouest, avec la censure, pour les conducteurs, de prendre le temps de repos en cabine pour leurs périodes de pause hebdomadaires, ou l’application des conditions du cession – à savoir même paie pour un même travail sur un même lieu de travail – pour toutes les opérations de cabotage (la livraison d’un point à un autre au sein du même pays pour une compagnie étrangère).
Ces comptes ne pourront toutefois entrer en vigueur qu’à condition que le Parlement choisis sa position, les deux établissements devant s’entendre sur une version définitive. Un nouveau vote côté constitutionnel n’interviendra pas avant le 4 avril. Ce sera tard pour une adoption définitive avant les élections européennes de fin mai.
Il faudra ultérieurement attendre la constitution du nouvel Hémicycle, la nomination de nouveaux rapporteurs pour les textes… Le travail législatif ne reprendra pas, au mieux, avant fin 2019. Pourtant, la situation sur le terrain reste continuellement aussi insatisfaisante, comme l’atteste un scandale jugé en Belgique, là où, exactement, des milliers de manifestants ont défilé, mercredi, contre le dumping social dans le transport.
Indices de blanchiment
A la suite d’un examen du parquet fédéral belge sur les fraudes auxquelles se livrait l’une des principales sociétés du secteur, le groupe Jost, la chambre des mises en examen du tribunal de Liège a autorisé, mardi, la saisie de 346 camions lui appartenant.

Le baromètre Malakoff Médéric Humanis à sembler le 29 mars rappelle l’attachement des Français à leur système de protection sociale. Plus d’un sur deux se dit inquiet par les suites de la réforme annoncée pour 2019.
Les Français occupant à l’étranger s’inquiètent pour leur retraite. Alors qu’à Paris la réforme se prépare dans le plus grand flou, le mutualiste Malakoff Médéric Humanis révèle que 53 % des expatriés sont inquiets par ce que va être la retraite après le changement.
Plus de 1 200 personnes ont été consultées du 3 au 27 octobre 2018 pour accomplir la 7e édition du baromètre de la protection sociale des émigrés français, qui sera publié vendredi 29 mars. A 52,4 ans d’âge moyen, l’horizon de leur départ à la retraite n’est plus si lointain.
Les deux tiers d’entre eux vivent en couple ; 80 % sont implantés à l’étranger depuis au moins six ans, dont près d’un sur deux en Union européenne. « Tous ceux qui résident dans un pays de l’Union européenne domineront faire valoir leurs temps de travail pour approuver les trimestres de cotisation lors de la liquidation de la retraite, en revanche, les revenus perçus ne seront pas pris en compte en France. Ils le seront dans le pays de résidence, qui leur versera une partie de leur pension. Mais les niveaux de pension sont très hétérogènes d’un pays à l’autre de l’Union », développe Sylvaine Emery, directrice des activités internationales du groupe.
Les expatriés s’alarment donc légitimement de la part française de leur retraite. Et plus leur lien est fort avec la France, plus leur inquiétude est grande. Ainsi, les plus inquiets des conséquences de la réforme à venir sont les salariés en contrat local avec une filiale française (69 %), suivis par les fonctionnaires (66 %), qui craignent un alignement du système public sur le système privé, et enfin par les ouvriers et les employés (62 %), qui craignent de se retrouver sans rien.
L’inconnu et l’inquiétude
Au contraire, les cadres expatriés ont souvent des suppléments de revenus qui atténuent leurs inquiétudes. Ces trois populations ne sont pas à risque, leur couverture sociale est solide, mais « c’est nettement leur proximité et leur dépendance aux règles françaises qui alimentent leurs inquiétudes. Ils se sentent d’autant plus vulnérables à la réforme », explique Sylvaine Emery. Les expatriés en profession libérale, eux, en revanche, sont relativement sereins.
L’inconnu joue un rôle primordial dans l’inquiétude révélée. La réforme prévue pour 2019 devrait être « systémique », et donc profonde. C’est ce qu’a annoncé le candidat Macron en 2017 dans ses promesses de campagne, mais personne ne connaît la nature réelle du changement à venir, et encore moins les modalités. Ainsi, avant même cette réforme, 60 % des personnes interrogées se considèrent mal informées sur leur retraite et 27 % pas du tout. Bien que 48 % aient une couverture retraite à laquelle ils ont souscrit directement, ou par le moyen de leur employeur ou de celui de leur conjoint.
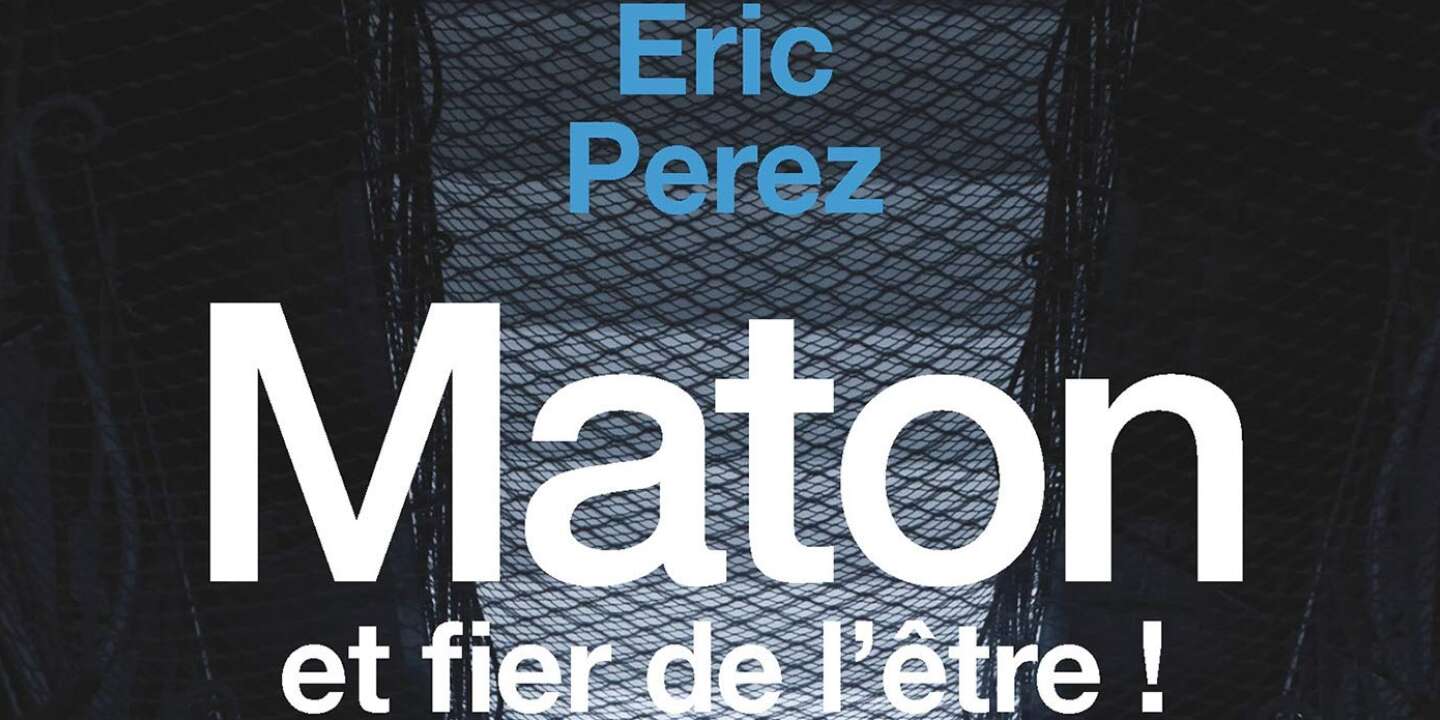
Dans son œuvre, Eric Perez revient sur 30 ans de carrière dans l’administration carcérale, retraçant le lourd quotidien des deux côtés des barreaux.
Livre. « Le bras énorme du prisonnier enserre ma tête et me bâillonne sans que je puisse remuer. Allongé par terre, je sens son souffle lourd sur moi et une lame qui pose contre ma gorge. » Tels sont les premiers mots choisis par Eric Perez pour plonger le lecteur dans l’univers carcéral.
Si la violence est forte dans Maton et fier de l’être !, ce livre est avant tout le récit en toute clarté de trente années de carrière au sein de l’administration carcérale.
Admis au concours de surveillant en 1981, Eric Perez est originellement affecté aux prisons de Saint-Joseph et de Saint-Paul à Lyon, avant d’assimiler particulièrement le centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur, ainsi que les maisons d’arrêt de Fresnes et de Fleury-Mérogis, connues pour leurs conditions de travail et de détention notamment difficiles. D’abord surveillant, puis premier surveillant, il intégrera pendant trois ans les Equipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS), « le GIGN de la pénitentiaire ».
Au fil des pages, le lecteur entrevoit le quotidien des agents de surveillance et celui des personnes emprisonnées, entre activités, fouilles de cellules, parloirs et sanctions disciplinaires.
On conçoit vite que « c’est sur le terrain qu’on apprend ce qu’il faut sanctionner et ce qu’il vaut mieux laisser passer », quitte à s’éloigner des règles apprises à l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire. Alors récemment arrivé à son poste, il confie avoir exigé des détenus qu’ils plient leurs draps et rangent leur cellule, conformément au règlement, avant d’y abandonner définitivement.
Un mal-être qui peut mener au suicide
Malgré cela, le « respect » se rencontre aussi en prison. « Rien ne se fait sans lui ». Et pour cause, « surveillants et surveillés, tout le monde fait partie de la même chaîne : un maillon saute et c’est l’ensemble qui se défait. (…) Toute la nécessité est de trouver le bon équilibre entre fermeté et humanité ».
Rien n’est laissé de côté, le livre comparant le lecteur tant au mal-être des détenus qu’à celui des membres du personnel, un mal-être qui peut parfois les mener au suicide. L’auteur a perdu une dizaine de collègues au cours de sa carrière.
Embêté de toute cette violence et victime d’une énième agression en détention, alors qu’il est étudié au quartier des mineurs de Fleury-Mérogis en 2011, Eric Perez met un terme à sa carrière au sein de l’administration carcérale. Selon lui « la prison est devenue un volcan qui peut exploser d’une minute à l’autre pour une peccadille ». Et de noter que « la surveillance ne se limite plus au “maintien de l’ordre”, les surveillants doivent aller “au combat”, à la dispute. Non seulement ils sont obligés d’être forts mentalement, mais encore ils doivent en imposer physiquement ».
Le tribunal de commerce de Nanterre a exprimé vendredi 29 mars la liquidation judiciaire d’Arjowiggins Papiers Couchés et l’abandon partielle d’une autre usine, ce qui menace 800 travailleurs pour ces deux sites de la Sarthe, a annoncé à l’Agence France-Presse (AFP) l’avocat des salariés, Thomas Hollande.
Les sites affectés sont ceux de Bessé-sur-Braye (Sarthe), qui emploie 580 personnes, et du Bourray, près du Mans (270 emplois). « C’est une catastrophe pour le département de la Sarthe », a-t-il assuré, faisant part de sa « colère » vis-à-vis de l’État.
« Il y a 800 travailleurs touchés directement, sans établir les emplois indirects. Il y a eu des ventes qui ont affecté autant de salariés, mais autant dans un même département et une même zone géographique, c’est vraiment inédit. »
Pour Bessé-sur-Braye, « c’est la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité », a étalé l’avocat. Pour le site du Bourray, à Saint-Mars-la-Brière, près du Mans, « c’est une cession partielle (…) avec le licenciement de plus de 150 salariés », a additionné Me Hollande. Quant à la troisième société de Greenfield, à Château-Thierry (Aisne, 75 salariés), elle est totalement reprise.
« C’est plié »
« La première réaction, c’est la colère face à l’Etat, à la BPI (Banque publique d’investissement, ndlr) et aux gouvernants du groupe, qui sont imputés de cette situation alors qu’il y avait un projet de reprise viable présenté et qu’ils ont refusé de le financer intégralement », a estimé Me Hollande.
Abraham Philippe, messager CGT à Bessé-sur-Braye, a raconté à l’AFP : « Notre directeur (de site) a pris la parole ce matin. Il n’y a pas d’issue, pas d’investisseur privé, c’est fini. On s’y attendait, mais là, c’est cuit. C’est plié, plus personne n’y croit. »
« On se rejoint, on est tous ensemble. Je pense qu’on va bloquer l’usine pour préserver les machines, l’outil de travail et le stock. Y a plus qu’à chercher du boulot… »
« C’est un issue rude pour le territoire (…). Malheureusement, les financements privés nécessaires pour équilibrer l’offre n’ont pu être réunis », a répercuté le ministère de l’économie dans un communiqué.
Les trois usines, qui appartenaient au groupe Sequana, ont été placées en redressement judiciaire le 8 janvier. Bpifrance est actionnaire de Sequana à hauteur de 15,4 % du capital et dispose 17,2 % des droits de vote.