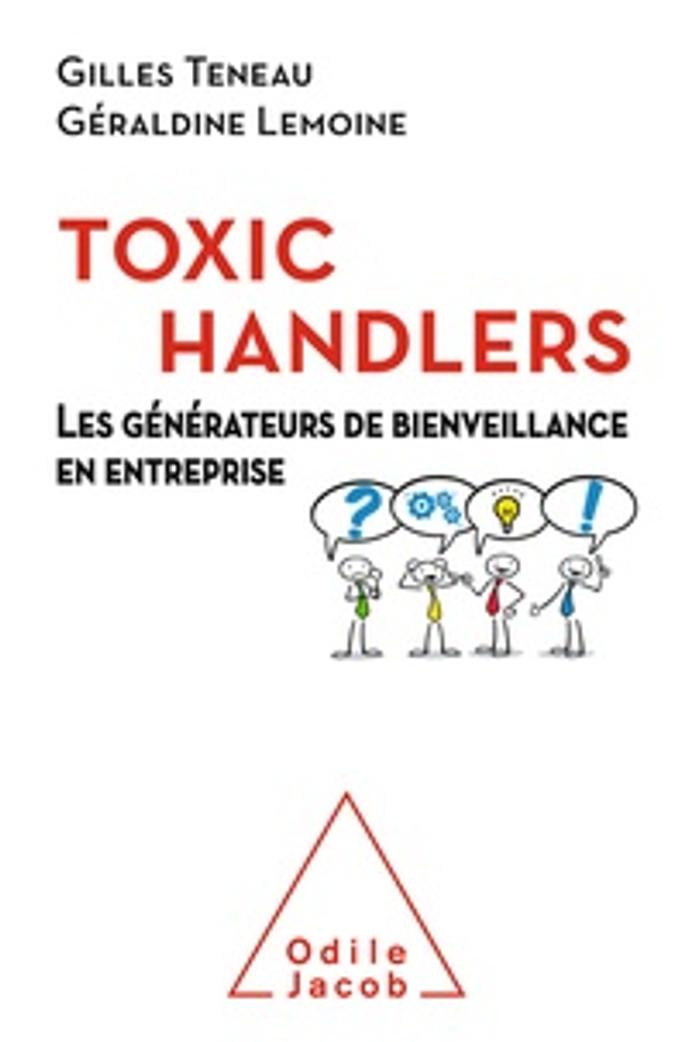Diminution d’impôts, PMA , écologie: ce qu’il faut tenir de l’exposé de politique générale d’Edouard Philippe

Pour la seconde fois depuis le début de la mandature, le gouvernement du Premier ministre Edouard Philippe a conquis la confiance de l’Assemblée nationale, mercredi 12 juin, par 363 voix contre 163, une conséquence en très léger repli par rapport à 2017.
Avant le vote des mandatés, Edouard Philippe a formulé un discours de politique générale, qui doit inscrire l’entrée dans l’« acte II » du quinquennat. Fiscalité, retraites, procréation médicalement assistée (PMA), assurance-chômage… le premier ministre a exposé le calendrier et la méthode des mois à venir, jusqu’aux élections municipales de mars 2020.
La situation d’« urgence », qui a, selon lui, conduit à l’élection d’Emmanuel Macron perdure après deux ans de mandat, a-t-il indiqué. Les urgences « économique », « sociale », « écologique » et enfin « politique », avec le triomphe électoral de l’extrême droite, déterminent la nécessité de « tenir le cap fixé (…) pour libérer les forces de notre pays et protéger ses citoyens », d’après le premier ministre, qui a promis « un profond changement de méthode ».
La PMA pour toutes observée fin septembre à l’Assemblée
C’était une annonce très espérée par tous les défenseurs de la « PMA pour toutes ». Le premier ministre a certifié que la mesure, qui admettra aux femmes seules et aux lesbiennes d’user aux techniques de procréation médicalement assistée (PMA) présentement retenues aux couples hétérosexuels infertiles, figurerait bien dans la loi de bioéthique.
Explications : 8 questions sur la PMA
Il a défini le calendrier : commencement du projet de loi en conseil des ministres fin juillet – possiblement lors du dernier conseil des ministres prévu le 26 juillet – et, surtout, inscription à l’Assemblée nationale fin septembre, mettant un terme aux craintes que le débat constitutionnel se développe après les élections municipales.
Edouard Philippe a déclaré que plusieurs options ont été émises concernant deux aspects de la loi : l’accès aux origines pour les personnes nées de don et la filiation pour les futurs enfants dont les parents ont eu recours à un tiers donneur. Sur ces deux points, qui paraitront donc dans le texte, les associations de familles homoparentales et les collectifs d’adultes nés après une PMA avec don de gamètes subsisteront très attentifs aux modalités choisies.
La majorité (surtout l’aile gauche) debout pour applaudir l’annonce de @EPhilippePM sur la PMA : projet de loi en c… https://t.co/wPKp1JNsZg
— AlexLemarie (@Alexandre Lemarié)
Retraites : maintien d’un départ « possible » à 62 ans
La future réforme des retraites retiendra « la possibilité d’un départ à 62 ans » mais l’exécutif conduira « un âge d’équilibre ». « Nous définirons un âge d’équilibre et des incitations à travailler plus longtemps », a exposé le premier ministre, mais « en ne bougeant pas l’âge légal », a-t-il pris soin de préciser. « Ainsi, chacun pourra faire son choix, en liberté et en responsabilité », a-t-il déclaré. Le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye, qui mène depuis janvier 2018 un intense programme de concertation, présentera ses conseils dès juillet.
Sur les retraites, la gauche se réveille. Philippe annonce que l’âge légal ne bougera pas, mais qu’il y aura un « âg… https://t.co/FisdbS7Ujq
— manonrescan (@Manon Rescan)
Assurance-chômage : bonus-malus pour les contrats courts
La future réforme de l’assurance-chômage concevra un bonus-malus qui s’appliquera « dans les 5 à 10 secteurs » d’activité usant le plus de contrats courts. La réforme, qui sera annoncée le 18 juin, inclura aussi « une dégressivité de l’indemnisation sur les salariés qui perçoivent les salaires les plus élevés », a-t-il encore exprimé.
La réforme de l’assurance-chômage sera présentée le 18 juin et le bonus-malus sur les CDD en fera partie, annonce… https://t.co/NNkMdXrRMb
— CPietralunga (@Cédric Pietralunga)
« L’ambition écologique » « au cœur de l’acte II »
Edouard Philippe a déclaré avoir « mis du temps à considérer que les enjeux [écologiques] sont aussi importants que l’emploi et la sécurité ». Il a garanti que « l’ambition écologique » serait « au cœur de l’acte II » du quinquennat et que ce thème dépasse les clivages politiques : « Plus personne n’a aujourd’hui le monopole du vert. »
Il a montré que les offres « les plus puissantes » de la convention citoyenne pour la transition écologique, voulue à l’issue du grand débat et qui doit être réunie dans les semaines à venir, pourraient être soumises « à référendum ». Cette masse de 150 citoyens « pourra proposer de nouvelles mesures, elle pourra en conduire le rythme et les financements. Elle rendra ses conclusions au début de l’année 2020 ».
Il a aussi annoncé, sans donner de précisions, que « les aides existantes à la rénovation énergétique » des bâtiments, trop « complexes » et « profitant en réalité aux ménages les plus riches », seront remises « totalement à plat ».
Le texte de lutte contre le gaspillage sera en outre inscrit dans les trois « priorités » de l’Assemblée nationale pour la rentrée en septembre. La loi prévoira notamment la possibilité d’imposer l’incorporation de plastique recyclé dans toutes les bouteilles en plastique, a-t-il dit. Il a enfin certifié que « tous les produits en plastique jetables seraient bannis » de l’administration à compter de 2020.
Une diminution d’impôts de 27 milliards sur le quinquennat
Le premier ministre a prévenu des baisses d’impôt sur la rétribution pour les classes moyennes qui admettront d’atteindre le chiffre « historique » de 27 milliards de diminution de la fiscalité sur les ménages durant le quinquennat. Edouard Philippe a donné le détail des gains pour les classes moyennes de la diminution de l’impôt sur le revenu de 5 milliards d’euros annoncée par le président Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse de fin avril.
« Nous avons reçu cinq sur cinq, fort et clair, le message d’exaspération fiscale » des Français, garantit @EPhilippePM… https://t.co/KNjGChSUC3
— CPietralunga (@Cédric Pietralunga)
« Le taux d’imposition de la première tranche de l’impôt sur le revenu, qui regroupe 12 millions de foyers, sera abaissé de trois points. Cela représente un gain moyen par foyer de 350 euros, soit, à ce niveau, un tiers de l’impôt en moyenne », a-t-il expliqué. « C’est massif, c’est clair, c’est net », a-t-il souligné, précisant que les 5 millions de foyers de la tranche suivante « bénéficieront d’un gain moyen de 180 euros ». Ces baisses seront accordées dans le projet de loi de finances pour l’année prochaine, a-t-il articulé.
- Philippe a pareillement témoigné que « la taxe d’habitation sur les résidences principales sera intégralement supprimée pour l’ensemble des Français ». Pour 80 % des « Français les plus modestes (…) leur taxe sera intégralement supprimée en 2020. Pour les 20 % restants, la suppression se déploiera sur trois années », a-t-il témoigné.
Annonces fiscales : – suppression TH pour les 20% de foyers restants en 2021/22/23
– baisse du taux d’IR 2e tranch… https://t.co/r7pRIqM9No
— AudreyTonnelier (@Audrey Tonnelier)
Les pensions alimentaires pourront être « automatiquement » prélevées
Les pensions alimentaires pourront être « automatiquement prélevées », « dès juin 2020 », par la Caisse d’allocations familiales (CAF) pour lutter contre « le risque d’impayé ». « Dès juin 2020, le gouvernement mettra en place un nouveau système pour protéger les personnes seules contre le risque d’impayé des pensions alimentaires », a déclaré le premier ministre.
« Écologie », « justice sociale »… Le gouvernement tente manifestement de reconquérir l’électorat de gauche, dont… https://t.co/bB9HctwDyZ
— AlexLemarie (@Alexandre Lemarié)
Réforme des institutions : vers un report ?
Edouard Philippe a ouvert la porte un report de l’examen de la réforme des institutions après les sénatoriales de septembre 2020, appelant néanmoins à ne pas « résister au désir de changement exprimé par les Français ».
« Nous attendrons le moment propice et la manifestation de volonté du Sénat, qui peut être ne viendra qu’après le renouvellement de la haute chambre en 2020 », a présenté le premier ministre.
- Philippe a également rappelé que « le président de la République a la faculté d’interroger directement les Français [par référendum] sur la réduction du nombre de parlementaires ».
Un débat annuel au Parlement sur l’asile et l’immigration
Le premier ministre promet de « lutter avec fermeté contre les abus de l’asile ». Le gouvernement organisera « chaque année un débat au Parlement » sur la politique d’asile et d’immigration, et le premier aura lieu en septembre. Ces questions « touchent aux fondements de notre souveraineté et de nos principes », a expliqué le premier ministre. « Il est donc nécessaire d’en débattre de manière régulière et au grand jour avec le Parlement. »
« L’islam de France doit former et recruter des imams »
Edouard Philippe veut « combattre l’islamisme et les discours de haine sur les réseaux sociaux » en « réformant l’organisation du culte musulman ». Il renforce le « large consensus sur une organisation départementale ». « L’islam de France doit former et recruter des imams en France et qui parlent français. S’il faut des dispositions législatives pour garantir la transparence du culte musulman, le gouvernement le proposera. »
Islam : @EPhilippePM estime que le culte musulman doit être organisé à l’échelon départemental, veut mettre un term… https://t.co/UR5RthLnYS
— CPietralunga (@Cédric Pietralunga)
Répondre au défi du vieillissement de la population
« Nous avons trop tardé pour nous y confronter car les budgets en jeu sont gigantesques, et par une forme de déni, a exprimé Edouard Philippe. C’est notre regard qui doit changer. Celui que nous portons sur la place des personnes âgées dans la société. Entendre leur volonté de vieillir à domicile, entendre les familles qui supportent une charge financière importante, entendre les personnels dont le métier doit être revalorisé. Le projet de loi sur la prise en charge de la dépendance sera présenté à la fin de l’année. Dès le prochain projet de loi de financement de la Sécurité sociale, nous prendrons des mesures pour permettre la prise en charge à domicile. Un des grands marqueurs sociaux de ce quinquennat. »
Le premier ministre annonce un projet de loi vieillissement à exposer à la fin de l’année :
La réforme de la dépendance sera présentée à la fin de l’année, @EPhilippePM assure que ce sera l’un des « grands ma… https://t.co/WaJAWrjxbz
— CPietralunga (@Cédric Pietralunga)
Ouverture de 30 000 places en crèche
« Le dédoublement de classe de CP et de CEI de ZEP restera une de ses grandes mesures de ce quinquennat. Mais nous irons plus loin : école obligatoire dès 3 ans, limite de 24 élèves par classe en CP et CE1. »
Pour les familles monoparentales, « qui se sont beaucoup exprimées pendant le grand débat », il rappelle la décision d’ouvrir 30 000 places en crèche, et la formation de 6 000 professionnels.
Les annonces sur la sécurité
Sur le volet sécurité, Edouard Philippe a certifié la mise en place d’un « plan stup’» pour abattre plus rentablement les trafics de drogue. Il a aussi averti que le ministre de l’intérieur, Christophe Castaner, exposerait des mesures contre les agressions du quotidien, comme celles à l’arme blanche, ou le phénomène des rixes de bandes, qui rétablissent régulièrement dans l’actualité.
Par contre, le premier ministre en a bénéficié pour envoyer un message aux forces de l’ordre et à leurs représentants syndicaux, avec qui des négociations sont présentement en cours sur les conditions de travail. M. Philippe a confirmé que les discussions sur le temps de travail, les heures additionnelles et la fidélisation des troupes devraient finir sous peu. Un compromit doit être aperçu avant le 30 juin.
Le gouvernement travaille enfin sur une amélioration de plus longue haleine, avec un réaménagement total de la progression de la police nationale. Christophe Castaner et son secrétaire d’Etat, Laurent Nunez, sont chargés de consigner un « livre blanc » pour la fin de l’année, qui devrait prévoir une nouvelle loi d’orientation et de prévision de la sécurité intérieure.