Parcoursup : 60 000 candidats toujours en attente de places à quelques heures de la fin de la phase principale
Selon le ministère de l’enseignement supérieur, 88,6 % des candidats lycéens avaient reçu une proposition jeudi.
Selon le ministère de l’enseignement supérieur, 88,6 % des candidats lycéens avaient reçu une proposition jeudi.
Des salariés de WN, le repreneur de Whirlpool, ont manifesté la semaine dernière à Amiens leur « colère » et leurs « inquiétudes » quant à leur avenir professionnel.

Le gouvernement va mener un audit afin de vérifier « la manière » dont WN, le repreneur de l’ancienne usine Whirlpool d’Amiens, a « utilisé l’argent public » alloué il y a un an, a annoncé jeudi 18 juillet Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie.
« Il y a des interrogations sur la manière dont l’argent public a été utilisé (…) Nous avons décidé de lancer un audit sur cet argent public et nous ferons une restitution aux salariés en priorité en plénière le 25 juillet prochain », a-t-elle déclaré en sortant d’une « réunion de suivi » à la préfecture de la Somme, à Amiens, avec notamment des représentants des salariés et des élus locaux. Et d’ajouter :
« Je n’ai pas d’idées préconçues sur ce que l’on trouvera », mais « justifier cet argent, ce sera une façon pour l’ensemble des salariés de passer à autre chose. Parce qu’aujourd’hui il y a de la défiance, il y a du soupçon (…) Si cet argent a été employé de manière tout à fait normale, c’est bien de le savoir (…) et si cet argent a été utilisé à des choses qui ne sont pas correctes, c’est bien de le savoir aussi » et qu’il y ait « des suites ».
« Vous avez quand même des salaires à payer. La masse salariale, c’est 550 000 euros par mois grosso modo, donc, en dix mois vous avez déjà 5 millions et demi qui sont expliqués. Après, les investissements, les stocks, la recherche, la prospection commerciale, ce sont ces éléments-là que l’on doit mettre en visibilité », a-t-elle détaillé.
Des salariés de WN, le repreneur de Whirlpool, placé en redressement judiciaire, ont manifesté la semaine dernière à Amiens leur « colère » et leurs « inquiétudes » quant à leur avenir professionnel.
En mai 2018, l’industriel picard Nicolas Decayeux avait repris 162 des 282 ex-salariés de Whirlpool. Son entreprise, la société WN, devait alors se lancer notamment dans la production de casiers réfrigérés connectés et la fabrication de chargeurs de batteries pour vélos et voitures, mais elle se trouve aujourd’hui dans une impasse de trésorerie, faute de débouchés commerciaux concrets.
Elle a été placée en redressement judiciaire le 3 juin, avec une période d’observation de six mois. Les candidats à la reprise du site ont jusqu’au 23 juillet pour déposer leur offre.
Par nécessité ou par envie, certains retraités reprennent un emploi. Le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye doit rendre jeudi ses conclusions sur le futur système de retraites.
Article réservé aux abonnés

Gérard Gomès n’a pas hésité longtemps quand a sonné l’heure de la retraite. Pas question pour cet ancien marin de rester assis dans son canapé à ne rien faire : « Regarder la télé toute la journée, ce n’était pas mon choix », dit-il. Après des missions de consulting pour des multinationales maritimes, il s’est lancé en 2008 dans l’immobilier pour le compte d’un ami promoteur. Pas tant par besoin d’argent – le Rochelais, aujourd’hui âgé de 85 ans, jouit d’une confortable retraite, « environ 3 500 euros par mois » – que pour maintenir son train de vie. Et, aussi, pour pouvoir contribuer avec son frère aux dépenses liées à l’hébergement de leur mère, âgée de 107 ans, dans un Ehpad, et gâter ses arrière-petits-enfants.
« Je me sentais encore utile dans mon travail. C’est là, quand on s’arrête, qu’on commence à vieillir »
Lorsque Yves Chassefaire, 67 ans, a arrêté de travailler, il a eu, lui, le sentiment de se retrouver « au bord de la falaise ». « Un vide immense m’entourait, c’était le début de la fin », se rappelle ce médecin du travail domicilié à Arles (Bouches-du-Rhône). Rappelé par son ancien employeur, il n’est « resté que vingt-cinq jours sans activité ». Aujourd’hui, il vient de « resigner » pour cinq ans. Et d’expliquer : « Je continue à faire quelque chose qui me plaît et qui apporte à l’autre, c’est très gratifiant. Et ça me permet de conserver une activité intellectuelle. »
Farida Harrag a commencé à travailler à 14 ans comme apprentie employée de bureau, pour finir conseillère clientèle dans la télésurveillance. Quarante-cinq années de travail, et « seulement onze mois de chômage ». Alors, la retraite, en juillet 2018, fut synonyme d’« horreur » pour cette Strasbourgeoise de 61 ans. « Je me sentais encore utile dans mon travail, se souvient-elle. C’est là, quand on s’arrête, qu’on commence à vieillir. » Six mois plus tard, son employeur la reprenait en CDI, quatre jours par semaine.
Comme Gérard Gomès, Yves Chassefaire ou Farida Harrag, quelque 3 % des retraités du régime général – environ 377 000 personnes – cumulent une pension de retraite et un emploi salarié, le plus souvent à temps partiel, selon une étude de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV). Plus de 500 000 personnes sont concernées, si l’on tient compte de l’ensemble des régimes (général, fonction publique, agricole, indépendants). Et bien plus encore avec le travail au noir, par nature difficile à évaluer. « Il y aurait au moins un à deux millions de personnes qui essaient de compenser des petites retraites avec des activités non déclarées », estime Serge Guérin, sociologue spécialiste du vieillissement.
Par nécessité ou par envie, certains retraités reprennent un emploi. Le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye doit rendre jeudi ses conclusions sur le cumul emploi-retraite au gouvernement.
Article réservé aux abonnés

Gérard Gomès n’a pas hésité longtemps quand a sonné l’heure de la retraite. Pas question pour cet ancien marin de rester assis dans son canapé à ne rien faire : « Regarder la télé toute la journée, ce n’était pas mon choix », dit-il. Après des missions de consulting pour des multinationales maritimes, il s’est lancé en 2008 dans l’immobilier pour le compte d’un ami promoteur. Pas tant par besoin d’argent – le Rochelais, aujourd’hui âgé de 85 ans, jouit d’une confortable retraite, « environ 3 500 euros par mois » – que pour maintenir son train de vie. Et, aussi, pour pouvoir contribuer avec son frère aux dépenses liées à l’hébergement de leur mère, âgée de 107 ans, dans un Ehpad, et gâter ses arrière-petits-enfants.
« Je me sentais encore utile dans mon travail. C’est là, quand on s’arrête, qu’on commence à vieillir »
Lorsque Yves Chassefaire, 67 ans, a arrêté de travailler, il a eu, lui, le sentiment de se retrouver « au bord de la falaise ». « Un vide immense m’entourait, c’était le début de la fin », se rappelle ce médecin du travail domicilié à Arles (Bouches-du-Rhône). Rappelé par son ancien employeur, il n’est « resté que vingt-cinq jours sans activité ». Aujourd’hui, il vient de « resigner » pour cinq ans. Et d’expliquer : « Je continue à faire quelque chose qui me plaît et qui apporte à l’autre, c’est très gratifiant. Et ça me permet de conserver une activité intellectuelle. »
Farida Harrag a commencé à travailler à 14 ans comme apprentie employée de bureau, pour finir conseillère clientèle dans la télésurveillance. Quarante-cinq années de travail, et « seulement onze mois de chômage ». Alors, la retraite, en juillet 2018, fut synonyme d’« horreur » pour cette Strasbourgeoise de 61 ans. « Je me sentais encore utile dans mon travail, se souvient-elle. C’est là, quand on s’arrête, qu’on commence à vieillir. » Six mois plus tard, son employeur la reprenait en CDI, quatre jours par semaine.
Comme Gérard Gomès, Yves Chassefaire ou Farida Harrag, quelque 3 % des retraités du régime général – environ 377 000 personnes – cumulent une pension de retraite et un emploi salarié, le plus souvent à temps partiel, selon une étude de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV). Plus de 500 000 personnes sont concernées, si l’on tient compte de l’ensemble des régimes (général, fonction publique, agricole, indépendants). Et bien plus encore avec le travail au noir, par nature difficile à évaluer. « Il y aurait au moins un à deux millions de personnes qui essaient de compenser des petites retraites avec des activités non déclarées », estime Serge Guérin, sociologue spécialiste du vieillissement.

Article réservé à nos abonnés Taxe sur le numérique : « Des risques d’incompatibilité avec le droit européen, mais également avec la Constitution française »
Giuseppe de Martino
Président de l’Association des services Internet communautaires (ASIC), cofondateur et président du média en ligne Loopsider
Le 4 juillet, une ordonnance parue au « Journal officiel » est venue encadrer davantage les prestations sur les retraites chapeaux. Le point sur les nouveautés apportées par le texte.
Article réservé aux abonnés

A la suite d’une énième polémique autour des parachutes dorés et de l’enveloppe de 1,3 million d’euros empochée par l’ex-patron d’Airbus Tom Enders, le gouvernement avait annoncé en avril son intention d’encadrer davantage les retraites chapeaux. C’est chose faite : le 4 juillet dernier, une ordonnance parue au Journal officiel apporte un nouveau cadre à ces prestations, qui garantissent à leurs bénéficiaires un certain niveau de revenus à leur retraite en venant compléter les pensions versées par les régimes obligatoires.
Principale innovation apportée par l’ordonnance du 4 juillet : à partir du 1er janvier 2020, les droits acquis chaque année au titre d’une retraite chapeau seront désormais plafonnés à 3 % de la rémunération annuelle, et leur cumul global ne pourra pas excéder 30 % du revenu annuel de référence. Aucun plafond en valeur absolue n’a toutefois été fixé.
En l’occurrence, les nouvelles limitations apportées par le texte ne changent pas fondamentalement la donne aux yeux de Christel Bonnet, consultante retraite senior chez Mercer France : « Les entreprises ont déjà mis des limites aux retraites chapeaux, fait valoir l’experte. En réalité, très peu vont au-delà de 3 %. »
Vilipendées par l’opinion publique, les retraites chapeaux ont déjà connu plusieurs tours de vis. La loi Breton de 2005 soumet ces prestations à l’aval du conseil d’administration. Le code de bonne conduite Afep-Medef recommande de plafonner les retraites chapeaux à 45 % du salaire, mais ce code n’a pas force de loi. La loi Macron pour la croissance et l’activité de 2015 vient aussi encadrer plus sévèrement les retraites chapeaux, en limitant à 3 % leur augmentation annuelle pour certaines catégories de dirigeants (président, directeur général, directeurs généraux délégués). L’ordonnance du 4 juillet constitue donc le prolongement de ce texte.
Le 4 juillet, une ordonnance parue au « Journal officiel » est venue encadrer davantage les prestations sur les retraites chapeaux. Le point sur les nouveautés apportées par le texte.
Article réservé aux abonnés

A la suite d’une énième polémique autour des parachutes dorés et de l’enveloppe de 1,3 million d’euros empochée par l’ex-patron d’Airbus Tom Enders, le gouvernement avait annoncé en avril son intention d’encadrer davantage les retraites chapeaux. C’est chose faite : le 4 juillet dernier, une ordonnance parue au Journal officiel apporte un nouveau cadre à ces prestations, qui garantissent à leurs bénéficiaires un certain niveau de revenus à leur retraite en venant compléter les pensions versées par les régimes obligatoires.
Principale innovation apportée par l’ordonnance du 4 juillet : à partir du 1er janvier 2020, les droits acquis chaque année au titre d’une retraite chapeau seront désormais plafonnés à 3 % de la rémunération annuelle, et leur cumul global ne pourra pas excéder 30 % du revenu annuel de référence. Aucun plafond en valeur absolue n’a toutefois été fixé.
En l’occurrence, les nouvelles limitations apportées par le texte ne changent pas fondamentalement la donne aux yeux de Christel Bonnet, consultante retraite senior chez Mercer France : « Les entreprises ont déjà mis des limites aux retraites chapeaux, fait valoir l’experte. En réalité, très peu vont au-delà de 3 %. »
Vilipendées par l’opinion publique, les retraites chapeaux ont déjà connu plusieurs tours de vis. La loi Breton de 2005 soumet ces prestations à l’aval du conseil d’administration. Le code de bonne conduite Afep-Medef recommande de plafonner les retraites chapeaux à 45 % du salaire, mais ce code n’a pas force de loi. La loi Macron pour la croissance et l’activité de 2015 vient aussi encadrer plus sévèrement les retraites chapeaux, en limitant à 3 % leur augmentation annuelle pour certaines catégories de dirigeants (président, directeur général, directeurs généraux délégués). L’ordonnance du 4 juillet constitue donc le prolongement de ce texte.
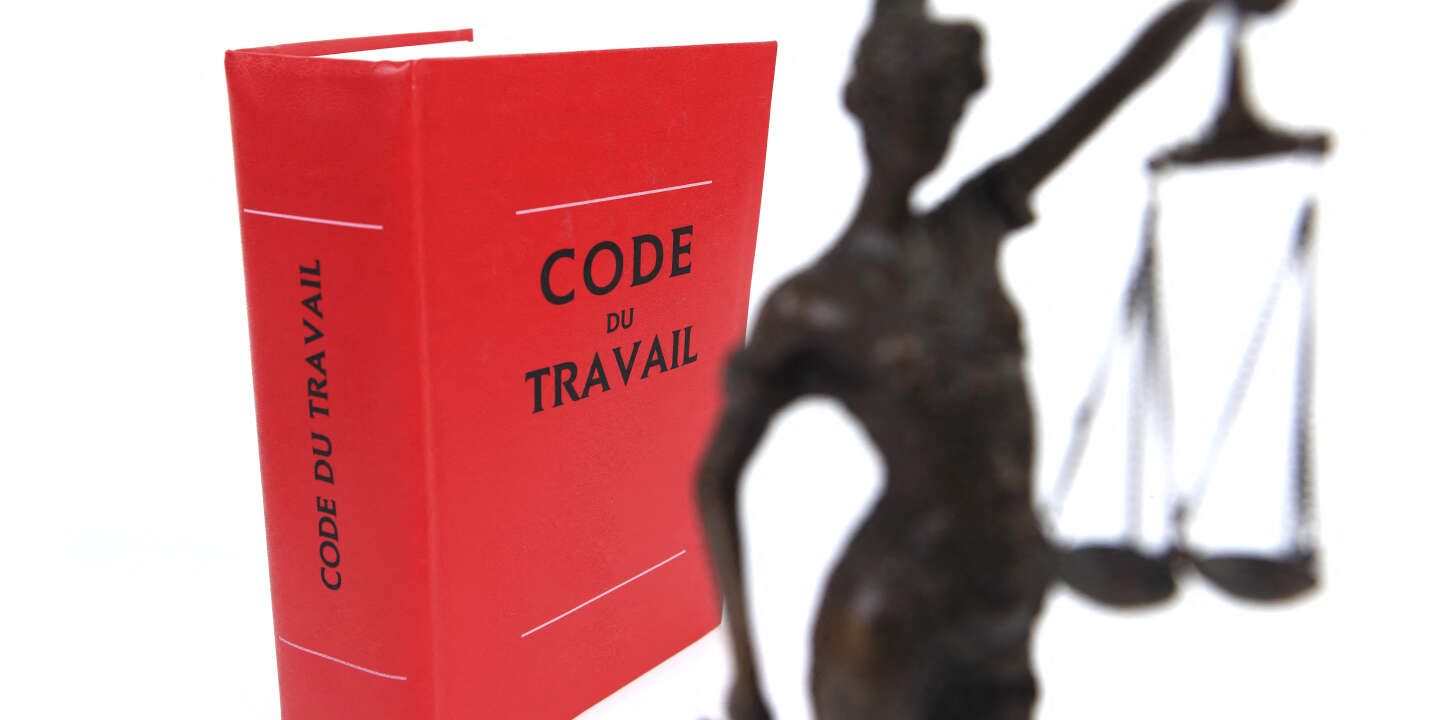
Si elle se saisit, la haute juridiction dira si ce dispositif est conforme à des textes internationaux ratifiés par la France.
C’est un avis très attendu. La Cour de cassation se prononce mercredi 17 juillet sur le barème prud’homal pour licenciement abusif. La décision de la haute juridiction pourrait sonner le glas de ce dispositif décrié par les syndicats ou au contraire le valider, comme l’espèrent le gouvernement et le patronat. Elle pourrait aussi choisir de ne pas se prononcer sur le fond, en estimant ne pas être compétente sur ce dossier.
A supposer qu’elle se saisisse, la Cour de cassation dira si le plafonnement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est conforme à des textes internationaux ratifiés par la France. Depuis les ordonnances réformant le code du travail à la fin de 2017, le plafond se situe entre un et vingt mois de salaire brut, en fonction de l’ancienneté.
Auparavant, les juges étaient libres de fixer les montants, allant jusqu’à trente mois de salaires pour trente ans d’ancienneté. Il y avait également un plancher de six mois de salaire pour les employés ayant plus de deux ans d’expérience dans une société de plus de dix salariés.
Depuis la fin de 2018, pour une vingtaine d’affaires – selon une association d’avocats –, des conseillers prud’homaux ont passé outre, considérant que le barème ne réparait pas le préjudice subi. Deux d’entre elles ont été renvoyées en appel, avec des décisions attendues le 25 septembre, l’une à Paris, l’autre à Reims.
Sans attendre un éventuel pourvoi, les conseils de prud’hommes de Louviers (Eure) et Toulouse (Haute-Garonnne) ont sollicité dès avril l’avis de la Cour de cassation pour savoir si le barème était conforme aux textes internationaux.
Ils avancent l’article 10 de la convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) de 1982, disposant qu’en cas de licenciement injustifié les juges doivent « être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ». Et l’article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 indique que les travailleurs ont droit à une « indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée » en cas de licenciement. Le conseil de Louviers a aussi évoqué l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme sur le « droit à un procès équitable ».
Le 8 juillet, signe de l’importance du dossier, la Cour de cassation y a consacré une séance plénière, en réunissant toutes ses chambres. Les avocats de salariés ont alors critiqué un barème « injuste », qui « sécurise l’employeur fautif ». Me Thomas Haas a aussi mis en avant la baisse « marquée » des contentieux aux prud’hommes, « jusqu’à − 40 % dans certains conseils » en 2018, et en a déduit que ce dispositif « dissuade le salarié de saisir la justice ».
« A ancienneté égale, un salarié de 51 ans peu qualifié dans un bassin d’emploi sinistré et un salarié de 35 ans très qualifié vivant dans un bassin d’emploi très dynamique auront la même indemnité, alors que le préjudice est plus important pour le premier », a relevé Me Manuela Grévy.
Les représentants des employeurs ont, eux, jugé « trop floues » les notions d’indemnité « adéquate » et « appropriée » figurant dans les textes internationaux. Le barème, « équilibré » en France, est « une tendance lourde en Europe et l’OIT n’a jamais eu de commentaire désobligeant à ce propos », a assuré Me François Pinatel.
Autres arguments : il n’est pas appliqué en cas de harcèlement moral ou de discrimination ; le licencié peut prétendre à un revenu de remplacement, « généreux » selon Me Pinatel, avec l’allocation-chômage ; la Charte 24 ne peut être appliquée aux « personnes physiques et morales », selon Me Jean-Jacques Gatineau ; le salarié peut être réintégré dans l’entreprise.
L’avocate générale, Catherine Courcol-Bouchard, a jugé le barème conforme à l’article OIT, rédigé dans des « termes volontairement vagues » pour laisser aux Etats une marge de manœuvre, selon elle. Elle a jugé « irrecevable » le recours à la Charte sociale et s’est dite « perplexe » quant à la référence à l’article 6 de la Convention des droits de l’homme. « Le rôle du juge n’est pas de dire si une mesure est bonne ou mauvaise », a-t-elle souligné.
Les positions des avocats généraux ne sont pas toujours suivies par la Cour de cassation.
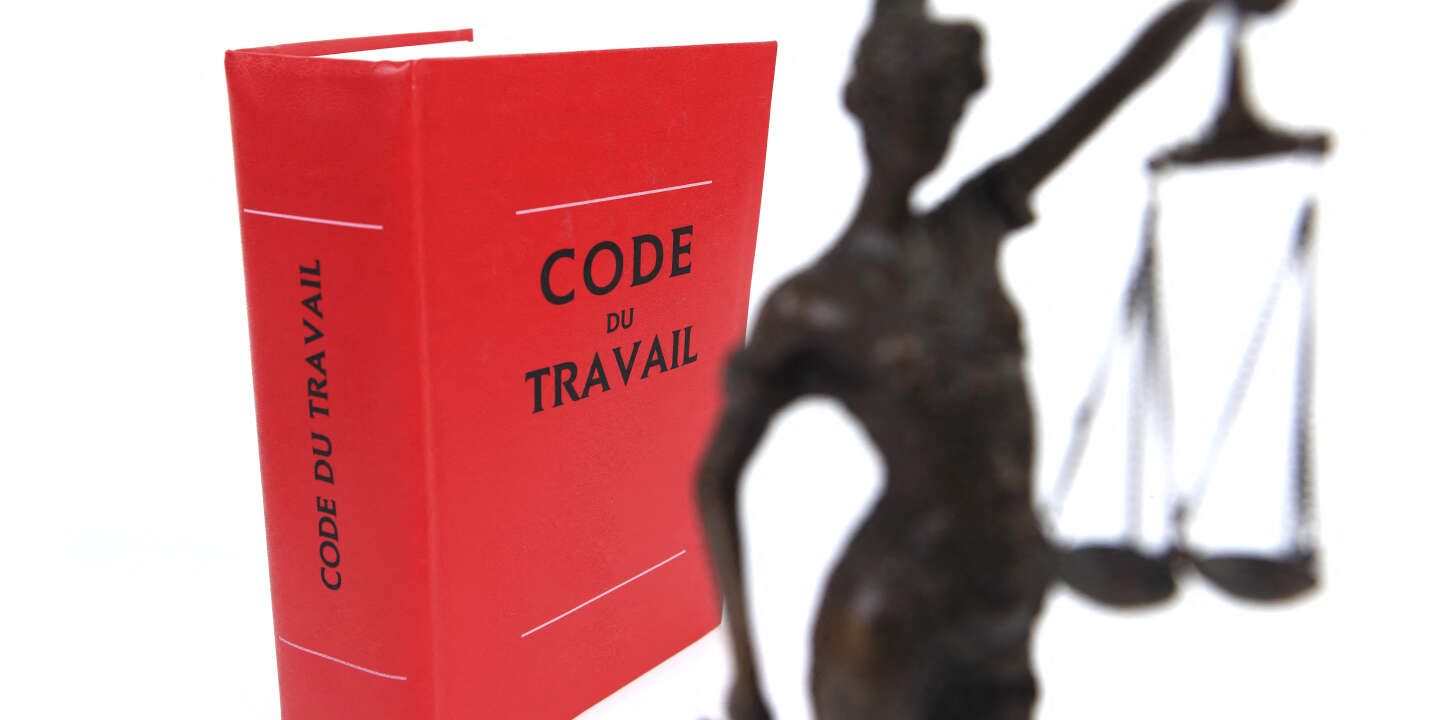
L’avis de la haute juridiction sur ce dossier est très attendu. Si elle se saisit la Cour dira si le plafonnement des indemnités est conforme à des textes internationaux ratifiés par la France.
C’est un avis très attendu. La Cour de cassation se prononce mercredi 17 juillet sur le barème prud’homal pour licenciement abusif. La décision de la haute juridiction pourrait sonner le glas de ce dispositif décrié par les syndicats ou au contraire le valider, comme l’espèrent le gouvernement et le patronat. Elle pourrait aussi choisir de ne pas se prononcer sur le fond, en estimant ne pas être compétente sur ce dossier.
A supposer qu’elle se saisisse, la Cour de cassation dira si le plafonnement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est conforme à des textes internationaux ratifiés par la France. Depuis les ordonnances réformant le Code du travail fin 2017, le plafond se situe entre un et vingt mois de salaire brut, en fonction de l’ancienneté.
Auparavant, les juges étaient libres de fixer les montants, allant jusqu’à 30 mois de salaires pour 30 ans d’ancienneté. Il y avait également un plancher de six mois de salaire pour les employés avec plus de deux ans d’expérience dans une société de plus de dix salariés.
Depuis fin 2018, pour une vingtaine d’affaires – selon une association d’avocats –, des conseillers prud’homaux sont passés outre, considérant que le barème ne réparait pas le préjudice subi. Deux d’entre elles ont été renvoyées en appel, avec des décisions attendues le 25 septembre, l’une à Paris, l’autre à Reims.
Sans attendre un éventuel pourvoi, les conseils de prud’hommes de Louviers (Eure) et Toulouse ont sollicité dès avril l’avis de la Cour de cassation pour savoir si le barème était conforme aux textes internationaux.
Ils avancent l’article 10 de la convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) de 1982, disposant qu’en cas de licenciement injustifié les juges doivent « être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ». Et l’article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 indique que les travailleurs ont droit à une « indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée » en cas de licenciement. Le conseil de Louviers a aussi évoqué l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme sur le « droit à un procès équitable ».
Le 8 juillet, signe de l’importance du dossier, la Cour de cassation y a consacré une séance plénière, en réunissant toutes ses chambres. Les avocats de salariés ont alors critiqué un barème « injuste », qui « sécurise l’employeur fautif ». Me Thomas Haas a aussi mis en avant la baisse « marquée » des contentieux aux prud’hommes, « jusqu’à – 40 % dans certains conseils » en 2018, et en a déduit que ce dispositif « dissuade le salarié de saisir la justice ».
« A ancienneté égale, un salarié de 51 ans peu qualifié dans un bassin d’emploi sinistré et un salarié de 35 ans très qualifié vivant dans un bassin d’emploi très dynamique auront la même indemnité, alors que le préjudice est plus important pour le premier », a relevé Me Manuela Grévy.
Les représentants des employeurs ont, eux, jugé « trop floues » les notions d’indemnité « adéquate » et « appropriée » figurant dans les textes internationaux. Le barème, « équilibré » en France, est « une tendance lourde en Europe et l’OIT n’a jamais eu de commentaire désobligeant à ce propos », a assuré Me François Pinatel.
Autres arguments : il n’est pas appliqué en cas de harcèlement moral ou de discrimination ; le licencié peut prétendre à un revenu de remplacement, « généreux » selon Me Pinatel, avec l’allocation-chômage ; la Charte 24 ne peut être appliquée aux « personnes physiques et morales » selon Me Jean-Jacques Gatineau ; le salarié peut être réintégré dans l’entreprise.
L’avocate générale, Catherine Courcol-Bouchard, a jugé le barème conforme à l’article OIT, rédigé dans des « termes volontairement vagues » pour laisser aux Etats une marge de manœuvre, selon elle. Elle a jugé « irrecevable » le recours à la Charte sociale et s’est dite « perplexe » quant à la référence à l’article 6 de la Convention des droits de l’homme. « Le rôle du juge n’est pas de dire si une mesure est bonne ou mauvaise », a-t-elle souligné.
Les positions des avocats généraux ne sont pas toujours suivies par la Cour de cassation.

Si l’emploi précaire et le sous-emploi sont réels au Royaume-Uni, la vraie explication à la baisse du taux de chômage, qui s’élève à 3,8 %, est la faiblesse des salaires.
Article réservé aux abonnés
Depuis la crise financière de 2008, les économistes britanniques n’y comprennent plus rien. Eux qui prévoyaient d’abord une envolée du chômage à cause de la récession, puis un lent recul étant donné la croissance médiocre, sont obligés de constater que celui-ci est particulièrement bas au Royaume-Uni. Il a culminé à seulement 8 % au plus fort de la crise et est désormais de 3,8 % pour les mois de mars à mai, selon les statistiques publiées mardi 16 juillet. Soit le plus bas niveau depuis décembre 1974, il y a quarante-cinq ans.
Plus étrange encore, alors même que la croissance ralentit à cause du Brexit (elle tourne à 1,5 % en rythme annuel), le chômage continue de refluer. Depuis le référendum de juin 2016, il a reculé d’un point. Il est désormais question régulièrement du « miracle britannique de l’emploi ».
L’agence de travail temporaire Tiger Recruitment constate ce dynamisme quotidiennement. « Les candidats se montrent plus exigeants, demandant une augmentation de salaire de 8 % à 10 % pour changer d’emploi », note Rebecca Siciliano, une de ses dirigeantes. Récemment, une jeune secrétaire, sortie de l’université depuis trois ans, demandait un salaire annuel de 35 000 livres (39 000 euros) : elle s’est vu offrir 42 000 livres. « Les entreprises sont aussi prêtes à proposer des horaires flexibles et du télétravail, continue Mme Siciliano. J’ai même entendu parler de cas de gens qui peuvent travailler quatre jours par semaine payés cinq. »
Pourtant, le vote en faveur du Brexit le prouve : les Britanniques ne sont guère heureux de leur situation économique. Les banques alimentaires ne désemplissent pas. En 2018, le Trussell Trust, équivalent des Restos du cœur, a distribué 1,6 million de colis alimentaires, en hausse de 19 %.
L’explication de ce paradoxe vient avant tout de la faiblesse des salaires. Actuellement, les rémunérations des Britanniques demeurent 5 % en dessous de leur niveau de 2008. Une telle stagnation sur une décennie est du jamais-vu dans l’histoire économique récente. « Dans les années 1980, 10 % de la population étaient en permanence au chômage et 90 % avaient un emploi. Aujourd’hui, la douleur est partagée par tous. Mais il n’est pas certain que ce soit mieux », explique Danny Blanchflower, économiste à l’université de Dartmouth, ancien membre de la Banque d’Angleterre, qui vient de publier un livre sur le marché du travail intitulé Not Working. Where Have All the Good Jobs Gone ? (« Je ne travaille pas. Où sont passés tous les bons emplois ? », Princeton University Press, non traduit).