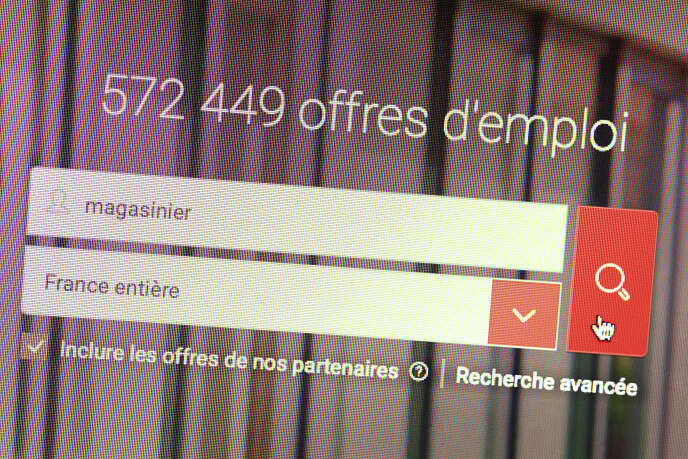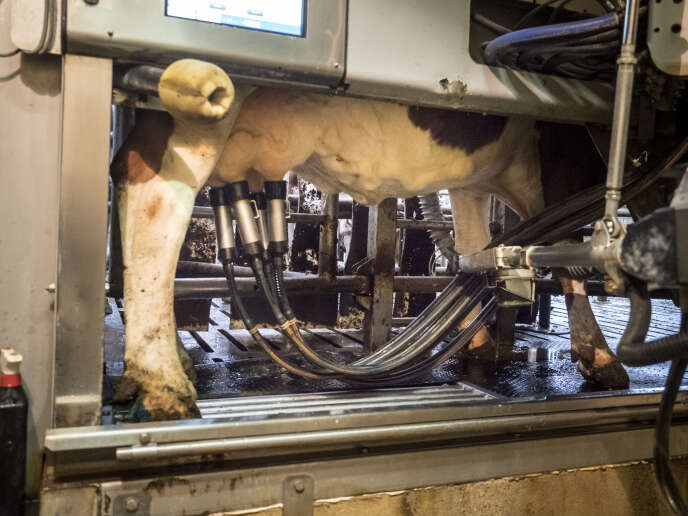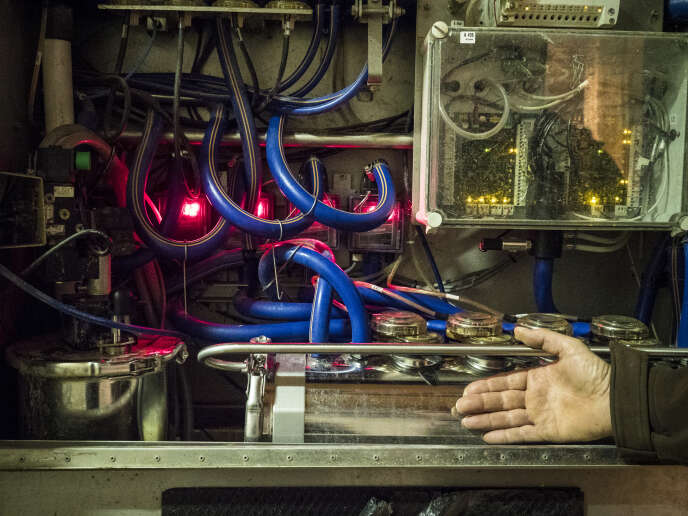Les livreurs Deliveroo demandent aux consommateurs de boycotter la plate-forme
Selon les livreurs indépendants, la nouvelle grille tarifaire décidée par la plate-forme de livraison de plats à domicile va entraîner une baisse de leur rémunération.

En conflit avec la plate-forme de livraison de plats à domicile, des livreurs de Deliveroo ont demandé aux consommateurs de boycotter l’entreprise mercredi 7 août.
« Aujourd’hui, on essaie de sensibiliser les consommateurs. On leur demande, juste aujourd’hui, de ne pas commander à Deliveroo et de ne pas se connecter, par soutien au mouvement » contre la nouvelle grille tarifaire décidée par la plate-forme, a déclaré Jean-Daniel Zamor, président du Collectif des livreurs autonomes parisiens (CLAP 75).
Deliveroo a annoncé ces derniers jours baisser les tarifs des courses les plus courtes et augmenter celui des courses longues, délaissées par les livreurs car peu rentables. La plate-forme a notamment supprimé le tarif minimal de 4,70 euros pour une course, qui s’appliquait à Paris (il varie selon les villes).
Selon la plate-forme, la nouvelle grille offre « une meilleure tarification, plus juste » et « plus de 54 % des commandes sont payées davantage ». Mais pour M. Zamor, les courses longues ne sont pas rentables, car « elles peuvent faire plus d’une heure, soit l’équivalent de trois ou quatre courses courtes ». Il estime entre 30 % et 50 % la perte de rémunération pour les livreurs payés en tant qu’autoentrepreneurs.
« Cela précarise tout le secteur »
Le CLAP 75 appelle également les livreurs à un rassemblement à partir de 19 heures place de la République à Paris, afin de « faire entendre nos droits et montrer qu’on peut frapper ». Le rassemblement doit être suivi par le blocage de plusieurs restaurants. Les livreurs ont aussi l’intention de mener une action nationale ce week-end. Dans certaines villes, comme dans la capitale, ils seront en grève samedi tandis que dans d’autres, à Grenoble par exemple, ce sera dimanche, a annoncé M. Zamor. Les livreurs parisiens s’étaient déjà réunis samedi 3 août.
« Deliveroo était la plate-forme qui payait à peu près le mieux, mais elle s’aligne maintenant sur ses concurrents, a regretté M. Zamor. Cela précarise tout le secteur. » Avec 10 000 restaurants partenaires dans 200 villes, le marché français est le deuxième pour Deliveroo, après le marché britannique.