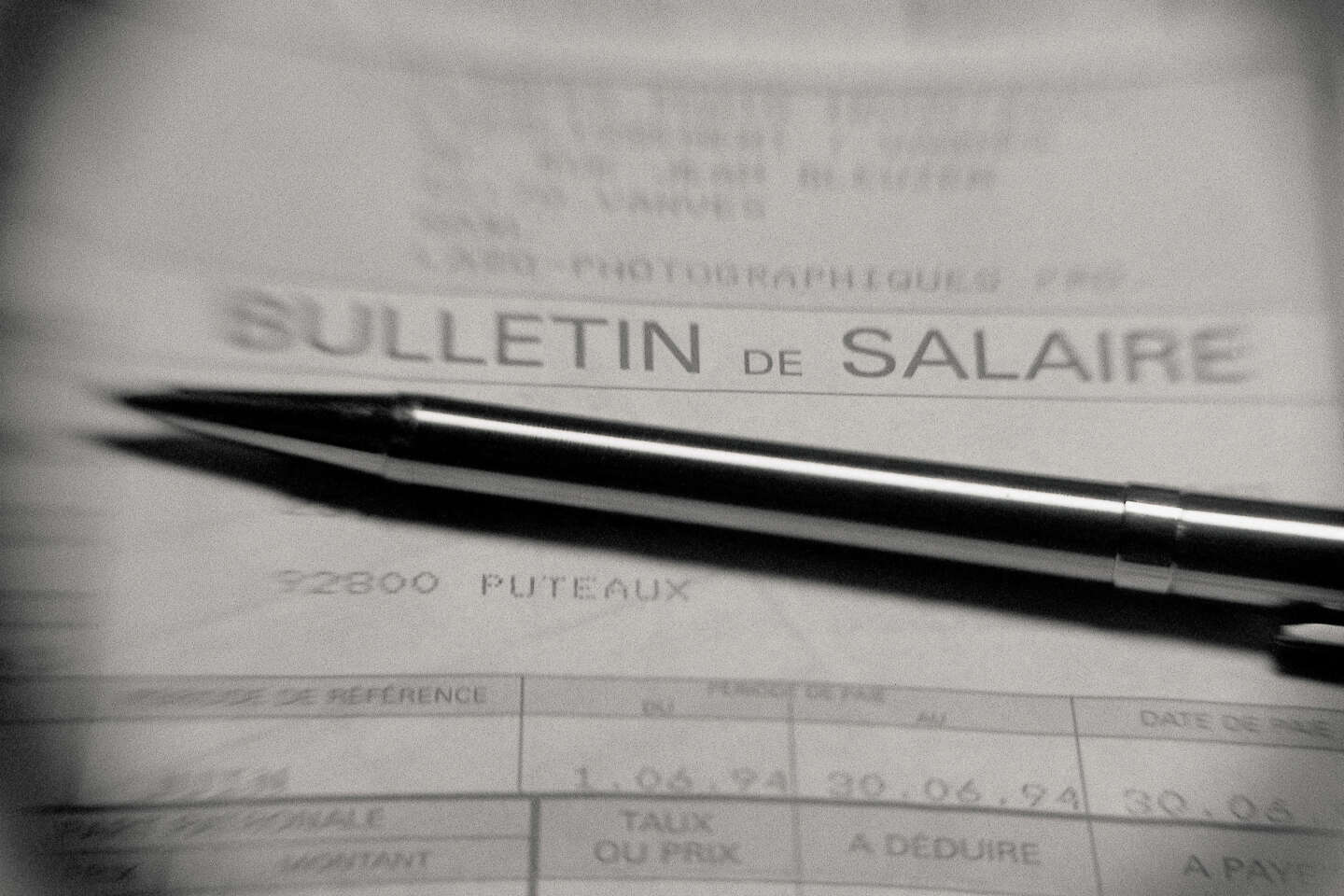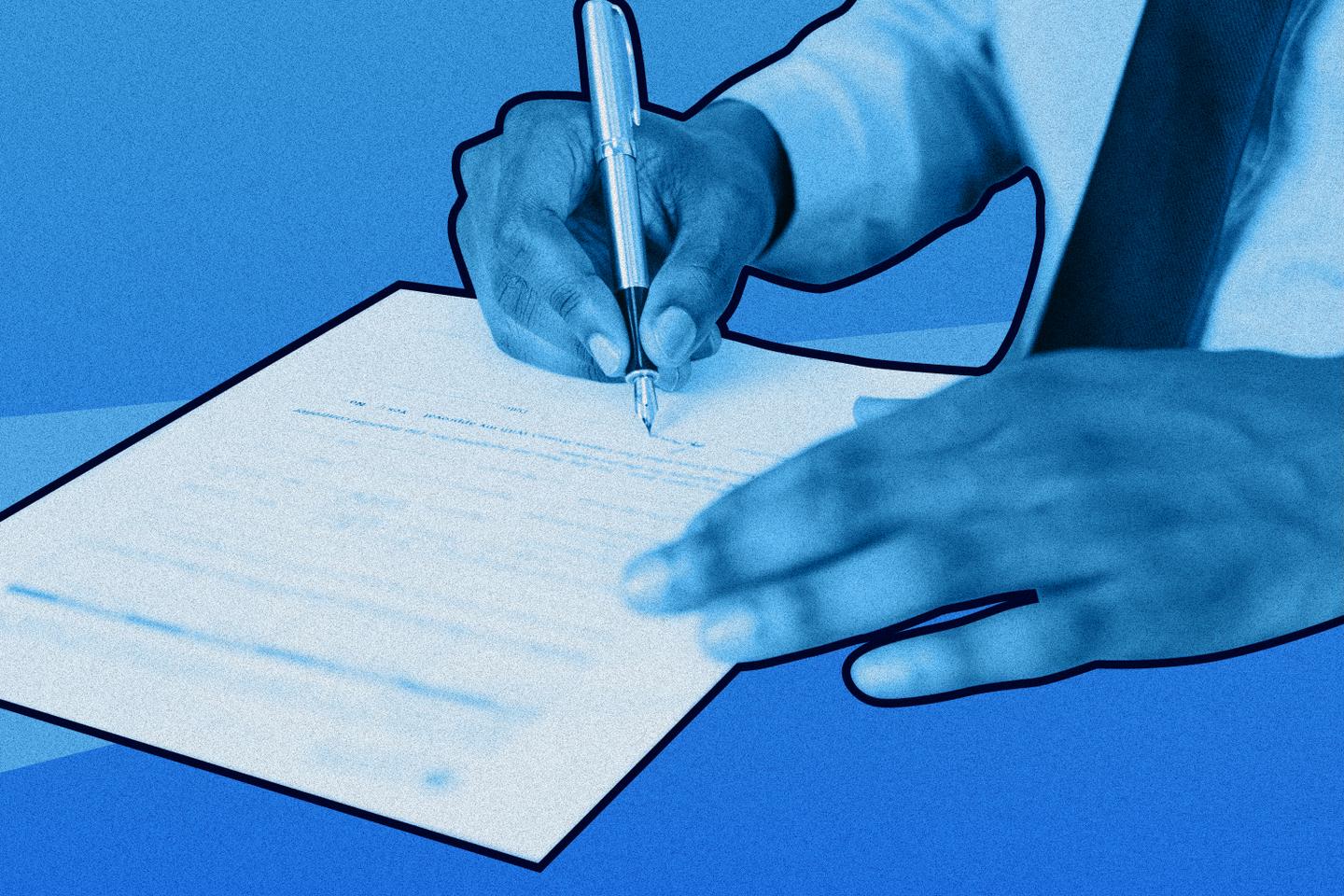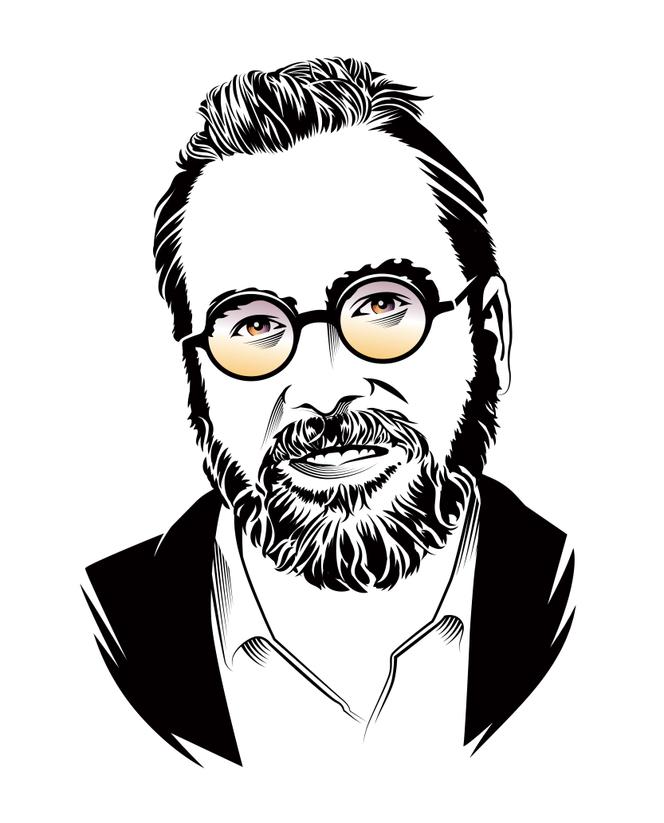En Allemagne, la restructuration de l’aciériste ThyssenKrupp symbole d’une industrie « en chute libre »

S’il fallait choisir un seul symbole de la crise historique dans laquelle se trouve actuellement l’industrie allemande, ce pourrait être celui-là : l’aciériste ThyssenKrupp, emblème de l’histoire industrielle allemande et l’un des berceaux de la codécision, s’apprête à démarrer la restructuration la plus profonde jamais entreprise par le groupe depuis ses origines en 1811.
Selon l’accord signé avec les syndicats, lundi 1er décembre au soir, 11 000 emplois doivent disparaître d’ici à 2030, sur les 26 000 que compte l’entreprise. Les hauts-fourneaux et laminoirs de Duisburg (Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie) verront leur production réduite, de 11,5 millions à 9 millions de tonnes d’acier par an, avant une probable vente à un investisseur étranger. Un paradoxe à l’heure où la souveraineté est érigée comme priorité nationale. Outre-Rhin, l’industrie représente un quart du produit intérieur brut et emploie directement 7,4 millions de personnes.
Bien sûr, ThyssenKrupp a présenté l’opération comme une transition vers un redressement à venir. Un « nœud gordien » a été tranché, s’est ainsi félicité Marie Jaroni, la directrice du département acier de ThyssenKrupp, lundi soir, assurant que l’entreprise serait désormais « prête à affronter l’avenir ». L’accord comprend notamment la promesse d’un site de fabrication d’« acier vert » grâce à l’hydrogène, en discussion depuis plusieurs années. Difficile pourtant de partager cet optimisme au vu du chemin de croix parcouru par le groupe depuis quelques années.
Il vous reste 68.57% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.