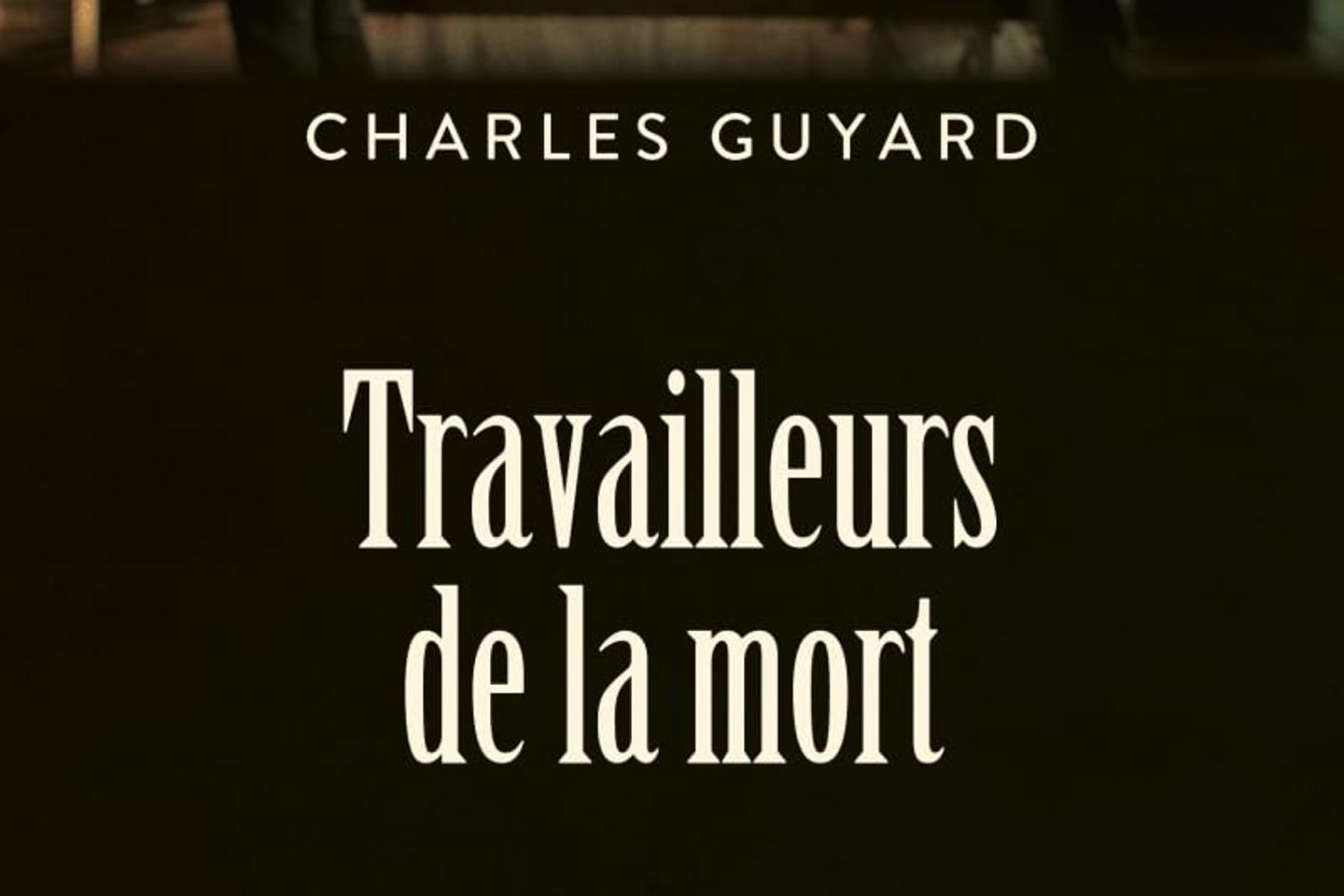« Le travail est un facteur de risque avéré du cancer »

Une récente publication du Lancet place la France en tête des pays les plus touchés par le cancer, avec plus de 433 000 personnes malades chaque année, un nombre qui a doublé en vingt ans. Cette situation très inquiétante est le plus souvent rapportée aux seuls comportements individuels à risque – tabac, alcool, activité physique –, mais est-ce la bonne approche ?
Cette jeune fleuriste, dont l’enfant est morte à 11 ans d’un cancer du sang après sept ans de lourds traitements, avait-elle « choisi » d’être contaminée par les pesticides dont étaient imprégnées ses fleurs, pesticides cancérogènes non seulement pour elle-même mais aussi pour l’enfant à naître ? Les ouvrières du laboratoire Tetra Medical ont-elles « choisi » le procédé de stérilisation à l’oxyde d’éthylène, cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction qui les a empoisonnés durablement, elles et leurs enfants ? Les ouvriers des usines chimiques ont-ils « choisi » les PFAS, au redoutable pouvoir toxique ? Sans parler des employées du nettoyage, contaminées par les cancérogènes des produits d’entretien.
Les risques du travail, facteurs de dangers avérés du cancer, n’apparaissent pas dans l’article du Lancet, qui reprend le discours dominant et culpabilisant qui fait reposer la responsabilité de la survenue des cancers sur les victimes elles-mêmes.
Le travail de nuit ou posté, par exemple, est l’une des causes du cancer du sein, reconnue officiellement comme telle en 2007 par le Centre international de recherche sur le cancer. Chez les femmes, ce type d’organisation temporelle du travail a néanmoins augmenté de 150 % entre 1982 et 2015, en progression dans de multiples secteurs où il n’est nullement indispensable – industrie, commerce, nettoyage.
Scandales sanitaires
Nous, signataires de cette tribune, nous voulons rappeler le travail inlassable et les mobilisations de tous ceux et celles – militants associatifs et syndicalistes, chercheurs, médecins, avocats – qui, depuis plus de quarante ans, alertent sur ces risques évitables que sont les multiples situations de mise en danger de la vie d’autrui dans le travail exposé aux cancérogènes.
Il vous reste 68.48% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.